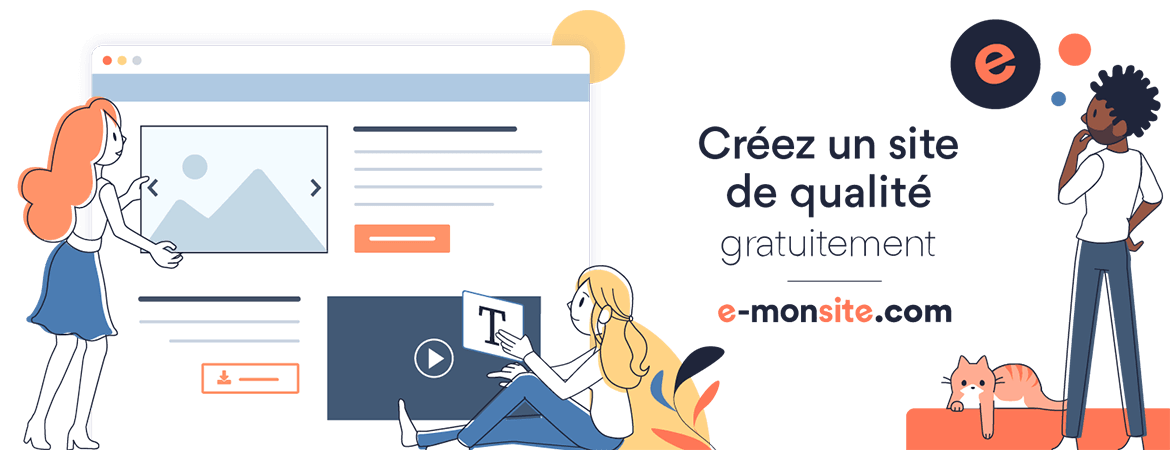les 7 Vies de Gaspard Noël
Les Sept Vies de Gaspard Noël
***
1/ Le temps infini
Tout a un commencement. Du moins le croit-on. Bien forcé sinon on ne pourrait plus dormir. Imaginez simplement qu’il est impossible de trouver un point de départ et vous aurez une certaine idée du vertige.
D’un autre côté, si un tel début existe bel et bien, vient se poser l’angoissante question du pourquoi.
Pourquoi, à un moment où même le temps n’existait pas encore, quelque chose fut. A partir de rien, du néant. Là, entre en scène Dieu. Ou l’idée de Dieu. Réponse toute faite au terrible dilemme. Ce n’est que déplacer le problème puisqu’alors, Dieu a-t-il une origine?
Cependant, ce qui tourmente le plus les esprits les plus pointilleux c’est d’imaginer qu’il n’y ait pas de fin. Et l’un ne va pas sans l’autre. S’il y a un début il y a nécessairement une fin. Un univers qui n’aurait pas de limites donne le tournis. Mais l’univers n’a pas de limites, nous le savons bien, enfin dans l’état actuel des connaissances. Ce qui est lourdement relatif. Il n’y a pas cinq cent ans, le monde avait six mille ans et la terre était le centre de l’univers.
L’univers remplit l’espace. Sans fin.
Reprenons. Je nais. Je vis. Je meurs. Et après? La Terre continuera de tourner. Mais où serai-je en attendant? Et en attendant quoi, je vous le demande? Mes enfants auront des enfants qui vivront, mourront, auront à leur tour des enfants qui… Une spirale infinie. Stop! L’espèce humaine finira quand même bien par disparaitre, qu’elle qu’en soit la cause. Supposons que je ne crois pas à la réincarnation, où serais-je? Pourtant la disparition de l’homme ne signera pas la fin. D’autres espèces apparaitront, s’épanouiront, disparaitront à leur tour. Un jour pourtant, le Soleil gonflera jusqu’à engloutir notre bonne vieille Terre. Puis il se transformera en naine rouge. Nous le savons. Et ce sera la fin. Je pourrai enfin me reposer tranquillement dans ma mort.
Seulement la mort du soleil ne signifie pas la fin de l’univers. D’autres étoiles s’allumeront, d’autres galaxies naitront. Et ainsi de suite. Jusqu’à consumer tout l’hydrogène du cœur des étoiles. Les atomes simples donneront des particules toujours plus élaborées. Dans quel but?
Au bout de cette éternité, les étoiles finiront par s’éteindre. Toutes. Par manque de carburant. Le ciel deviendra noir. L’énergie aura disparu. La matière ne pourra plus s’organiser, comme les cendres d’un grand feu. Des poussières d’étoiles erreront dans le vaste univers. Où serai-je à ce moment là? Qu’attendrai-je?
Lorsque la plus petite particule stoppera enfin sa course, l’univers sera-t-il encore en expansion? Les trous noirs se seront-ils affaissés à leur tour? L’immensité glacée s’éteindra dans une immobilité qui sonnera leur glas. Le temps s’arrêtera alors. Est-ce bien sûr?
Sera-ce la fin de mes tourments?
Tout cela m’empêche de dormir.
2/ Première vie (comme un poisson dans l‘eau).
On a délibérément posé que la vie d’un homme débutait le jour de sa naissance. C’est noté sur les registres. Mais, biologiquement parlant, la vie ne nait-elle pas à la seconde où le spermatozoïde rencontre l’ovule? Faut-il attendre la première connexion entre les synapses du cerveau, le premier battement du cœur? Philosophiquement, il faut remonter encore plus avant. Prendre en compte tous les paramètres, les hasards et les coïncidences qui ont permis à deux personnes de sexe différent de se rencontrer et de donner la vie. Ces personnes ont vécu le même schéma. Elles proviennent de deux autres parents qui leur ont transmis leur code génétique, leur ADN et, accessoirement, une éducation. On ne tarde pas à parvenir au commencement de l’espèce, lorsqu’un gène a muté lors de la réplication. Hasard total qui aurait dû mettre fin à ce mutant. Il faut imaginer les difficultés que cet Adam a dû rencontrer au sein de sa tribu, de sa meute. Différent par une particularité physique ou morale, peut-être bien les deux, ça n’a pas dû être facile. Un paria. En fait, nous sommes tous les fils et les filles d’un paria, d’un laissé pour compte, d’un exclu.
Il faudrait alors remonter le cycle des espèces. Comme nous l’avons fait pour des générations d’humains, il faudrait croiser des générations d’espèces jusqu’à la cellule primaire. Là encore, elle ne s’est pas faite toute seule. Les atomes et les acides aminés étaient dès lors présents et se sont combinés par on ne sait quelle coïncidence. Tout cela nous amène jusqu’au Big Bang, le commencement de tous les commencements, le début ultime.
Nous sommes tous fils et filles du GRAND COMMENCEMENT. Employés, patrons, belges ou japonais, blancs ou noirs, prix Nobel de physique ou simple mollusque. Tout ce qui vit et toute la matière inanimée provient de la même énergie.
Gaspard Noël n’avait pas de père.
Vous allez me dire, avec un sourire entendu que, forcément, il en avait un. Soit. Biologiquement c’est aussi vrai que le soleil parcourt le ciel même lorsqu’il pleut.
Mais si je vous dis qu’il n’avait pas de père, c’est que pour lui, c’était une réalité.
En revanche, il avait deux mères. Cela peut avoir des avantages. Et son cortèges de complications.
Lorsqu’il vit le jour, Hélène comprit que ce petit bout de chou était un vrai cadeau et qu’il allait radicalement changer sa vie. Depuis neuf mois, il avait déjà changé la vie de Marie, sa compagne.
La plupart des femmes enceintes vous diront que c’est une expérience unique et magique. Un bonheur, une réalisation, un épanouissement.
Pour Marie ce fut l’enfer. Elle se sentit mal dès le premier mois de grossesse et, sans avoir passé de test ni vu un gynécologue ou son médecin habituel, elle savait que l’ovulation avait réussie.
Sa vie, alors, ne fut plus qu’une succession de nausées, de vomissements, de grande fatigue. Elle avait constamment un arrière goût dans la bouche, la gorge serrée et sèche, l’estomac incapable de garder la nourriture, le crane parfois enserré dans un étau et à d’autres moments l’esprit cotonneux et brumeux. Le fœtus faisait le difficile.
- Ca promet, soupira Hélène. Voilà qu’il nous em… avant même de naitre.
Marie ne disait rien. Elle souffrait en silence. Mais attendait comme une délivrance la fin de son calvaire.
Dans les bons romans comme dans les mauvais du reste, les jeunes femmes accouchent toujours au petit matin, après avoir passé une nuit à se tordre sur la table de travail. Un départ précipité vers la maternité en pleine nuit. L’arrivée en catastrophe dans le mauvais service, agrémenté de péripéties toujours épiques. Le moteur qui refuse de démarrer, les voisins absents, une crevaison, toutes les futures mamans qui ont décidé d’accoucher au même moment à la clinique…
Bref, un vrai roman.
Le lecteur sera peut-être désappointé mais je ne peux me résoudre à enrober la réalité dans d’épaisses fioritures.
Marie ressentit les premières contractions en pleine matinée. Hélène l’aida à s’allonger à moitié sur le siège basculé en position horizontale. Elle tourna la clé et le moteur de la vieille Volvo démarra au quart de tour. Les quatre pneus glissèrent sur l’asphalte sans rencontrer le moindre objet pointu ni s’échauffer plus que mesure. Si son pouls avait grimpé et sa tension sanguine de concert, Hélène n’en laissait rien paraitre et pilotait son convoi avec calme, s’arrêtant aux feux rouges et respectant la signalisation. Elle stoppa même pour laisser traverser une jeune femme et son landau.
Bon présage se dit-elle tandis que Marie souriait faiblement, affalée sur le siège passager, ne laissant échapper que quelques grimaces de douleur.
Elles entrèrent dans la cour de la maternité où un brancard les attendait avec un grand martiniquais à la carrure de rugbyman et une fille dont la silhouette était si fine qu’on l’aurait crue à peine pubère. Hélène avait réussi la prouesse de garder son calme et passer un coup de fil à la maternité avant de quitter l‘appartement, pour prévenir de leur arrivée imminente.
- Le papa n’a pas pu venir?
La sage femme n’attendait même pas la réponse.
- Non, le papa n’a pas pu venir, répondit machinalement Hélène, ajoutant, c’est le moins qu’on puisse dire.
La venue au monde d’un petit être est toujours un moment magique, gravé de singulières espérances. Une vie à la conquête du monde. Qu’allait être la vie de ce petit bout de chou qui gesticulait dans son petit berceau, la face toute fripée et les yeux fermés?
L’accouchement se déroula sans anicroche. Plus tard, Marie avouera que « ce n’était que ça? » d’un air rêveur. Elle avait tant souffert pendant toute sa grosses que les Dieux ou la providence lui avaient épargné des épreuves supplémentaires.
Quatre jours plus tard, Hélène conduisait la Volvo sur le chemin du retour. Sa pression sanguine était retombée et son pouls presque au repos.
Dès lors, la vie des deux jeunes femmes changea. C’est un truisme de le reconnaitre. Dans leur atome où deux électrons se tournaient autour depuis quelques années, était apparu un noyau qui allait équilibrer le ballet des particules.
Hélène regardait parfois le bébé, leur bébé, de longs instants en imaginant sa vie future. Quel bébé allait-il être? Quelles bêtises l’enfant allait-il leur servir? Quels soucis le futur adolescent les feraient passer des nuits aussi blanches que lorsqu’il faisait ses premières dents? Quel serait sa voie une fois adulte? Marquerait-il le monde de son empreinte? Ou resterait-il parmi la multitude anonyme? Serait-il à leurs petits soins lorsqu’elles seraient de vieilles dames? Et toutes ces joies, ces petits bonheurs qu’ils allaient partager. Des craintes, des angoisses, des déceptions aussi. Une foule d’anecdotes, de rencontres, un avenir. Une vie quoi!
- Tu vas nous en faire voir toi, hein. C’est bien vrai que tu vas nous en faire voir?
Un soir, le lendemain du retour de la clinique, allongées côte à côte dans leur grand lit, le berceau à portée de bras, Hélène dit d’une belle voix claire dans l’obscurité de la chambre.
- Il faudrait tenir une sorte de journal. Pour ne rien oublier.
Et c’est ainsi que naquit moins d’une semaine après son héros, le Livre de Gaspard.
Marie avait dégoté chez un vieux brocanteur une reliure digne des contes des mille et une nuits. Il ne resterait plus qu’à y disposer les différents cahiers qui allaient, au fil des années, suivre Gaspard comme la trace de sa vie sur terre. On y glissait tout ce qui avait marqué l’existence de l’enfant. Parfois on ne l’ouvrait pas pendant des semaines, à d’autres périodes, on y écrivait, dessinait, collait chaque jour.
Sur la première page, la photo du visage du bébé en très gros plan qu’avait immortalisé Hélène le jour même de l’accouchement. Venait ensuite deux médaillons représentant les deux mamans. Hélène avait ressorti son appareil à l’idée du journal et chacune avait photographié l’autre.
Les premières années, ce furent les mamans seulement qui annotèrent le Livre de Gaspard. Lorsqu’il saurait le manier, il en ferait ce qu’il voudrait jusqu’au jour où, sachant convenablement écrire, il deviendrait son jardin secret. Les mamans n’auraient plus droit au chapitre.
Il y eu beaucoup de photos et quelques dessins du bébé. Le détail du menu de son premier repas. Le mystère qui restera pour longtemps une énigme dans la famille: comment, alors qu’il n’avait pas quinze mois, bébé Gaspard avait pu escalader seul toutes les marches de l’escalier qui menait au grenier. Plus tard on y collerait sa première dent de lait, tombée sans qu’il ne s’en soit aperçu. Des anecdotes relatées sous l’écriture fine de Marie. Tous les croquis étaient d’elle, bien sûr.
Gaspard aurait pu tomber plus mal. Avoir une maman douée pour le dessin et une autre capable de raconter n’importe quel conte en jouant tous les personnages était le rêve de chaque enfant où le jeu et les histoires tiennent la part la plus importante, essentielle de leurs journées.
Gaspard annota son livre pour la première fois lors de son deuxième anniversaire. On avait organisé une petite fête. Des ballons de toutes les couleurs ornaient l’appartement. Hélène avait cuisiné le menu idéal de Gaspard: des raviolis à la ratatouille. Et une quantité de gâteaux tous plus appétissants les uns que les autres. On avait invité Marjolaine, accompagnée de ses parents qui n’étaient que les voisins d’en face. Il y avait Vladimir, le grand père d’Hélène et Caroline, une amie de Marie.
Gaspard souffla de toutes ses forces les deux bougies qui vacillaient sur le gros gâteau au chocolat.
Vladimir applaudit et porta un toast à la Russe.
Lorsque le verre éclata sur le sol, Gaspard se mit à pleurer et Hélène fronça les sourcils envers son grand-père.
- Vladimir! Je t’ai déjà dit qu’on ne casse pas la vaisselle ici!
- Ca porte bonheur, Ninotchka.
Il parlait avec un accent russe qu’il aurait perdu voilà bien des années s‘il n‘avait méticuleusement passé son temps à l’entretenir savamment.
- Pourquoi tu continues à rouler les R, Vladimir. Ca fait plus de cinquante ans que tu as quitté le pays.
- Et pourquoi pas? Ca plait aux jeunes femmes, si tu savais.
Et il reprenait d’un air vexé
- D’abord qui a dit que j’ai un accent. Je n’ai pas le moindre accent. Je parle comme un diplomate.
Cette dernière phrase était prononcée ostensiblement à la façon d’un président du conseil.
La peur de Gaspard disparue, on lui offrit une nouvelle page du Livre et il exécuta son premier dessin passé à postérité.
- Picasso n’a jamais dessiné des lignes aussi parfaites, s’exclama Vladimir.
Deux traits bleus barraient la feuille tandis qu’un cercle rouge voilé était recouvert d’un gribouillis jaune et vert.
De l’art moderne en somme.
Il y a de cela en commun entre nos premières années et le commencement de l’univers qu’il nous est impossible d’en garder une image. Avant que les photons ne s’échappent suite au Big Bang, tout reste dans le noir complet. La lumière est empêchée. C’est une loi physique contre laquelle on ne peut rien. Bien heureux qui peut se souvenir de ses premiers mois et, ce qui devrait être un souvenir indélébile gravé à tout jamais sur un cerveau presque vierge, la jour de notre naissance est à tout jamais perdu, exclu de nos souvenirs.
Le premier souvenir de Gaspard, lorsqu’on l’interrogera plus tard, ne sera pas ce jour d’anniversaire. Il sera même bien embêté de fixer une scène particulière, son Journal interférant avec sa propre mémoire. Contrairement à notre propre mémoire, sujette à de constantes variations, qui ressasse sans arrêt les souvenirs à la façon qu’un désert modifie ses dunes avec l’aide du vent. Notre cerveau réécrit sans cesse nos souvenirs et, en fonction de notre humeur et de nos expériences, il en modifie imperceptiblement le contenu comme un écrivain qui corrigerait inlassablement son œuvre.
A la façon que peut avoir un souvenir répété tant et tant de fois par les adultes qui l’ont partagé et qu’on s’approprie, ne sachant plus très bien ce qui relève du vécu ou du raconté, Gaspard s’emmêlera souvent dans sa mémoire, ne sachant pas bien discerner ceux dont il se rappelle en tant qu’acteur et tous les autres qu’il pouvait consulter à loisir et à tout moment dans son Journal. Les images et les dessins imprimés n’avaient plus le loisir de changer au gré des mois et des années qui apportaient une couche de sédiments mouvants. Les pages étaient mortes, contrairement à la mémoire qui était bien vivante et qui se repaissait sans arrêt d’un matériau au combien volatile. Devenu adulte, son journal, loin de l’aider, brouillait en réalité sa propre mémoire, il lui volait ses souvenirs en les ayant immortalisés définitivement. Ce qui aurait dû être des béquilles pour sa mémoire devenait des entraves, des chaines. Il lui était aussi difficile de convoquer un lointain souvenir que de se rappeler la première image du rêve de la nuit passée. Néanmoins, il semble que ces vacances au pied du Mont Blanc aient davantage marqué son esprit que les pages de son Journal.
Sur la dizaine de pages qui mentionnent ce séjour automnal, on peut y voir un dessin maladroit effectué par Gaspard lui-même, une série de photos, une fleur de rhododendron qui a perdu ses couleurs et quelques lignes de la main de Marie relatant les principaux événements survenus pendant cette parenthèse.
Le jeune Gaspard n’avait jamais quitté Paris, à peine le grand appartement qu’il avait maintenant largement apprivoisé. Ici, tout était nouveau pour lui.
Il est remarquable de constater que, plus on vieillit, plus il nous semble que le temps passe vite. Cela tient à la routine de nos vies. Loin de ralentir le temps qui passe, effectuer les mêmes gestes, vivre à l’identique chaque jour, enchainer les journées comme les grains d’un chapelet, sans aucune distinction entre eux, fausse nos repères et un mois s’est écoulé alors qu’il nous semble qu’il a commencé simplement la semaine dernière.
La confirmation de cette vérité tient dans les premiers jours de vacances que l’on prend loin de chez soi, en cassant nos habitudes. Un rythme de vie différent, un nouvel horizon, de nouvelles têtes, des activités inédites. Il n’en faut pas plus pour que les jours se différencient et deviennent ainsi uniques. Jusqu’à ce qu’une nouvelle routine se substitue à l’ancienne. Les premiers jours de villégiature nous semblent toujours s’étaler en longueur tandis que les ultimes journées passent comme un éclair.
Comptez le nombre de premières fois que vous expérimentez chaque jour. Il ne doit y en avoir plus guère. Chaque situation a déjà été vécue cent fois. Chacun de vos gestes exécuté des milliers de fois. Cela n’est plus une habitude mais devient un réflexe. Vos paroles ont été prononcé maintes et maintes fois à la manière d’un « bonjour, comment ça va? » machinal. Il arrive même un moment où le nouvel album de musique récemment sorti que vous écoutez vous semble emprunter des séquences à d’autres. Des mélodies, des arrangements, un refrain, des paroles interchangeables. Le film à succès que vous êtes allé voir propose quelques scènes filmées comme vous en avez déjà vu des dizaines. Vous avez reconnu le jeu de l’acteur principal, même si la dernière fois il incarnait un inspecteur de police et qu’il est maintenant un aventurier aux prises de la jungle inextricable. Vous décelez la même expression, le même regard, vous retrouvez le même accent, des mimiques identiques. Après tout c’est le même acteur. Et lorsqu’il s’agit de jeunes premiers, avec un brin d’entrainement, vous pourrez facilement reconnaitre la patte du metteur en scène sur le jeu de ses poulains.
Et cela se décline à l’infini. Le journal télévisé met en scène régulièrement les mêmes faits divers, des scandales analogues et des catastrophes similaires. Les discours des politiques sont intéressant de ce point de vue. A deux quinquennats de distance, les mêmes phrases, les mêmes tournures, les mêmes résolutions et les mêmes promesses. Un discours passe partout applicable à n’importe quelle situation.
Vous vous apercevez que le monde entier n’est qu’un éternel recommencement. Que la nouveauté n’est originale qu’en apparence.
Prenez maintenant un enfant qui découvre le monde. Il le voit pour la première fois. Toutes ces premières fois qui ne se renouvelleront jamais comme autant de bulles de savon qui s’évanouissent dans l’air. Comme les neurones perdus de notre cerveau qui, une fois l’adolescence passée, ne seront jamais remplacés. Les habitudes, la routine du quotidien, réduisent fatalement toutes ces premières fois. On devient blasé, insensible, indifférent. Et les jours, tous pareils, défilent au pas de course.
Ainsi lorsqu’on a cinq ans, un jour dure une semaine, une semaine, une année, un mois, toute une vie peut-être. Un an, on ne peut en voir le bout ni même l’imaginer puisqu’il s’agit de l’éternité.
Hélène et Marie avaient décidé de pique-niquer là-haut sur la montagne. La journée s’annonçait superbe. De petits nuages avaient parsemé un ciel si bleu qu’il en devenait presque noir lorsqu’on était à deux mille mètres.
Toute la chaine du Mont Blanc leur faisait face, éclatante de la blancheur de leurs glaciers. A ses pieds, Chamonix ronronnait dans les vapeurs polluantes, équivalant à une ville moyenne qui s’agitait les mois d’été et ceux d’hiver. Entre ces deux pics touristiques, ça se calmait à peine. On était début septembre et les rues de la capitale mondiale de l’alpinisme résonnaient de toutes les langues du monde.
Elles avaient utilisé la télécabine pour s’épargner la longue marche sous les mélèzes qui roussissaient au soleil d’automne. Elles étaient de vraies citadines, peu accoutumées à l’air vif des montagnes et aux dénivelés importants. Elles avaient même découvert plusieurs mots lors de leur séjour alpin.
Foehn. Qui les intriguait et à la consonance qui les amusait. Heureusement pour elles, elle n’eurent point à en subir les tourments qui reléguaient le Mistral à une brise d’été.
Trammousser. Dont elles avaient apprivoisé la douce sonorité et l’employaient en veux tu en voilà. Un vieux guide avait fait cette remarque lorsque le soleil jouait à disparaitre et reparaitre derrière les aiguilles déchiquetées.
Ar’vi pas. L’art de se saluer. Les jeunes de la vallée ne l’employaient cependant plus trop.
Tartiflette. Même au cœur de l’été, il n’est pas de savoyard qui ne se régale de ce plat digne des glaciales soirées d’hiver. Ce qui avait surpris Marie c’était le côté inoffensif du mot, sa terminaison qui le rangeait d’emblée dans la catégorie des diminutifs. Elle imaginait une fine portion de ces célèbres tartes flambées qui ont fait la renommée de l’Alsace. Lorsqu’elle vit arriver le plat encore bouillant et son reste de croûtes de reblochons qui remuaient sous la chaleur, une lave qui cachait une épaisse couche de pommes de terre soignée aux oignons frits et parsemés de lardons et d’autres ingrédients dont on gardait jalousement le secret, proposant le même plat différent d’une vallée à l’autre, d’une famille à sa voisine, elle comprit enfin qu’en cuisine aussi, l‘habit ne fait pas le moine.
Nant. A cause de l’accent encore prononcé dans ces hautes vallées, elles avaient cru d’abord que cela marquait le refus. Mais très vite, elles comprirent que cela désignait ces petits ruisseaux débonnaires et chantant qui égayaient les pâturages d’altitude et grondaient gentiment en traversant les sombres forêts de résineux. Elles ne les avaient pas connu débordant de colère au printemps, charriant des moellons de plusieurs tonnes.
Moraine. Une montagne dans la montagne. Ces éboulis où la végétation reprenait ses droits avaient été façonné par la puissance des glaciers depuis des milliers d’années. Le recul des monstres de glace les laissaient dorénavant dénudées comme d’énormes flancs de terre.
Dénivelé. Le seul mot qui les révulsait.
Le repas léger grignoté au milieu de tant de splendeur, elles s’étaient allongées sur l’herbe rase, dorant leur peau de parisienne au cruel soleil montagnard. Gaspard pouvait s’éloigner de quelques pas, le relief ici ne présentait pas de danger. Elles le surveillaient d’un œil, avant de s’assoupir la tête de l’une sur l’épaule de l’autre, un bras étendu sur le front et l’autre sur le ventre.
Ce terrain de jeu plaisait à Gaspard. A trois ans, il marchait « comme un grand » et commençait à explorer le monde qui l’entourait.
Nous sommes tous des Christophe Colomb. Nous reproduisons en accéléré toutes les évolutions de notre espèce. Dans nos premiers mois, nous recherchons la sécurité du giron maternel, qui n’est ni plus ni moins que le prolongement de nous-mêmes. Un cri, des pleurs la font rappliquer de la même façon que nous actionnons nos membres. Notre maman n’est qu’un de nos membres qui a un plus grand rayon d’action et des pouvoirs de super héros. Elle peut tout. Elle sait tout.
Il arrive cependant un moment où cela ne suffit plus. Nous partons alors à la découverte du vaste monde, c’est-à-dire un appartement situé au quatrième étage d’un grand immeuble parisien. Et c’est là que les ennuis commencent. Prenant davantage d’indépendance, on n’a pas encore conscience des responsabilités qui vont avec. Le dur retour à la réalité, par le biais d’une remontrance, d’un reproche, d’une réprimande, est cruel. Le premier « non » sonne comme un adieu, une déchirure. Adieu à cette vie douce où tout était permis, où l’on était le roi du monde, un vrai seigneur. Dès lors, il faut s’habituer à vivre en voyant ses desseins et ses souhaits contrecarrés sans cesse.
Toutefois le pire ne sont pas ces limites qui façonnent un homme, mais le regard désolé de nos parents lorsqu’ils ne savent ou ne peuvent plus répondre à nos attentes. Un « je ne sais pas » ruine toute la confiance qu’on avait dans ces Dieux qui avaient, jusqu’alors, réponse à tout. La désillusion est complète. Ainsi les parents ne savent pas tout? Ils sont ignorants de certaines choses? Un monde s’écroule. Celui de l’innocence et de la foi totale en ses géniteurs.
Un degré supplémentaire est atteint lorsqu’on s’aperçoit avec la plus grande horreur et un sale goût dans la bouche que nos parents nous ont menti. Et, avant cinq ans, il n’y a pas de petit mensonge. Ainsi nous n’avons pas l’apanage de ce subterfuge pour rivaliser avec les grands. Eux aussi l’utilisent. Et ne font que ça si on y réfléchit bien.
Il est bien dur de grandir.
En ce début d’après midi, Gaspard ne se posait pas toutes ces questions. Il gambadait sur l’alpage, parmi de lourdes pierres qui parsemaient l’herbe rare. Des fleurs avaient attiré son attention et, de chardon en pousses diverses, il s’était éloigné. Il n’était pas perdu, encore à portée de voix et jouait d’un rien comme savent le faire les enfants uniques.
Gaspard n’était pas un téméraire. Face à une nouveauté, il ne s’y précipitait jamais directement. Il avait la curiosité réfléchie des chats, qui observent longuement et non celle, fougueuse, d’un chien fou qui est tout à fait capable de fourrer sa truffe dans les piquants de la robe d‘un hérisson.
Cela avait remué à quelques mètres de lui. Instinctivement il s’était accroupi, de peur d’être vu sans penser une seconde que ses faits et gestes étaient épiés depuis le début.
L’animal pataud à la fourrure grisâtre semblait pacifique. Une sorte d’union entre un chat et un rat.
Il avança d’un pas. L’animal ne bougea pas. Se releva sur ses pattes arrières, comme au cirque. Il fit un pas supplémentaire. Contre toute attente alors qu’il pensait avoir effrayé l’animal, celui-ci avança timidement.
Le jeune humain et la vieille marmotte se jaugeaient, s’appréciaient, s’évaluaient. On ne détectait aucun danger ni d’un côté ni de l’autre. Pour l’un c’était une boule de poils bien marrante, pour l’autre un petit être innocent sans défense ni mauvaises intentions. Gaspard bénéficiait sans le savoir du calendrier favorable à cette rencontre du quatrième type. A la fin de l’été, les marmottes sont rendues moins méfiantes pour deux raisons immuables. D’une part, elles sentent l’hiver arriver et doivent se goinfrer pour amasser une belle couche de graisse qui les aidera à supporter le long sommeil hivernal ainsi que rentrer les foins et tapisser leur terrier douillet. D’autre part, ayant croisé quantité d’humains pendant toute la saison, elles savent que ce sont des créatures certes bruyantes et mal élevées mais aussi des alliés qui n’hésitent pas à leur procurer de la nourriture. Vraiment, il n’y a rien à craindre de ce côté-là, contrairement à l’aigle qui tournoie toujours haut dans le ciel et qu’on craint malgré les appels puissants de la sentinelle qui veille sur son promontoire.
La rencontre était inévitable. Lorsque Gaspard tendit sa main pour caresser son nouvel ami, celui-ci se raidit et recula de deux pattes, puis il avança vers les doigts tendus et se laissa caresser.
L’animal se révéla un excellent compagnon de jeu, n’hésitant pas à prendre l’initiative des roulades et des chatouilles. Marie et Hélène, dont leurs cris n’avaient pas alerté Gaspard bien que son compagnon les ait entendu, s’étaient rapprochées doucement, ayant entendu des bruits curieux.
Le tableau valait son prix. Gaspard jouait avec une énorme marmotte comme si cela avait été un chat ou un chiot. Ils se poursuivaient, roulaient dans l’herbe rase, se cachaient derrière les pierres chaudes, se bousculaient et il riait comme un petit fou, la marmotte étant plus économe de ce point de vue là.
Elles furent tellement ébahies qu’aucune ne pensa à immortaliser la scène par une photo. Ainsi il ne reste aucune preuve de cette union sacrée, excepté le premier souvenir dont Gaspard put longtemps se rappeler sans être contrarié par une preuve tangible collée dans son journal.
Il y eu un débat au sujet de l’école. Gaspard venait d’avoir cinq ans. Tout parent d’un enfant de nationalité française devait envoyer son rejeton dans une institution chère à Jules Ferry: l’école obligatoire et gratuite pour tous. Seulement Hélène et Marie avaient constaté depuis, eh bien depuis le début, que Gaspard portait sur le monde qui l’entourait un regard plutôt singulier. Il n’était pas comme les autres enfants. Ca, n’importe quel parent pourra vous l’affirmer en toute bonne foi: leur enfant n’est pas n’importe qui. Simplement, cela était vrai même d’un point de vue objectif.
Il ne réagissait pas là où l’on pensait et jamais dans le sens que l’on supputait. Il remarquait toujours les détails, s’intéressait aux arrières plans, ne se focalisait jamais sur la scène centrale mais était passionné par ses périphéries.
Les deux mamans eurent un doute. S’il avait prononcé son premier mot vers l’âge de deux ans, ce qui restait parfaitement dans la norme, il n’avait pas annoncé tout fièrement le désormais très célèbre « maman ». Ce qui retenait son attention au point d’en mentionner l’existence par le langage articulé était également un centre, un pivot autour duquel le monde s’organisait. Comme une mère.
C’était un matin comme tous les autres… Sauf pour Gaspard. Car nous l’avons déjà dit, chaque nouvelle journée apporte son lots de premières fois pour un enfant de vingt deux mois. Il y avait tant de choses à découvrir, à expérimenter, à tester, que l’ex-bébé sentait qu’une seule vie ne lui suffirait pas. Il lui fallait en vivre au moins sept. Neuf aurait été un tantinet prétentieux. On ne pouvait raisonnablement pas demander aux Dieux une faveur semblable à celle accordée à ces divinités armées de fourrures qui se prélassent toute la journée sur la couette, s’allongeant dans d’admirables étirements, recherchant les positions dominantes pour exercer leur impérial pouvoir. Dans la cervelle d’un chat, tout autre créature n’existe que pour demeurer à son service. Les moineaux pour jouer, les souris pour chasser, les chiens pour terroriser et les humains pour les servir.
Ce matin-là, quelques semaines après avoir vérifié les lois de Newton sur la gravité en laissant tomber divers objets d’une hauteur variable et de préférence constitués en partie ou en totalité de parties vulnérables et pour cela n’hésitant pas à escalader chaises et tables ou accéder au buffet qui présentait une vire étroite semblable à celles que les alpinistes rencontrent en haute montagne, où ils peuvent installer un bivouac de fortune. Les jours précédents, il avait découvert les propriétés magiques de l’élément liquide. L’eau qui surgissait d’un tuyau chromé avait sa préférence, mais il ne dédaignait pas non plus utiliser le liquide blanchâtre et visqueux qui dormait dans une grosse bouteille cachée sous l’évier. Il pataugeait dans le produit au doux parfum de pin et en mettait partout. Il n’avait pas encore saisit qu’à la place de ses genoux, il aurait dû utiliser une serpillière pour étaler la substance et recevoir les congratulations du jury à la place des foudres maternelles.
Elles s’étaient mises d’accord. Ce n’était pas la peine de le disputer toutes les deux de concert. Une fois c’était Marie, une autre c’était le tour d’Hélène. Il n’y avait pas de règle. Le primordial était de ne jamais laisser passer une bêtise non punie. A vrai dire, le mot punition n’était pas adapté pour qualifier les remontrances maternelles.
Partant du principe qu’un esprit éduqué valait mieux qu’un être mortifié bardé de scrupules et de honte, bientôt rempli de remords, de crainte et d’appréhension qui le briderait dans ses entreprises telle une bête aux abois ou, effet inverse de réprimandes régulières, le pousserait dans ses derniers retranchements en devenant un concours. A une bêtise correspondrait un sermon. L’excès en tout est contre productif. Marie le savait parfaitement.
Un « non! » retentissant avait la qualité de stopper net le petit Gaspard dans ses méfaits. Il tournait alors la tête dans la direction du mot paralysant avec les yeux comme des billes et l’air de l’innocent prit en flagrant délit le doigt dans le pot de confiture. Au début, elles se retenaient de pouffer devant un tel tableau. Gaspard donnait l’impression d’avoir été foudroyé dans son élan, ne sachant plus ni que faire ni se donner une contenance, à la manière de ses chiens d’arrêt qui, la patte levée et la queue droite, semblent immobilisés davantage dans leur intention que dans leur attitude.
Après ce « non! » dit d’une voix posée, non crié mais comme une réplique qui porte, au théâtre, s’en suivait une explication et des recommandations sur l’art de vivre en société et en particulier dans une famille réduite à sa plus simple expression: un enfant et deux mamans. Ce qui, somme toute pour Gaspard, était la normalité la plus évidente.
L’enfant écoutait sans faire aucun mouvement, paralysé par la foudre qui s’abattait subitement sur ses épaules. Et cela s’arrêtait là. Pas de punition, pas de mise au coin, pas de menaces, pas de mauvais traitement, qu’il soit d’origine physique, ce qui ne résout rien et laisse des traces ou psychologique, nettement plus pernicieux et ayant des répercussions souterraines invisibles durant des années.
Tant que les méfaits perpétrés par Gaspard relevaient de l’innocence de la jeunesse, de tentatives et d’expériences, le sermon était prononcé sur le même ton. Il n’y avait pas de hiérarchie dans l’art de la bêtise. Ne connaissant pas lui-même les degrés sur l’échelle des délits, un précieux vase chinois brisé lui valait le même discours qu’un simple verre ébréché.
En revanche, Gaspard eut à subir un crescendo comme on en rencontre dans les cours de justice, passé la prévention et le sursis.
Lorsqu’elles étaient bien assurées que Gaspard avait agit en connaissance de cause, par colère ou parce qu’il réitérait pour la énième fois la même erreur, la proportion de pédagogie baissait au profit de la sanction. C’est sur l’évaluation du châtiment que n’étaient pas toujours d’accord les deux femmes. Non qu’une était plus permissive et l’autre plus répressible mais leurs échelles de valeur différaient.
Ce matin-là donc, Gaspard allait expérimenter un exercice qui ne lui vaudrait aucune remontrance ni sentence. Depuis quelques jours déjà, ça le chatouillait d’une façon bizarre ou fond de la gorge. Quelque chose voulait sortir. Il en était le premier étonné, vu que jusqu’alors les substances y entraient plus qu’elles n’en sortaient.
Certains parents se désolent et voient le retour des repas avec une angoisse qui croît à mesure des difficultés rencontrées. Leur rejeton ne veut rien avaler. Impossible de lui proposer de nouveaux aliments afin d’éduquer son palais comme, plus tard, ils le gaveront de mots nouveaux et d’activités variées (« un enfant occupé est un enfant heureux et met toutes les chances de son côté pour réussir dans la vie« . Nous ne prendrons pas position sur ce sujet). Pour Gaspard, qui n’avait jamais été un furieux de l’allaitement au sein ni courant après les biberons, la découverte de vrais aliments avait été une révélation. Très vite, alors que le manque cruel de dents ne facilitait pas l’opération, il aimait grignoter des morceaux de nourriture à la place de cette bouillie informe mais qui avait au moins du goût et que ses mamans appelaient soupe. On peut aisément deviner que s’il avait eu l’usage de ses cordes vocales à cette époque, son premier mot aurait été zoup’. Mais dorénavant, la soupe était un lointain souvenir. Il arborait ses premières dents et savait les utiliser. Tout y passait, même le non comestible. Il avait une préférence pour le carton et le bois, mais ne rechignait pas à mastiquer des heures un bout de mousse ou déchiqueter un morceau de polystyrène. Hélène devait alors nettoyer la bouche de ces minuscules billes blanches au risque de se faire mordre les doigts. Toutefois et plus que tout, bien au-delà du magazine ou de la télécommande, du crayon à papier ou de la gomme, c’étaient les aliments qui avaient sa préférence.
Il expérimentait tout. Les parents des enfants difficiles auraient été d’une jalousie verte face à cet ogre d’à peine deux ans qui ne se contentait pas d’engloutir et d’avaler tous les aliments proposés, ils les grignotait, les mâchait de longues minutes, semblant éprouver un plaisir non dissimulé à malaxer de nouvelles nourritures dans sa bouche. Il prenait du plaisir à mastiquer les aliments, faire durer son plaisir du goût, allonger ce moment d’intense bonheur gustatif. Son plaisir était d’abord tactile. Il utilisait ses doigts.
Comme tous les enfants par ailleurs.
Donc, ce matin-là, quelque chose le titillait. Cela durait depuis plusieurs jours. Jusque là, il s’était parfaitement exprimé par pleurs, cris puis gestes et enfin quelques borborygmes plus ou moins bruyants. Mais il s’était aperçu au fil des mois que ses mamans le comprenaient mal parfois, voire pas du tout. Cela avait le don de l’énerver. Il se rendait compte qu’elles s’exprimaient par gestes et mimiques, tout comme lui, mais elles utilisaient un autre répertoire, fait de sons articulés qui produisaient une musique à ses oreilles, spécialement le soir lorsque Hélène venait lui raconter une histoire en modulant sa voix et jouant tous les personnages du conte. C’était une virtuose de la parole. Marie se contentait de parler comme n’importe quel autre adulte. Sa voix était douce et claire mais ce qui enchantait Gaspard c’était d’écouter Hélène. Lorsqu’elle s’adressait à lui, il devenait sage comme une image.
Il aurait bien aimé lui ressembler. Pouvoir changer sa voix à volonté. Encore eut-il fallu qu’il la trouve, sa voix. Les gargouillis qu’il produisait, s’ils éveillaient la curiosité de ses mamans, n’avaient pas la puissance du vrai langage qui peut capter l’attention d’une ou plusieurs personnes et même, Gaspard l’apprendrait plus tard, d’une assemblée, d’une foule, de millions de gens.
- Zoleil!
Hélène et Marie se retournèrent de concert. Gaspard était aussi étonné qu’elles. Comment avait-il fait? Comment recommencer? Il essaya encore. Rien ne se passa comme voulu. L’air venait de ses poumons, il sentait vibrer ses cordes vocales, mais le son n’avait rien n’abouti. Il s’exerça encore et encore. Il arriva à répéter cet unique premier mot.
- Zoleil!
Ses deux mamans étaient déjà autour de lui. Il était assis sur la couverture imprimée de nounours, celle qu’il préférait, et un beau rayon de soleil traversait la baie vitrée et venait mourir sur lui, réchauffant sa peau.
Passé les premiers moments de surprise, Marie dut se faire une raison. Le premier mot prononcé par son fils ne la désignerait pas, comme dans cinquante pour cent des cas (les cinquante restant étant attribués au papa). D’un sens, ce n’était pas plus mal, puisque ici, maman pouvait désigner aussi bien l’une que l’autre. Cela posé, rien d’étonnant que le mot maman ne vienne pas à l’esprit du garçonnet puisque ses parents ne se nommaient devant lui et pour lui que par leurs prénoms. S’il n’avait pas de père, Gaspard n’en avait pas plus de mère. Il sentait confusément l’amour maternel venant aussi bien de l’une que de l’autre, d’une manière différente, puisque chaque personne est unique au monde. Sans reproduire le schéma papa-maman des autres familles dites équilibrées, Hélène maintenait une certaine distance même si les deux femmes s’occupaient alternativement de lui.
Pour Gaspard, il apparaissait que le plus important sur cette terre se situait à quelques dizaines de millions de kilomètres. Apprécions déjà l’extrême entendement de ce bambin d’à peine deux ans qui avait compris que sans le soleil, aucune vie n’existerait.
On en ferait un scientifique réputé ou un grand philosophe.
En remplaçant systématiquement le S par le Z, Gaspard développa son amour des mots. Tout comme il prenait un grand plaisir à ingurgiter les aliments nouveaux, il se gargarisait de nouveaux sons.
Est-ce le résultat de n’avoir jamais employé de diminutifs à son endroit ou de ne jamais lui avoir parlé bébé ou comme à un jeune chiot, ou bien la recherche de la perfection dès deux ans, Gaspard allait utiliser des mots trop compliqué pour son larynx encore neuf et mal dégauchi. Photographie, atmosphère, croquemitaine, escarmouche, éclaboussure, hallucination, gourmandise, rocambolesque, saltimbanque, tergiverser, tintinnabule.
- Mais où va-t-il chercher tout ça? C’est pas possible. Je n’ai jamais prononcé tintinnabule. C’est toi, Hélène, qui lui a mis ça dans la tête.
- Peuh, surement pas!
- Dis donc, qui lui a raconté le Petit Chaperon Rouge hier soir?
- Le mot n’existe pas dans le conte.
- Zevillette!
Les deux femmes se regardèrent, éberluées. Tandis que Marie regardait fixement Gaspard qui arborait un air joyeux et répétait à l’envi son nouveau mot, Hélène était allé chercher le conte de Perrault. Elles parcoururent ensemble les quelques dizaines de pages. Elles ne trouvèrent pas la trace de tintinnabulement où que ce soit. En revanche chevillette apparaissait à deux reprises.
- Alors? Fit Hélène en redressant les épaules.
Gaspard observait ses deux mamans avec attention. Il frappa dans ses mains et se mit à gazouiller.
- Réflexion faite, ce ne sera ni un scientifique ni un philosophe mais un poète.
- Ou un clown, déclara Marie, l’air abattu.
Elles se firent une raison. Gaspard se révélait avoir un regard original sur ce qui l’entourait. Il voyait les détails que personne ne remarque et les choses sous un angle bien particulier.
C’est avant tout cela qui avait amené le débat autour de l’école.
- On ne l’a pas envoyé en maternelle, je ne vois pas pourquoi on irait le trimballer à l’école.
- Mais c’est obligatoire, Hélène!
- Mouais, eh bien je connais plusieurs parents qui pourvoient à l’éducation de leurs enfants.
- Tu me parles de diplomates ou d’agrégés qui voyagent sans arrêt et ont tous un précepteur à domicile.
- Tu as une licence d’histoire et reprendre des études m’a toujours intéressée. Je pourrais m’y remettre en l’accompagnant. Ce serait un vrai défi, non? En plus, on a du temps à revendre.
- Tu ne trouves pas qu’il est déjà suffisamment asocial comme ça?
- Quoi? Gaspard asocial? Tu plaisantes! Il n’y a pas plus ouvert que lui, toujours de bonne humeur et d’une politesse à faire pâlir d’envie un collège de bonnes sœurs.
- Oui, en tout cas, on doit prendre une décision sans tarder. Il y a surement des démarches, une dérogation à obtenir. Ca ne sera pas facile.
Les deux femmes regardaient par la baie vitrée une pluie anachronique: on était fin Juin! Marie conclut la discussion en formulant la seule vraie question qui vaille d’être posée.
- Et si on demandait son avis à l’intéressé?
Comme on pouvait s‘y attendre, Gaspard était enjoué à l’idée d’expérimenter quelque chose de neuf. Dès lors qu’elles lui parlèrent du concept assez vague en soi de l’école, il n’eut plus que ce mot à la bouche.
Tout lui paraissait magique. Il s’enthousiasmait assez facilement. Quand, fin Aout, on lui mit dans les mains les fournitures de base, une paire de crayons, une gomme, un cahier, une trousse pour ranger le tout, il était fou de joie et s’impatientait du jour de la rentrée.
A part la trousse, aux couleurs vertigineuses, tout le reste lui était absolument familier mais, au fond de lui, il subodorait un usage différent là-bas, dans la grande école.
Marie l’avait mis au dessin très tôt. Pendant qu’elle croquait de nouveaux concepts, il l’accompagnait avec maladresse et puis, très vite, il avait trouvé son style. Il semblait que, comme certains mélomanes ont l’oreille absolue, il possédait l’art de mêler les couleurs.
- Le graphisme, les formes, on s’en fout. C’est la composition chromatique qui compte, assénait Marie, en connaissance de cause.
Après sa licence d’Histoire portant sur l’art gothique comparé à l’art roman, elle s’était plongée dans sa grande passion: le dessin. Depuis toute gamine, elle croquait sans arrêt. Sur les nappes en papier des restaurants, sur d’immenses cahiers, au dos de tout ce qui lui tombait sous la main: tickets de caisse, enveloppes ou dans les marges de n’importe quel document. Pour tuer le temps lors d’interminables rendez-vous avec l’administration ou un spécialiste du corps médical, dans les transports en commun, à chaque instant de libre et dès que l’ennui pointait son nez.
Elle avait envoyé ses esquisses aux principaux quotidiens nationaux et régionaux, avait proposé ses services à une foule de magazines, avec plus ou moins de bonheur, de succès. Puis il y avait eu ce croquis tout simple et tout bête. Une planète d’où s’épanouissait une belle fleur au bout d’une tige à deux feuilles. Une grande compagnie de gaz l’avait retenu pour illustrer son désir de sauvegarder la planète, contrebalançant la mauvaise image qu’elle avait dans l’esprit du public. Cela avait été une sacrée bonne affaire puisque le nouveau logo les avait remis à flot dans le cœur des gens sans les ruiner. Pour son premier dessin vendu, Marie était toute étonnée du montant du chèque, candeur de la débutante puisqu’il valait au moins cinquante fois plus. Mais cela avait boosté son Cv et déclenché une réaction en chaine.
Aujourd’hui, elle travaillait sur une idée pour décorer une future bouteille d’eau minérale. Cela se résumait à un seul terme: pureté. Entre temps, elle avait habillé quantité de grandes marques, toujours à la recherche du bon logo, du petit dessin qui faisait mouche. En dix ans, elle était arrivée à un statut de respectabilité où elle n’avait plus à démarcher de nouveaux clients. On venait vers elle. L’an passé, elle avait réussi à illustrer un superbe conte pour enfants, écrit par la star du roman policier qui appliquait ses recettes de maitre du suspens aux petites têtes blondes. Ca avait cassé la baraque. Le texte gentiment effrayant se mariait à la perfection avec la patte de Marie: simplicité et efficacité.