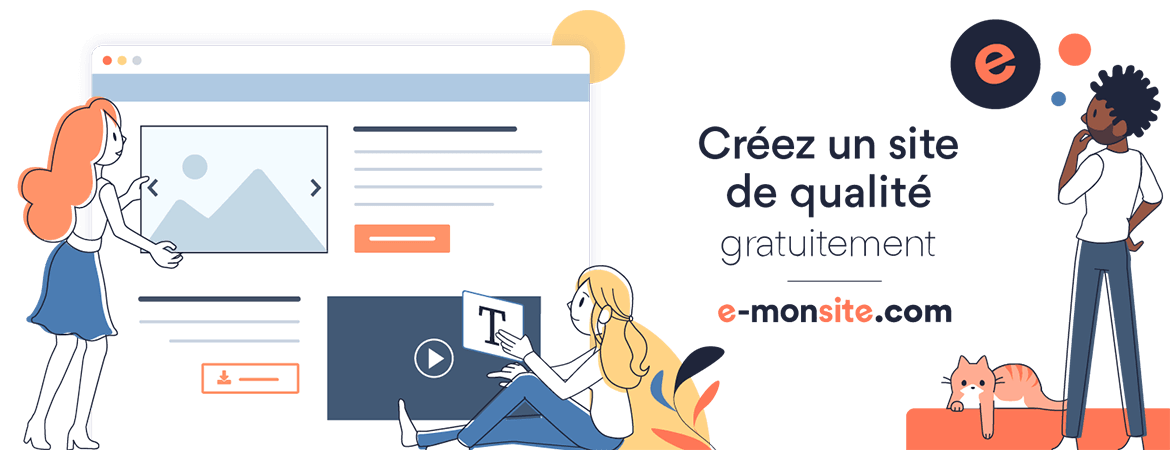le Violon de Noël
le Violon de Noël
L'odeur des croissants chauds est le plus efficace des réveils-matin.
La fillette s'étira comme un jeune chaton sous la couette encore toute chaude d'une nuit encombrée de rêves merveilleux. C'est papa qui lui avait apprit ça : toujours étirer ses jambes et ses bras au petit matin. Se tortillonner dans tous les sens. Ca met en forme pour le restant de la journée. Cependant, ce matin, nul besoin d'étirements ni d'autre source de motivation : la journée allait, forcément, être magnifique.
Il y avait ainsi trois ou quatre journées qui, systématiquement, par leur essence même, s'annonçaient dès l'aube comme des petits bonheurs.
Il y avait le jour du grand départ en vacances. Savoir qu'on allait voyager, partir, voir d'autres lieux, croiser d'autres personnes. Et puis le soleil, plus de contraintes. Un pas de côté dans l'existence. Un.
Son anniversaire, bien sûr. Ce jour là, on était aux petits soins pour elle. Maman cuisinait son repas préféré : une simple salade de crudités, des lasagnes au saumon et puis il y aurait un gros gâteau au chocolat avec de la meringue et de la chantilly dessus. Deux.
Le dernier jour d'école. Elle n'aimait pas l'école. Devoir être enfermée même les jours les plus beaux. Ânonner des tables de multiplication ou des règles de grammaire dont elle n'imaginait pas bien l'utilité, cette odeur de craie et d'éponge mouillée, les jeux brutaux des garçons dans la cour, la médisance des filles sous le préau. Elle se réjouissait d'une liberté retrouvée, fin Juin, quand les jours débordaient sur la nuit – juste l'inverse de ce jour-ci, qui était sûrement le plus beau, le plus intense, le plus magique. Trois.
Des bruits en provenance de la cuisine.
Elle se leva. Il faisait agréablement frais dans la chambre. Encore un précepte de papa : toujours entrouvrir la fenêtre pour qu'il règne une fraîcheur aidant à faire de jolis rêves. Cette nuit pourtant, la fenêtre était restée close. Il y avait du givre sur les carreaux, empêchant de distinguer dehors les lumières de la ville ou les étoiles dans le ciel. Elle aimait contempler les étoiles. Elle s'imaginait que, là bas au fin fond de l'univers, une autre petite fille regardait dans sa direction et pensait la même chose qu'elle. Un double, comme une sœur qu'elle n'avait pas.
Elle ouvra la croisée. Aussitôt une vague d'air froid s'engouffra et la gifla comme le jour où tante Aline l'avait fait parce qu'elle avait fait une grosse bêtise – elle ne se souvenait plus laquelle. Elle se rappelait juste que papa avait fait les gros yeux. Pas à elle, mais à tata Aline. Il avait ajouté : « quand on frappe quelqu'un, c'est qu'on est incapable d'utiliser les mots ».
Elle referma très vite la fenêtre et ne pensa même pas à retrouver la grande ourse dans le ciel. C'est encore papa qui lui racontait la voie lactée les belles nuits de l'été. Parfois, au début Août, on pouvait voir les étoiles filantes. Au début, elle n'en voyait jamais aucune. « Parce que tu regardes dans toutes les directions à la fois. Concentre-toi sur une seule partie du ciel, sans bouger ». Encore un conseil de papa. Et là, elle avait commencé à voir une première lumière qui s'évanouit aussitôt. Puis une seconde, à peine plus lumineuse. Puis une troisième et plein d'autres, parfois zébrant la moitié du ciel, se croisant. Papa lui avait expliqué que ce n'étaient pas de véritables étoiles, juste des gros cailloux qui brûlaient en traversant la couche d'air de l'atmosphère. Cela l'avait profondément troublée. Que l'air, pourtant insaisissable, puisse faire brûler des pierres – et encore des pierres de fer !
Elle chaussa ses pantoufles, d'authentiques après-skis qui lui faisaient des pattes d'éléphant. Elle s'avança vers la cuisine, refrénant sa terrible envie de se rendre directement au salon. C'était maman qui lui avait bien appris que la première chose à faire, en se levant le matin, est de souhaiter une bonne journée aux personnes qui vivent sous le même toit. Cela commençait par papa et maman, mais aussi n'importe qui d'autre, même si elle la connaissait à peine. En vacances, chez des amis, au camping, à l'hôtel. Les gens étaient la plupart du temps agréablement étonnés qu'une petite fille de cinq ans leur dise bonjour tout de go. S'en suivait alors un large sourire et un début de conversation mondaine qui commençait invariablement par comment tu t'appelles ? Plus tard, ayant vu les Enfants du Paradis avec Arletty, elle rétorquera dans un sourire malicieux qu'elle ne s'appelait jamais puisqu'elle était toujours là, en sa compagnie, mais que les autres lui donnaient un prénom fêté sur le calendrier le cinq Avril.
Papa, affublé de ce pyjama qu'elle aimait tant, celui imprimé d'oursons, buvait un grand bol de café noir. Elle avait essayé d'en avaler une gorgée, un jour. Elle n'avait pas pu s'empêcher de recracher la première gorgée dans l'évier tellement c'était amer et astringent. Papa avait rit en ajoutant « j'espère que, plus tard, tu n'en raffoleras pas ». Elle n'avait pas compris pourquoi papa – et plus généralement tous les gens – ingurgitaient des choses qu'ils n'aimaient pas, du moins qui visiblement étaient mauvaises pour leur santé. Maman avait ajouté, pour enfoncer le clou : « tu devrais prendre exemple sur ta fille ».
Elle ne se souvenait pas d'avoir bu autre chose qu'un large bol de chocolat chaud. Il paraît que les souvenirs d'avant nos quatre ans s'effacent. Probablement. Elle était incapable de faire remonter à la surface des souvenirs plus anciens que son entrée à l'école.
Préparer le breuvage matinal était tout un rituel. D'abord verser le lait dans la casserole, faire chauffer à gros feu en délayant deux cuillerées de poudre savamment dosée : deux tiers de cacao non sucré et une de Nesquick, afin de rendre la mixture assimilable par le lait sans provoquer de grumeaux. Enfin, ajouter une pincée de cannelle. Lorsque le lait commençait à bouillir, réduire le feu et faire mijoter au moins trois bonnes minutes. C'était la seule manière de révéler les arômes du chocolat.
Ce rituel était immanquable. Une journée ne pouvait démarrer autrement. Même ce matin, tiraillée entre l'irrésistible envie d'aller voir sous le sapin et celle de rester autour de la table, en famille, comme tous les matins. Elle dut prendre sur elle, tout en sirotant son bol et croquant dans de belles tartines de confiture d'abricot et myrtilles. D'habitude, elle s'ingéniait à peindre d'éphémères tableaux avec, en guise de pigments, la gelée de groseilles, la confiture de pêche ou bien celle de poires. Là, elle se dépêchait d'en finir au plus vite.
Si la cuisine n'arborait que quelques guirlandes et lampions aux couleurs de Noël, vert et rouge, le salon était vraiment magique, les carreaux des fenêtres ornés de gel désormais, simple contribution de la nature à l'ensemble. Des guirlandes de pantins multicolores qu'elle et maman avaient découpés sagement au moment de la Saint Nicolas tandis que papa allait chercher un petit sapin dans la forêt. Il revenait, des piquants d'aiguilles sur les épaules et dans les cheveux, tout sourire, tenant un sapin chétif et biscornu sous son bras.
Il prétendait qu'il ne fallait pas prélever de beaux spécimens qui allaient grandir et donner des arbres sains et vigoureux. Un petit arbre malingre ferait parfaitement l'affaire une fois décoré. Le reste de l'après-midi se déroulait en habillant le maigre sapin aux branches déformées. On endimanchait ce Quasimodo sylvestre en y accrochant des boules, des cœurs en cage, des pompons, des petits personnages découpés dans du papier ou façonnés en pâte à modeler. Le lendemain, une couronne de Noël était tressée puis agrémentée de pommes de pin, de branches de houx et de gui. On l'accrochait à la porte d'entrée et la maison était prête à fêter les réjouissances de fin d'année.
Au mur situé à côté du sapin juste illuminé par ces artifices fait-maison (pas de guirlande électrique ni de bougies), une sorte de semainier contenant vingt et une cases que l'on ouvrait à la manière d'une maison de poupée. A l'intérieur, un chocolat, un bonbon, une clémentine, un nougat ou encore ces fameux bredele, petits sablés venus d'Alsace, qu'elle fabriquait avec de la farine, du sucre, du beurre, des œufs et surtout les nombreuses et indispensables épices dont il ne fallait absolument pas toucher le reste de l'année – sauf si maman le demandait pour relever un plat.
Elle adorait faire la cuisine avec maman les matins du week-end. Les autres jours, maman partait travailler tôt le matin et papa l'accompagnait à son école.
Le salon resplendissait de compositions aux papiers de toutes les couleurs, parfois scintillant dans la douce lumière du matin. Le soleil allait bientôt se lever par dessus les brumes qui annonçaient une belle journée à venir.
Elle s'avança d'un pas décidé puis, comme retenue par une émotion nouvelle, elle ralentit à l'approche du petit sapin qui supportait aussi bien ses décorations qu'un mendiant aurait exhibé de somptueux habits, une vieille sorcière en habits de gala. Elle s'agenouilla devant les branches basses. Il y avait plusieurs paquets enrobés de couleurs chatoyantes. Déjà l'emballage était superbe. Elle ne savait lequel ouvrir en premier. Il y a les prénoms dessus, indiqua maman. Le père Noël ne voudrait pas qu'on se trompe de cadeau, n'est-ce pas ? Elle hocha la tête, solennellement.
Elle eut une pensée pour ce personnage si mystérieux.
On ne le voyait jamais et pourtant il était toujours là. On sentait sa présence. Pas celle de ses nombreux clones qui battaient le pavé devant les magasins depuis deux semaines, désirant se prendre en photo avec les enfants éblouis. Elle, elle savait bien que ce n'étaient que des faux père Noël. Un jour, elle avait reconnu le voisin chômeur sous sa barbe mal fixée et son bonnet qui laissait passer les boucles de sa chevelure rousse.
Non, le père Noël, le vrai, était une abstraction. Même pas sûr que ce soit lui et lui seul qui parvienne à distribuer tous les cadeaux au pied des arbres de chaque maison. Il devait forcément déléguer ou stopper le temps comme dans les théories abracadabrantes du grand Albert – qu'elle ne comprenait pas vraiment, du reste. Ses parents lui avaient bien expliqué que dans les deux tiers du monde, les enfants ne connaissaient pas ce bonhomme si mystérieux. Eux ne fêtaient pas Noël. Du moins, pas comme nous. Elle savait bien aussi que, dans le monde, il existait des petits enfants qui avaient beaucoup moins de chance qu'elle. Que leur Noël se résumait à pouvoir manger ou même boire un verre d'eau chaque jour. Qu'il y avait des guerres encore, un peu partout dans les lointains pays. Que certains enfants de son âge travaillaient déjà pour gagner une vie de misère. Que tout n'était pas si beau ni idéal, que les dessins animés de la télé étaient de purs divertissements comme lorsqu'on raconte un conte ou une légende dans les livres.
Le père Noël existait pour qui y croyait. Et elle y croyait dur comme fer. Quel prodige qu'un singulier bonhomme puisse deviner ce qu'elle désirait le plus au monde ? Et ça marchait tous les ans. Elle trouvait au pied du sapin ce qu'elle convoitait le plus au monde... sans même l'exprimer clairement. Il y avait eu cette poupée magnifique aux cheveux d'or et à la robe fleurie qu'elle admirait quand elle accompagnait maman au marché du quartier le Dimanche matin. Elle trônait dans la vitrine d'un magasin d'habillement, même pas un magasin de jouets. Elle n'était sûrement pas à vendre – juste un objet de décoration. Alors comment ses parents auraient-ils pu la lui acheter, comme le prétendait cet abruti de Guillaume, un grand dadais de CM1 qui croyait tout savoir et, en fait, ne savait rien du tout, à part ce que lui racontait ses parents ou, pire, les journalistes cravatés de la télévision. Lui prétendait que le Père Noël était employé par la firme Coca-Cola et que c'étaient les parents qui achetaient les jouets dans les grands magasins de la zone commerciale.
L'an passé, au pied du sapin, elle avait découvert une panoplie complète pour apprendre à dessiner et peindre. Crayons, gommes, gouaches, tubes de peinture et toute une gamme de pinceaux différents. Elle avait été éblouie. Et cet article, si elle l'avait rêvé, elle ne l'avait jamais vu nulle part. Alors, comment expliquer qu'il puisse se trouver là, au pied du sapin, si ce n'est reconnaître que le père Noël était bien réel d'une certaine façon. Il ne se matérialisait pas comme la plupart des hommes, c'est tout. Elle sentait bien que dans l'univers, les lois physiques immuables permettaient parfois des incongruités de ce genre. Ce n'était pas incompatible avec les théories du célèbre Albert.
Elle avait eu un coup de cœur pour le physicien en cours d'année, même si elle ne comprenait pas bien (encore) ce qu'il voulait dire.
Un petit paquet portait le prénom de maman, un plus imposant celui de papa et, entre les deux, un rectangle un peu allongé, le sien. Elle se souvenait des dimensions de sa poupée. Il était à peine plus grand. Père Noël se serait-il trompé pour la première fois de sa vie ? Une nouvelle poupée, plus grande, plus sophistiquée ? Bien sûr, cela lui aurait fait plaisir, mais ne la prenait-on pas encore pour un bébé à vouloir lui offrir une simple poupée ? Peut-être d'autres accessoires pour le dessin et la peinture ? Non, en cours d'année, on avait remplacé les tubes vides, on avait ajouté des ustensiles, du papier – ça, c'était le rôle des parents ; ils assuraient le service après vente, c'est tout... Restait le grand Albert. Un télescope pour pouvoir observer le ciel, bien sûr ! Seulement, papa lui avait confié qu'elle était encore trop petite pour bien profiter de la pensée du grand homme – la majorité des adultes, et pas des plus stupides, ne le comprennent pas eux-mêmes ! Mais vouloir observer les étoiles ne demande pas une si grande intelligence ni d'avoir fait de longues années d'étude. Cela viendrait en son temps.
Toutefois, une lunette d'astronome aurait demandé un paquet beaucoup plus long mais moins large.
Il ne restait alors qu'une seule solution. Elle savait déjà, avant d'ouvrir le paquet, qu'il contenait ce qu'elle désirait le plus au monde. Et ça, c'était bien la magie du père Noël. La preuve éclatante qu'il existait et qu'il devinait tout, jusqu'à nos moindres tentations.
Nous étions à la fin de l'hiver. Elle s'en souvient comme si la scène s'était déroulée hier. Du reste, elle s'en souviendrait toute sa vie. Forcément.
Il avait encore neigé, une dernière fois, à peine, comme si les nuages se retenaient, juste une belle averse et déjà les flocons accumulés au sol commençaient à fondre et se muer en cette maudite boue qui n'avait plus rien d'immaculée. Elle tenait fermement la main de sa tante, tata Aline. On lui avait précisément recommandé de ne jamais lâcher la main de qui l'accompagnait quand elle devait prendre le métro. Elle aimait bien s'engouffrer sous terre pour émerger quelques quartiers plus loin. Il y avait comme une sorte de magie, comme elle le découvrira plus tard, en lisant les aventures de ce jeune sorcier qui avait son âge au fil des livres lus (un par an, à partir de ses neuf ans). Eux détenaient de vrais pouvoirs, notamment celui d'être capable de se déplacer d'un endroit à un autre sans bouger. Cela l'avait fascinée, un peu comme de monter dans une rame de métro et, quasiment aussitôt, se retrouver beaucoup plus loin, sans avoir eu l'impression de voyager puisque tout le trajet s'effectuait dans le noir. Elle aimait moins quand le train devenait aérien : là, c'était comme le bus.
La forte odeur de caoutchouc moisi, de pneu pourri, d'air mal brassé et parfois d'autres effluves pas très ragoûtantes, ne la dérangeait pas. Elle était descendue à la station Opéra, tenant fermement la main de tata Aline. Dès le premier couloir, elle perçut la mélodie. Quelque chose de ténu, comme parvenant d'un puits profond. On ne pouvait déterminer d'où cela provenait. Elles avaient viré à gauche, puis à droite avant de descendre encore une volée de marches. Le bruit s'était mué en son, avait gagné en intensité. Maintenant on entendait parfaitement les harmonies. C'était un son agréable. De la musique. Plus elle s'approchait, plus les notes se révélaient. Un violon. Un dernier virage et là, au croisement de couloirs, un monsieur se tenait debout devant l'emballage de son violon posé sur une petite chaise pliante. Sûrement servant de réceptacle pour l'obole faussement demandée. Elle stoppa et sentit la main, puis le bras de tata Aline se tendre. Elle voulait rester jusqu'à la fin de la chanson. Visiblement tata Aline n'était pas bouleversée par la mélodie qui s'échappait des cordes sur lesquelles l'archet allait et venait dans un mouvement perpétuel qui faisait naître de l'émotion. Quelque chose battit plus fort dans son cœur.
Tata Aline voulait s'en aller, prétextant un retard. Elle n'en démordait pas. C'était si beau. Finalement, on trouva un accord, un compromis comme lors de ces négociations à n'en plus finir entre les dirigeants de grands pays industrialisés sur des questions obscures. Tata Aline allait faire sa si précieuse course qui ne pouvait attendre. Elle en aurait pour une demi-heure au maximum, c'était vraiment important. Elle restait là, hein ? Bien sagement à l'attendre en écoutant le... le... enfin le... « Monsieur ». Elle entendit distinctement les guillemets au ton qu'employa tata Aline. Pourquoi ne pas l'avoir nommé directement le musicien ?
Oui, c'était bien un musicien puisqu'il jouait de la musique. Et très belle en plus, cette musique. Oh, bien sûr, il n'était pas vêtu d'une redingote et d'un nœud papillon comme les solistes qui se produisaient sur les plus grandes scènes du monde. Il portait un gilet en piteux état, son jean était troué à plusieurs endroits, ses ongles étaient sales et ses cheveux gras pendaient le long de son visage. Son regard semblait regarder à l'intérieur de lui même, comme pour y trouver les notes car il n'avait pas non plus de partition sur un pupitre posé devant lui comme dans les grands concerts diffusés à la télévision.
Elle jeta un rapide coup d'oeil dans l'étui ouvert sur la chaise pliante : quatre ou cinq piécettes seulement. Mais surtout, aucun passant ne s'arrêtait. Au mieux, ils ralentissaient, jetaient un coup d'oeil sur le musicien et dès qu'ils voyaient son accoutrement, ils repartaient de plus belle. Comme si son apparence contribuait à son talent.
Comme si l'habit faisait nécessairement le moine. Elle ne le voyait pas. Elle l'écoutait. Et c'était beau.
Les passants continuaient leur chemin, parfois même avec un regard de mépris, de suffisance, d'arrogance, une supériorité qui émanait la plupart du temps des gens les mieux habillés. Elle comprit qu'ils le jugeaient non pas sur sa musique mais sur ses vêtements. Elle continuait de l'écouter. Il jouait maintenant une autre mélodie, plus douce, plus calme. L'archet glissait tendrement sur les cordes et envoyait des notes nouvelles, qu'elle n'avait jamais entendues. Et cela résonnait non plus dans ses oreilles ou dans sa tête, mais dans son cœur. Au morceau suivant, une mélopée écrite par un certain Wolfgang Amadeus, mais à ce moment elle n'en savait rien, cela résonna jusque dans son ventre. Le musicien débraillé ne jouait plus avec les cordes de son violon mais bien avec ses tripes à elle. Quelque chose se transmettait. Directement de lui à elle. A aucun moment, il ne l'avait regardée. Toujours plongé dans son monde à lui, il parvenait tout de même à donner ce qu'il y a de plus beau au monde : le talent. C'est à dire l'Amour en quelque sorte.
Elle se sentit s'élever, devenir meilleure. Et cette sensation pure, à cet instant, dans ce couloir de métro nauséabond, au milieu des passants qui allaient et venaient sans ralentir, aller changer sa vie. Il y eut bien deux ou trois personnes qui s'arrêtèrent le temps de reprendre leur souffle. Elle nota même qu'une petite dame fit glisser une pièce d'un euro discrètement.
Le musicien n'avait pas d'âge. Ses traits étaient creusés prématurément. Il pouvait avoir les soixante ans qu'il paraissait tout comme dix, vingt ou même trente ans de moins. La vie se charge de faire vieillir certains indigents plus vite que d'autres, privilégiés. Il entama un morceau plus vif, allègre, et son archet sembla un moment virevolter. Ce n'était plus sa main gauche qui le tenait, c'était la main de Dieu.
Elle ne l'avait pas vu venir. Il se tenait juste derrière elle. Lorsqu'il se pencha à son oreille et chuchota à mi voix « c'est beau, n'est-ce pas ? », elle se retourna vivement.
Un vieux monsieur, long comme une tige desséchée, dans un manteau élimé bien trop grand pour lui. Il portait un vieux chapeau qui lui ombrait un peu le visage d'où ne semblait émerger qu'un long nez recourbé. S'il avait été une femme, elle aurait cru à une sorcière tout droit échappée des contes que maman lui lisait le soir quand elle était petite. Qu'elle lui lisait encore, il faut le reconnaître.
Si son aspect pouvait rebuter, voire même effrayer si on le croisait dans une rue déserte et mal éclairée en pleine nuit, son visage laissait transparaître une douceur et une bonté rare. On pouvait lui faire confiance à la seconde, sans arrière pensée. Il incarnait un peu la sagesse et s'il était aussi mal attifé que le joueur de violon, tout comme lui, c'était un prince.
Il ne dit plus un mot. Les deux seuls spectateurs regardaient et écoutaient dans un silence religieux l'homme au violon qui, maintenant, se lançait dans une prière musicale aux tons désarmants. Il aurait été capable de tirer une larme du cœur le plus endurci. Elle apprendrait, dans quelques années, qu'on appelait cela un requiem.
A la fin du morceau, comme le violon se taisait quelques secondes, le vieil homme au pardessus se pencha à nouveau à son oreille :
« Tu l'as reconnu ? »
Elle fit non de la tête, étonnée de la question impromptue. Qui fallait-il reconnaître ? Elle regarda à gauche, à droite. Lui précisa, dans un sourire :
« C'est bien ça, tu ne l'as pas reconnu. C'est encore plus beau ».
Elle ne comprenait pas les paroles du vieil homme, mais aimait le timbre de sa voix. Il s'adaptait parfaitement à la beauté des notes de musique qui résonnaient encore dans sa tête, bien après que l'instrument se tut.
« Est-ce que tu aimerais savoir en jouer, toi aussi ? »
La question la troubla. Elle se retourna franchement vers le vieil homme au pardessus élimé. Ses chaussures n'étaient pas non plus de la première jeunesse, mais elle remarqua aussi ses mains. Elles étaient comme son visage, pourtant ravagé par l'assaut du temps : toutes ridées, un peu recourbées mais d'une douceur infinie. Il devait être rassurant de se blottir dans ses bras. Puis elle considéra la question plus profondément. Parlait-il sérieusement ? Pourrait-elle, aussi, donner vie à des notes de musique avec un simple instrument fait de cordes et de bois ? Elle ne sourit pas, demeura grave en hochant franchement la tête. Pour le moment, elle n'avait pas dit un mot. Son cœur parlait à sa place. Lui ne ment jamais, pensa-t-elle.
Alors le vieil homme plongea l'une de ses mains si délicate à l'intérieur du trop grand manteau fatigué et en extirpa un petit carton format carte de visite. Il lui tendit au moment même où tata Aline revenait la chercher.
Il changea d'emblée d'attitude à son contact. Se découvrit et pencha la tête en guise de déférence, comme on se doit de la faire devant une reine. Elle remarqua que ses cheveux n'étaient pas totalement blancs, qu'ils étaient même encore bien sombres, plus poivre que sel, ondulés – c'est à dire pas franchement frisés mais plus souples que des favoris bien raides.
Il répéta en quelques phrases courtes, de sa voix mélodieuse (voilà, elle avait trouvé le bon adjectif : il y avait de la musique dans ses intonations), ce qu'il proposait à la gamine mais c'est à elle qu'il confia le petit bristol.
Tata Aline la prit par la main et elles quittèrent les couloirs du métro. Elle lui demanda aussitôt quel était ce vieux monsieur tout décrépit, s'il avait été gentil et d'autres questions qu'elle ne comprenait pas complètement. Il lui semblait que tata Aline, qu'elle aimait bien pourtant, faisait partie d'un autre monde, parallèle, qui croisait le sien mais qui n'était pas exactement le même.
Elles sortirent au grand jour. Le ciel s'était à nouveau chargé de nuages menaçants. Il allait sûrement bientôt pleuvoir.
Elle regarda alors le petit carton sur lequel était inscrit :
Samuel Rosenberg
8 rue de la Grande Armée
Paris
Son adresse, sans doute. Ce qui la surprit c'est que l'arrondissement n'était pas mentionné.
Le soir, juste avant de passer à table, elle fut distraite par l'écran de la télévision qui égrenait, à bas volume, les informations de la journée. Elle sauta sur place en clamant « je le connais, je le connais » !
Papa s'approcha, jeta un coup d'oeil au téléviseur, attrapa d'un geste la télécommande et augmenta le son.
« ...Joshua Bell, le violoniste le plus doué de sa génération a passé une bonne partie de la journée dans le métro parisien, station Opéra. Il a joué pendant plusieurs heures devant un public, disons, plutôt discret dans son attention. En effet, aucun ou presque, ne s'arrêta pour écouter, ne serait-ce qu'une minute, le prodige aligner les plus grands airs classiques du répertoire. Ce concert gratuit n'intéressait visiblement que quelques clochards dont il avait endossé l'aspect, deux ou trois amateurs qui l'avaient reconnu et presque tous les enfants qui, hypnotisés par cette beauté musicale, ne pouvaient s'arrêter que quelques secondes, pressés par leurs parents qui les tiraient par le bras ».
Quelques plans montraient le faux clochard en train de jouer Brahms ou Mozart ».
Papa demanda à maman de venir voir. Le reportage continuait :
« Monsieur Bell, encore auréolé des plus prestigieuses récompenses donna ainsi un concert totalement gratuit où quantité de personnes, certainement les mêmes qui avaient déboursé plus de deux cents euros encore la veille au théâtre des Champs Elysées l'avaient applaudi à tout rompre, avant de se lever dans une standing ovation amplement méritée. Cependant, là, dans les couloirs du métro, à quelques mètres tout juste de la vénérable salle, ils l'ignoraient superbement. Toute cette mise en scène avait été imaginé par un collectif de l'université de Nanterre, sections psychologie et sociologie pour comprendre nos rapports avec la célébrité, les mises en situation et le conditionnement de nos comportements ».
Maman avait insisté pour l'accompagner à son premier cours de violon, rue Coquillière. Tata Aline avait dû lui faire un portrait peu élogieux du vieil homme dans son pardessus trop grand pour lui. Tata Aline accordait un peu trop d'importance aux apparences, à la vanité des choses, pensait-elle.
L'immeuble n'était pas si différent du leur, sauf qu'il n'y avait pas d'ascenseur. Monsieur Rosenberg habitait au septième, juste sous les toits. Ce jour-là, il portait un petit gilet couleur ardoise dont seuls deux boutons en retenaient les pans. Il avait troqué ses mauvaises chaussures contre une paire de savates en cuir et sans talon. Son visage était toujours aussi apaisant, il lui semblait incarner la bonté même. Maman a dû, elle aussi, tomber sous le charme puisqu'en repartant, comme il lui faisait un joli compliment d'usage, elle rougit imperceptiblement. Elle fut la seule à s'en rendre compte par ce simple détail : elle avait oublié son foulard.
Les cours auraient lieu deux fois par semaine, les Lundi et Jeudi, en fin d'après midi. Lors de cette première entrevue, le professeur de violon, qu'elle allait très vite appeler Maître – il lui faudrait plusieurs années pour parvenir à l'appeler simplement Samuel - lui parla avec bienveillance, un peu comme si elle était allongée sur un lit d'hôpital et que lui serait le médecin qui allait la guérir.
Il s'absenta un moment dans une autre pièce – l'appartement ne devait contenir que ces deux chambres. Il en revint avec un étui un peu semblable à celui qui trônait sur la chaise pliante dans le métro. Il l'ouvrit. A l'intérieur, un violon de piètre aspect. Devant l'air maussade de la fillette, il lui dit que l'instrument n'était rien comparé au doigté, au talent de celui ou celle qui allait en jouer. Ce seraient les doigts et le cœur du violoniste qui donnerait vie à ce simple morceau de bois. Il l'encouragea à prendre l'instrument sans lui donner la moindre indication. Juste pour voir quelle serait la main qui l'empoignerait, droitière ou gauchère, et comment, d'instinct, la fillette allait apprivoiser ce nouveau compagnon. Ensuite seulement, il lui indiqua comment bien placer ses doigts. Ses gestes étaient doux, ses mains fines et chaudes. Elle aimait leur contact sur les siennes. Elle avait confiance. Pensait que c'était un bon professeur.
A la fin de la séance – qui ne dura qu'une petite heure -, comme elle s'en allait avec maman, il lui demanda d'une voix plus forte si elle n'oubliait rien. Elle stoppa, ne parut pas comprendre. Il lui tendit le violon.
« Je vais te donner deux cours, les Lundi et Jeudi. Une bonne heure, parfois plus. Mais si, entre temps, tu ne pratiques pas les exercices que je t'indiquerai – on appelle ça les gammes - tu ne sauras jamais jouer du violon ».
Elle prit l'instrument, le rangea délicatement dans son étui, pendant que lui regardait attentivement comment elle prenait déjà soin de son compagnon.
Il n'allait plus la quitter pendant toutes ces années. Il allait devenir son meilleur ami. Parfois son confident.
Elle se rendit toute seule au second cours. Il dura presque deux heures. Il fallait « dégrossir » et « défricher », mots employés par Samuel Rosenberg. Chaque soir, durant une bonne demi-heure, elle répétait les exercices prévus par le maître. Parfois elle en avait marre. Elle ne voyait pas comment répéter inlassablement les mêmes gestes l'aiderait à mieux jouer. Mais elle se pliait à cette nouvelle discipline. Elle ne voulait pas abandonner. Maintenant il était trop tard.
La première année, portée par cette nouvelle passion, elle ne se posait pas des questions : elle travaillait en serrant les dents. Elle y puisait davantage de plaisir que de contraintes, finalement.
Le cadeau de Noël n'était pas un violon de meilleure qualité, sûrement une seconde main, mais c'était le sien, maintenant.
Au bout de deux années, le maître passa la vitesse supérieure : lui savait qu'il avait entre les mains de la graine de génie. Quelqu'un comme on n'en rencontre qu'une fois dans sa vie. Il se gardait bien de lui dire combien elle le ravissait, même dans ses fautes. Au contraire, il la tançait gentiment mais fermement à chaque erreur commise. Il se devait d'être intraitable. On ne badine pas avec le talent. C'était un véritable Stradivarius humain qui venait deux fois par semaine dans son petit appartement. Il ne pouvait se contenter d'approximations, de médiocrité. Il fallait être à la hauteur. La porter à son sommet.
Au bout de sept ans de ce régime, le maître dit à la jeune fille qu'elle était devenue qu'il lui fallait dorénavant un nouvel instrument. Elle ne pouvait plus se contenter du crinrin sur lequel elle avait fait ses armes. Elle était passé à un niveau supérieur. Il pensait même qu'elle aurait pu être digne d'un vrai violon depuis bien deux ans maintenant. Il lui donna quelques noms, quelques adresses. Elle se rendit dans un magasin dédié à la musique avec maman. Devant le prix des différents modèles, elle eut un mouvement de recul. Elle s'en ouvrit au maître. Alors, pour la première fois, il se mit en colère. Avant de s'en excuser : elle n'y était pour rien. Il fallait qu'il voit de toute urgence ses parents. Pas seulement maman. Les deux. Ils y allèrent sans elle. Restèrent une bonne demi-heure. Personne ne saura jamais ce qui s'est dit pendant cette entrevue, mais on peut conjecturer que les propos devaient être proche des plus hautes négociations sur la réduction de l'armement nucléaire entre les deux grandes puissances mondiales.
Voici ce qui en résultat : un Mardi, à l'heure des cours habituels – il n'était pas question d'empiéter sur les leçons – ils se rendirent, le maître et elle, accompagné de papa, dans un arrondissement situé à l'autre bout de la ville. Un de ces quartiers huppés aux larges avenues plantées d'arbres en contre-allées, aux vastes immeubles de pierre de taille. Des voitures luxueuses étaient garées le long de l'avenue. Mais celui chez qui se rendait cette petite délégation ne possédait même pas de berline. Pour se déplacer, il utilisait le taxi, puis l'avion. Parfois l'hélicoptère ou un jet privé. Le maître composa un code. Une voix se fit entendre à laquelle il répondit simplement « Rosenberg ». Une caméra pivota juste au-dessus de leurs têtes, puis la lourde porte se déverrouilla dans un petit bruit de bourdonnement d'abeille. Ils pénétrèrent sous un porche qui donnait sur une cour d'épais graviers avec quelques ifs plantés ici et là. Il y avait même une petite fontaine au centre. Une majestueuse berline allemande était garée à côté d'une voiture de sport. Un large perron donnait sur un hôtel particulier. Lorsqu'ils grimpèrent les premières marches, un jeune homme en polo, pantalon de flanelle et gilet de soie noué autour du cou dévala l'escalier de l'immeuble qui faisait face pour s'engouffrer dans la voiture de sport. Il marqua un temps, les détailla sans ajouter un mot ni un salut, juste une sorte de moue entre le mépris et l'indifférence. Non seulement, on pénétrait ici dans un autre monde où les valeurs n'étaient plus les mêmes, à peine celles de la République, mais ceux qui y demeuraient vous toisaient du haut de leur prétendue grandeur. Le maître ne s'en offusqua pas. Il réagissait parfois comme un serviteur.
Nouveau digicode. Cette fois, pas de code à composer, juste un bouton d'appel. La voix, monocorde, précisa juste l'étage et la porte. Ils empruntèrent un ascenseur situé sur la droite du hall aux dimensions de palais, tout en marbre ou de belle imitation. Deux statues grecques se faisaient face : un bel apollon doté de tous les attributs de sa fonction et une nymphe qui tenait une cruche à bout de bras. Bien entendu, la cruche laissait couler un filet d'eau qui culbutait dans un bassin joliment façonné. Un large tapis était posé à terre, elle n'eut pas le temps d'en observer les détails : apparemment une composition de bataille entre les Dieux mythologiques. Il semblait qu'on avait changé d'époque et revenu trois mille ans en arrière, en pleine Grèce antique. L'ascenseur, ultra moderne, faisait aussitôt oublier cette première impression trompeuse. Ils atteignirent le neuvième étage en moins de deux secondes, sans un seul à-coup, ni ce vague mal au cœur qu'on éprouvait à la fois au départ mais surtout à l'arrivée de ce type d'élévateur. Magie des vérins et de l'hydraulique. Ils débouchèrent alors dans un couloir entièrement tapissé, sol et murs, où quelques appliques renvoyaient une chaude lumière, comme ces feux de cheminées qui semblent réchauffer à la fois l'air mais aussi les couleurs.
Le maître frappa à une porte qui s'ouvrit aussitôt. Un grand bonhomme, la cinquantaine, vêtu comme un valet de l'ancien régime. Pantalon de toile au pli impeccable, veston retenu par deux boutons qui laissaient deviner un gilet rayé, nœud papillon sur un col cassé – il ne lui manquait que la perruque poudrée : nul doute qu'il n'avait abandonné cet artifice que quelques années plus tôt ! Il ne dit que trois mots « s'il vous plaît » en proposant de le suivre d'un geste discret de la main droite.
Ils pénétrèrent dans un petit salon richement décoré. Elle se rappela la fois où tata Aline l'avait emmenée chiner dans quelques boutiques d'antiquités et autres brocantes du meilleur goût. Ils patientèrent dix minutes pendant lesquelles elle en profita pour détailler le mobilier en acajou, parfaitement lustré. Elle imaginait une armée de soubrettes, chiffon et plumeau à la main, en train de s'affairer pendant des heures sur les bibelots, astiquant et polissant l'ébène et le merisier jusqu'à les rendre brillants comme un miroir. Quelques toiles représentaient des paysages, une scène de bataille avec un général sur un cheval qui se cabrait, un bord de Loire sous la brume et même une peinture plus osée, une femme alanguie sur un lit défait, qui ne cachait pas grand chose de ses attraits et atours avec les plis d'un drap visiblement en soie. Tout ici respirait la culture et le goût, la puissance tranquille de ceux qui possèdent et ont toujours possédé l'argent et le pouvoir. Cette attente même, elle en était persuadée, faisait partie du décor. Elle était certaine que leur hôte attendait dans une pièce voisine, vaguement occupé à parcourir son courrier, siroter une tasse du meilleur Earl Grey ou tout simplement assis dans un large fauteuil ou debout devant une croisée à regarder dans le vide. Dans son monde, on mettait un point d'honneur à ne jamais être à l'heure, à toujours faire attendre celles et ceux qui nous étaient inférieurs, ou supposés tels, tout en se pliant à être d'une ponctualité sans faille face aux plus puissants. Mais ce monsieur avait-il quelqu'un de plus puissant que lui ? Le Président, peut-être ? Et encore, elle n'en était pas si sûre et il lui semblait qu'il pouvait, qu'il devait être une tête pensante, un conseiller privilégié des hautes sphères du pouvoir. Sans lui, la France aurait boitée.
Le grand homme se montra enfin.
Il était simplement vêtu d'une veste en velours dont le col était orné d'un foulard Bordeaux en soie qui enserrait un cou délicat. Ses traits étaient ceux d'un homme qui prend soin de lui-même. Le regard perçant et d'un bleu irréel marquait une intelligence supérieure. Le cheveu rare, mais coiffé avec soin. Ses mains, lorsqu'elles indiquèrent les fauteuils où s'asseoir, étaient belles et douces, mais aucunement féminines. Elle devinait que sa poigne devait être douce et tiède tout en faisant sentir une puissance intrinsèque. Comme cette fameuse voiture de sport vue dans la cour : des chevaux maîtrisés mais qui ne demandaient qu'à s'ébrouer sauvagement à moindre sollicitation.
Il ne serra aucune main. Pas la sienne, ni celle de papa, même pas celle du maître. A la place, il s'avança vers Samuel Rosenberg, le prit par les épaules solennellement et lui offrit une accolade, plus officielle qu'une étreinte mais où transpirait une certaine bienveillance, un respect, une reconnaissance. Elle en fut étonnée. Ce personnage qui semblait tutoyer les Dieux se comportait envers son simple professeur de violon avec une déférence à peine dissimulée. Elle imagina que, quelque part, cet illustre homme de l'ombre qui tirait les ficelles du monde occidental, était redevable à ce simple petit homme mal fagoté, qui la traitait comme une égale, en tout cas jamais comme l'enfant qu'elle était encore, mais comme une vraie violoniste de 25 ans au sommet de son art, de sa gloire.
Après avoir échangé un regard lourd de connivence avec le maître, regard qui certifia dans son esprit d'enfant tout ce qu'elle déduisait de son comportement, l'homme fit un pas de côté et s'inclina à peine devant papa, puis prit sa main à elle et s'inclina davantage pour déposer un semblant de baiser : ses lèvres ne touchèrent pas le dessus de la main – tout comme son accolade n'avait pas pressé le torse du maître juste à l'instant.
« Je suis très heureux de te revoir, Samuel. On ne va pas compter les années, n'est-ce pas ? Mais cela fait trop longtemps à mon goût. Quelle est cette belle raison qui t'amène ? »
Le maître répondit avec ce même sourire emplit de compassion qu'il accordait à chacun. A cet instant, elle comprit, elle eut la confirmation que le maître était quelqu'un d'exceptionnel, un homme bien. Elle savait qu'il avait pour leur hôte un respect total et pourtant quelque chose, entre eux, laissait entrevoir, deviner qu'il était en quelque sorte supérieur au grand homme. Comment était-ce possible ?
« Tu as toujours ton Stradivarius ? »
L'homme ne put réprimer une légère secousse, comme s'il allait vaciller. Son regard s'obscurcit durant deux secondes pendant lesquelles il détailla davantage le maître puis jeta un rapide coup d'oeil au père et à la fillette. Comme pour en deviner le lien qui pouvait exister entre les trois, tenter de relier des existences qui, en apparence, n'avaient rien de commun. Cela s'appelle l'intelligence.
« Bien sûr. Tu sais naturellement que je ne m'en séparerai sous aucun prétexte ».
Le maître eut un regard de vaincu, comme si son ami, car il fallait l'appeler ainsi, elle en était maintenant sûre, lui avait donné un coup d'épée dans l'estomac.
«Très bien. »
Il marqua un temps assez long où les deux hommes semblèrent communiquer dans un silence chargé de symboles.
« Tu pourrais nous le montrer ? »
L'homme parut déstabilisé puis se reprit instantanément et appela le majordome en tirant un cordon à pompon. Elle eut envie de rire. Peut-être esquissa-t-elle un vague sourire. L'homme le remarqua.
« Vous avez raison de sourire, Mademoiselle. Tout cela est parfaitement suranné, j'en ai conscience. Je devrais me déplacer moi-même pour aller chercher cette pièce unique. Toutefois, ce serait un peu inconvenant de vous laisser seuls pendant quelques minutes, surtout après vous avoir honteusement fait attendre tout à l'heure ».
Elle n'en mettrait pas sa main au feu, mais il lui sembla percevoir comme un petit clin d'oeil dans le regard de lynx de l'homme. Quelque chose était passé entre eux deux. Quelque chose qui allait faire, qui ferait toute la différence.
Le valet apparut moins de cinq secondes plus tard : il devait attendre derrière la porte. Il disparut et fut de retour deux minutes plus tard, non qu'il ait flâné à la recherche du violon mais la demeure devait être si vaste que, même au pas de course, il fallait bien ce laps de temps pour aller chercher un objet de cette valeur – qui ne devait pas être disposé n'importe où.
L'homme prit l'étui dans ses mains, le posa sur un guéridon, l'ouvrit avec précaution en faisant sauter les deux serrures d'un seul mouvement du pouce et du majeur. Elle pensa alors à un joaillier qui allait dévoiler le joyau de sa collection, une rivière de diamants unique au monde.
Alors, elle le vit. Allongé dans sa protection comme le corps d'un empereur gisant dans son linceul. Un magnifique Stradivarius né sous l'ancien régime, qui connut son apogée et son effondrement, puis les plus sombres heures de la Révolution, le faste et la chute de l'Empire, les balbutiements de la Restauration, les différentes émeutes qui émaillèrent les débuts de la République, les grands hommes du siècle précédent, puis enfin ce siècle qui allait montrer le pire et le meilleur en alternance, comme on souffle le chaud et le froid, la fournaise la plus étouffante et le glacial le plus atroce. Mais lui serait toujours là. Dans les mains les plus habiles, les plus prestigieuses, illuminé par les projecteurs les plus puissants, admiré au-delà de toute retenue aussi bien par les plus humbles et modestes que par les plus impérieux. Peut-être ayant fait le tour du monde, sûrement même. Un bijou, transmis de mains en mains sur lequel les doigts les plus exercés auront fait naître les mélodies les plus renversantes. Il aura été le centre, l'origine d'émotions partagées par des milliers, des millions de personnes, toutes différentes, mais toutes rassemblées par le même sentiment d'accomplissement. L'unicité humaine, si désirée en vain et enfin réalisée par le biais de la musique.
Même là, dans ce petit salon, trop richement décoré, il éclipsait tout et l'émotion était déjà palpable.
Le maître surtout. Il lui sembla apercevoir perler une larme au coin de sa paupière. Par pudeur, le professeur de musique, d'un geste discret, effaça cette soit disant marque de faiblesse qui, en réalité, n'est que la preuve d'une grandeur d'âme : avoir la capacité de s'émouvoir devant la beauté incarnée.
Le maître se saisit du violon avec d'infinies précautions. Il l'examina comme on détaille un Renoir ou un Van Gogh. Puis il tendit le chef d'oeuvre à la jeune fille. Elle resta interdite, ne sachant quoi faire. Il la fixa d'un air lui demandant de s'exécuter. Elle s'en empara. Le bois semblait presque chaud sous sa paume alors qu'il régnait une certaine fraîcheur dans la pièce. Elle regardait l'instrument comme un manant peut se comporter gauchement au milieu d'aristocrates. Le maître lui passa l'archet en murmurant
le concerto en la mineur de Bach.
Fallait-il improviser là, maintenant ? Et une partition particulièrement ardue, bourrée de pièges, qui demandait un doigté particulier, à la fois une retenue dans l'interprétation et une fougue dans les envolées chromatiques. Les premières notes furent hésitantes. A la manière qu'ont un cavalier et un cheval de se découvrir l'un l'autre. Alors, elle ferma les yeux. Se réfugia dans son monde où n'existaient plus que la musique. Un monde créé par elle, par sa faculté à faire naître des harmonies avec un simple bout de bois glissé sur des cordes. Le pouvoir de maîtriser son sujet, d'aller exactement où elle voulait aller. Se libérer enfin des chaînes qui nous rattachent au quotidien, forcément plus terne que le monde des notes. Maintenant elle était en confiance. Elle évoluait dans ce monde magique de la musique. Elle pouvait ouvrir à nouveau les yeux : elle ne voyait que la portée qui lui indiquait le chemin à suivre, les méandres à éviter, les difficultés et comment les appréhender. Emportée par son élan, elle s'autorisa alors quelques pas de côté, prenant parfois de la distance avec la partition. Elle jouait avec la composition, se l'appropriant en quelque sorte.
Elle ne perçut pas l'étonnement de l'homme qui, jusque là, n'écoutait que d'une oreille distraite, une juste et honnête interprétation, comme on boit un verre d'eau, juste afin de se désaltérer. Maintenant, il lui semblait que l'eau plate s'était changée en vin. Un joli petit Bordeaux qui promettait, juste encore un peu trop frais, qui demandait à être chambré. Puis, au moment où elle prit ses distances avec la partition, il lui sembla déguster un grand Bourgogne, charpenté à souhait. La jeune fille maîtrisait parfaitement son sujet mais se permettait d'inventer, d'y mettre de son âme. Il découvrit des zones cachées dans ce concerto si souvent joué, comme les arômes plus subtils du magnifique Bourgogne qui révélaient un véritable feu d'artifice olfactif. Ses oreilles bourdonnaient de plaisir. Il avait rarement eu l'occasion d'éprouver pareille émotion.
Il remonta le temps. Lui aussi avait quitté mentalement la pièce. Il était revenu soixante ans en arrière. Cet ultime concert au Carnegie Hall, devant tout le gratin mondial, un parterre de connaisseurs surtout. Tous ses amis ou prétendus tels étaient présents. La consécration. Et puis aussitôt, une autre image vint se superposer. Moins éclatante. Plus ancienne. Sa rencontre avec Samuel Rosenberg, matricule 40 457. A cet instant, son poignet gauche le brûla et il n'eut d'autre possibilité que le frotter discrètement. Mais le geste n'échappa pas au professeur de musique. Ils échangèrent un regard. Pendant cette seconde et demie, tout était dit. Comment Samuel l'avait sauvé d'une mort certaine et redoutablement atroce. Leur amitié instantanée, durable, contre vents et marées. Leur ascension dans le grand monde. Résolument musical. Mais un monde des affaires pour l'un, celui des arts pour l'autre. Deux mondes qui s'étaient confondus. Du moins, en ce qui le concernait. Avait-il fini par vendre son âme au diable comme le lui avait reproché un jour cet ami éternel. Oui, même les neiges dites éternelles finissent par fondre. Et puis il y avait eu ce funeste soir de gala. Puis leur amitié n'avait pas résisté à ce choix de vie. Deux trajectoires qui s'étaient séparées, sans espoir de se recroiser à nouveau. Jusqu'à ce coup de fil reçu la veille.
« C'est Samuel. J'ai besoin de te voir. Quelque chose d'important à te demander. »
Il savait qu'il lui devait quelque chose. C'était le moment ou jamais de régler ses comptes avant de faire le grand saut. Cela ne pèserait sûrement pas lourd dans l'impitoyable balance à l'entrée de l'Autre Monde, mais cela soulagerait au moins sa conscience pour les quelques années, peut-être les quelques mois qu'il lui restaient à vivre dans ce monde, avant d'expier ses lourdes fautes pour entrer dans le suivant.
Elle s'arrêta à la fin du morceau. Revint progressivement dans cette petite pièce où l'émotion était palpable.
Le maître regarda intensément l'homme, semblant lui demander ce qu'il en pensait. Celui-ci ne dit qu'un seul mot.
« Admirable ».
Le maître enchaîna :
« Elle a besoin d'un vrai instrument maintenant, à la hauteur de son talent. Elle est arrivée au terme de ce que pouvait lui donner celui sur lequel elle a travaillé pendant tant d'années pour parvenir à ce niveau. Pour progresser encore car, tu le sais mieux que quiconque, on n'arrête jamais de progresser... - A ce moment, l'homme sembla chanceler -, pour progresser elle a besoin d'un instrument à sa mesure ».
Un silence s'installa. Le maître reprit, un ton en dessous :
« Je ne te demande pas de le vendre, je sais qu'un tel chef d'oeuvre n'a pas de prix. Plutôt une sorte de prêt. Un investissement, plus précisément. En compensation, tu seras invité à chaque concert qu'elle donnera. Et je suis certain, absolument certain, qu'il y en aura beaucoup. »
L'homme reprit l'instrument, le rangea avec le plus grand soin, comme on dépose un bébé dans son berceau. Referma l'étui avec ce doigté qui fit comprendre à la jeune fille que, lui aussi, avait été un musicien. Un grand. Un très grand.
Il lui tendit :
« Soyez à la hauteur de cette perfection. Je sais que vous en êtes capable. Faites-lui honneur, ce sera ma plus belle récompense ». Son père ne dit rien. Un simple merci n'aurait même pas été suffisant. Il n'y avait rien à dire. Tout comme les grandes amitiés ne s'expliquent pas.
Ils prirent congé avec les mêmes gestes que lors de leur entrée, juste un peu plus marqués. Empruntèrent l'ascenseur, traversèrent la cour de graviers. Un homme portant un tablier de jardinier vert bouteille égalisait le gravier avec un simple râteau, effaçant les marques laissées par le jeune homme à la voiture de sport. Tout était dit. Dans ce monde-ci, comme dans le leur, il y avait des gens bien, la crème de la crème, et puis il y avait les mêmes êtres détestables, qu'on aimerait voir punis pour leur égoïsme et leur manque de dignité.
Les années passèrent.
Depuis ses huit ans, le maître l'avait présentée à un vague ami. Il portait ce-jour là un costume austère orné d'un petit col blanc, une simple croix en or en guise de légion d'honneur. L'homme, qui respirait la bonté incarnée, lui avait dit que c'était, à ses yeux, la plus belle des récompenses : la preuve de l'amour qu'il portait au Seigneur. Les autres fois, elle ne l'avait vu qu'en soutane. C'était le prêtre de Sainte Eustache, une petite église de quartier. Chaque 24 Décembre, elle s'enveloppait dans une robe noire, toute simple et sans tralala, ne portait aucun chapeau. Elle assistait à la messe de minuit sans bien en comprendre le déroulement. Ses parents étaient athées et elle ne s'était jamais posé de question sur la religion. Certains y croyaient, d'autres pas. C'est tout. Elle n'était pas là pour prier, ni pour se représenter, pas davantage pour communier ni même pour se réchauffer, d'autant que l'église était aussi froide qu'un tombeau. A la fin de l'office, elle se levait, son violon à la main, et se dirigeait vers l'Autel.
Elle se mettait à jouer. Comme si elle était devant le maître. La première fois, elle fut effrayée. Tous ces gens qu'elle ne connaissait pas, qu'elle n'avait jamais vu, engoncés dans d'épais manteaux et venus ici pour d'autres raisons, tous ces gens qui fixaient leurs regards sur elle, frêle et fragile silhouette dans sa petite robe noire. Un silence de cathédrale régnait au cœur de l'édifice. Sa main tremblait sur les premières portées. Alors, elle fermait les yeux. Juste deux ou trois minutes, juste le temps de reprendre confiance. Alors, les notes emplissaient tout son être, il n'y avait plus que la musique qui comptait. Mais, cette fois, les notes ne se contentaient pas de résonner dans sa tête – ou même dans une petite pièce au septième étage d'un vieil immeuble, rue Coquillière. Là, elles prenaient leurs aises. Elles s'envolaient, s'évaporaient vers la voûte, six mètres plus haut. Elles rebondissaient dans le transept, contournaient les colonnes, remontaient les travées, venaient s'achopper aux vitraux. Mais surtout, elles parvenaient à plusieurs dizaines de paires d'oreilles. C'était du miel pour l'âme.
La première fois qu'elle joua ainsi, elle n'avait pas la moitié de l'âge qu'elle a aujourd'hui. Un grand silence avait suivi son interprétation de Bartok et Liszt.
Puis quelqu'un, peut-être bien le prêtre lui-même, s'était mis à applaudir. Doucement, comme intimidé. Puis un écho se fit dans l'assemblée. Trois, quatre et finalement toute l'assistance tapa dans ses mains. L'année suivante, il lui sembla que l'église était plus garnie. A la fin de la petite représentation - on ne pouvait pas parler de concert - l'assistance se leva lors de l'ovation. Chaque année, en cette nuit de Noël, elle donnait un peu d'elle-même à tous ces gens qui venaient assister à la messe de minuit dans la petite église de quartier, mais aussi pour l'écouter, elle. D'une année sur l'autre, elle reconnaissait les habitués. Certains venaient la remercier, lui prouver leur gratitude, simplement lui glisser un timide merci, certainement un des plus beaux mots de la langue française.
Elle avait grandi. Elle n'était pas encore adulte mais elle se rendait compte du chemin accompli. Elle avait des souvenirs. Chaque fin d'année, elle prenait un immense plaisir à préparer Noël, à décorer la maison, à cuisiner ces petits gâteaux alsaciens avec maman. Et surtout, à jouer. Partager l'immense plaisir qu'elle éprouvait à tirer des notes et, dorénavant, les offrir aux autres. Elle savait déjà que c'était toute sa vie. Le maître lui répétait souvent, particulièrement les jours où elle n'était pas en forme, où elle n'avait pas la grâce, où le violon semblait lui en vouloir, qu'elle n'était pas concentrée, qu'elle n'était pas digne des partitions écrites par les plus grands. Que jouer était un honneur et qu'elle le galvaudait. Mais elle savait au fond d'elle-même que son professeur était fier d'elle. Qu'il la soutenait, même dans ses remontrances, ses critiques, ses reproches. Il ne lui passait rien. Et cela augmentait avec les années. Plus elle faisait des progrès, plus il lui restait à en faire.
« Plus on aime, plus il nous reste d'amour » finissait-il par affirmer. C'était vrai pour plusieurs domaines, dont celui de la musique, de l'art.
Un soir de printemps, elle s'était rendue à une soirée. A l'entrée de l'établissement – une simple grange aménagée – on lui avait tamponné le poignet gauche en échange de deux billets d'euros. Le tatouage représentait un hiéroglyphe. Il s'effacerait avec un peu de savon. Elle repensa à ce tatouage, indélébile lui, qu'elle avait aperçu à quelques reprises sur le poignet de son professeur. Elle osa lui demander, tout en supposant la réponse.
Il avait éludé, avec toujours ce petit sourire qu'il arborait, comme pour s'excuser d'une erreur qu'il n'aurait pas commise. Comme une pudeur, une délicatesse.
Un soir d'été, le cours terminé, il l'avait retenu une petite demi heure supplémentaire. Lui avait tenu un discours empreint de nostalgie et de douceur.
« Bientôt, tu vas intégrer une école prestigieuse, peut-être même le conservatoire national. Tu rencontreras d'autres personnes. Elles auront toutes, ou presque, un talent égal au tien. Ne te laisse jamais abattre. Ne pense pas à la compétition, mais plutôt à l'émulation. La différence est essentielle. Dans le premier cas, tu considères les autres comme des ennemis qu'il faut combattre. Cela demande beaucoup trop d'énergie gaspillée en vain. Dans le second, ce sont des adversaires grâce auxquels tu peux t'améliorer encore et toujours. On n'arrête pas de progresser. Le jour où l'on apprend plus rien de nouveau, on est devenu vieux, un peu comme moi, ajouta-il dans un souffle nostalgique.
Tu auras d'autres professeurs, plus doués, plus prestigieux que le pauvre Samuel Rosenberg. Tu m'oublieras peut-être. Si, si. Quand tu seras en haut de l'affiche et il n'y a pas raison d'en douter, tu ne te souviendra plus du minable et miteux petit maître comme tu continues à m'appeler. L'élève a déjà dépassé le maître, alors comment pourrait-il en être autrement. Et c'est très bien comme ça. Le plus grand merci, la meilleure reconnaissance que j'attends de toi, c'est ton nom en grosses lettres sur les plus prestigieuses affiches des plus beaux concerts au monde. Fais-le pour moi. »
Il se leva, pour la raccompagner jusqu'à la porte donnant sur le palier, comme à la fin de chaque séance. L'ayant ouverte, il la retint par le bras, découvrant ainsi son poignet tatoué. Il vit qu'elle le remarqua.
« La première fois que j'ai entendu jouer du violon, j'avais six ans. Le même âge que le tien quand je t'ai rencontré dans ce couloir de métro, tu te rappelles ? »
Comment pouvait-elle l'avoir oublié ? Cette rencontre avait été déterminante, elle avait orienté toute sa vie.
Il reprit, baissant encore un peu plus la voix.
« C'était en Juillet 42. Nous habitions déjà dans ce quartier. Mais tout était différent alors. Un matin, il y eut un vacarme infernal. Il faisait encore nuit et on entendait le bruit saccadé des bottes dans les escaliers. Tout alla alors très vite. Des policiers français entraient sans frapper, nous tiraient quasiment de nos lits et nous emmenaient de force. Nous n'avions que le temps de préparer quelques affaires – tout ce qui était précieux. Nous ne savions pas, à ce moment là, à quoi allait servir ces effets si chers : portefeuilles remplis, bijoux, argenterie. Nous n'en aurions pas besoin dans notre voyage sans retour.
On nous fit monter dans des camions de l'armée. Puis nous fûmes parqués comme des bestiaux sous une grande halle, une sorte de gymnase, il me semble. Puis à nouveau des camions qui nous emportaient gare de l'Est. Là, ce fut des trains, encore des wagons à bestiaux. Puis commença un voyage interminable dans la promiscuité la plus totale. Des bébés hurlaient, les plus faibles, les plus âgés mourraient. Aujourd'hui encore, je ne peux voir un camion emportant des porcs ou des vaches sans un pincement au cœur : nous n'étions plus que de la viande qui attendait son tour.
Nous traversâmes toute l'Europe dans des conditions effroyables. A chaque arrêt, on comptait les nouveaux morts. L'odeur était insoutenable. Parfois les soldats allemands les évacuaient, parfois non. Puis nous atteignîmes notre destination finale. Sur le fronton, cette devise : Arbeit macht frei – le travail rend libre. En réalité cet esclavage ne permettait que de rester vivant. Les plus faibles et les malades partaient directement dans une immense chambre à gaz puis on brûlait leurs corps. L'odeur était épouvantable, pire que dans les wagons. Mais on finit par s'habituer. C'est peut-être cela le plus effrayant. Moi, je ne m'y suis jamais habitué. Nous survécûmes ainsi pendant de longs mois. Puis une nouvelle année.
Parmi les prisonniers, il y avait un grand gaillard suffisamment costaud pour échapper à l'épuration. C'est à lui que les kapos faisaient appel lorsqu'il fallait soulever une charge importante. Il avait été lutteur professionnel avant la guerre, dans son Albanie natale. Il était un peu tzigane, un peu bohémien, un peu romanichel, un peu manouche. Il avait pas mal voyagé dans cette Europe des Carpates, de combats en combats. Puis, un jour, lui aussi s'était fait arrêté. Il n'était pas juif, mais cela n'était qu'un détail. A cette époque, les nazis voulaient éradiquer toutes celles et ceux qui ne leur ressemblaient pas. Ce gaillard si fort, un vrai taureau, se faisait appeler Zdravko, ce qui veut dire santé dans une certaine langue. Ses parents ne s'étaient pas trompés. C'était une force de la nature. Il ne tombait jamais malade. J'avais fini par penser que les virus et les bactéries ne pouvaient rien contre lui. Les SS non plus : il leur était trop utile. Et pourtant cette masse de muscles était la gentillesse même. Il adorait la musique. Au fil des mois, il avait pu récupérer quelques petites planches de bois bien tendre et avait, on ne sait comment, fabriqué un petit violon. Je n'osais demander d'où venaient les cordes – on prétend qu'autrefois on utilisait des boyaux de chat, mais dans le camp il n'y avait pas d'animaux. Juste des hommes et des femmes qui n'étaient plus que des ombres, comme dans la chanson.
Donc, Zdravko avait réalisé un violon qui sonnait faux, mais qui sonnait quand même. Il avait fabriqué un archet en vrai crin de cheval.
Un soir, en catimini, il avait fait naître les plus belles notes de musique du monde, là, où s'arrêtait l'humanité, là où la raison n'existait plus, là où seul l'espoir et l'amour permettaient de se lever le lendemain. Il fallait y croire, encore et encore. Croire qu'un avenir existait. Même pour nous. Ceux qui n'avaient pas cette force disparaissaient à tout jamais. Ne restait d'eux que cendres et poussière.
Durant tout l'hiver 44-45, il nous joua les plus grands airs sur son instrument de fortune. Parfois les sons avaient des ratés. Ce n'était pas de son fait, mais à cause de l'instrument somme toute approximatif. J'admirais cet homme, cette montagne de muscles capable de faire naître tant d'émotion parmi nous. On raconte que dans un autre camp, les prisonniers en sursis avaient pu tenir grâce à l'un des leurs qui leur racontait des histoires, des contes, des légendes, parfois de simples blagues. Tu vois, c'est l'art et l'art seul qui permet aux hommes de survivre. Il est autant utile que l'eau et le pain. Presque autant que l'amour.
Un matin d'Avril 1945, le camp était désert. Tous nos tortionnaires s'étaient enfuis. Nous étions livrés à nous mêmes. Mais pas encore libre. Libre d'aller où ? Nous ne connaissions pas la région. Nous n'avions, pour la plupart, plus personne chez qui nous réfugier. Une maison, mais plus de foyer. Nous n'étions que les survivants, notre seule et unique famille désormais.
Nous marchions dans le camp, hébétés, ne sachant que faire. Alors, Zdravko grimpa sur le toit des latrines, à peine plus hautes qu'un homme. Il se mit à jouer. Cette fois les notes n'aidaient plus à survivre, elles portaient l'espoir. L'espoir d'un avenir, d'une Europe enfin libre, enfin en paix.
Cet homme, je ne l'ai jamais revu. Mais grâce à lui, j'ai consacré toute ma vie au plus bel art qui existe : la musique. Dans ce camp, il y avait un autre petit garçon, à peine plus âgé que moi.
Ensemble, nous avons fait le tour du monde. Nous avons joué devant des milliers de gens, dans les salles les plus prestigieuses. Nous étions comme les doigts de la main. Puis un jour, il y a une vingtaine d'années, en plein concert, mon ami a vu que ses doigts ne répondaient plus. Ils étaient ankylosés. Toute la nuit, il souffrit abominablement. Le lendemain, nous consultions un grand spécialiste de l'arthrose. Le diagnostic tomba comme un couperet : il ne pourrait plus continuer à jouer. Du jour au lendemain, il ne toucha plus à son Stradivarius, oui, le même qu'il t'a offert - ou prêté - alors qu'il aurait pu tout de même en jouer en privé. Il coupa tous les ponts. Devint taciturne. Il se mit à boire. Je le tançais : il ne devait pas se laisser aller. Je fis même allusion à notre rencontre dans ce camp de la mort. Si nous nous étions laissé aller, si nous avions alors baissé les bras, nous serions tous morts à l'heure qu'il est. Nous n'aurions pas survécu. Il faut, parfois, être plus fort que la vie. Nous nous disputâmes. Je ne l'ai revu qu'avec toi.
Cette confidence, même si la jeune violoniste se doutait un peu du contenu, la troubla profondément. Ces hommes, qui ne portaient pas sur eux leur terribles secrets, dont rien ne laissait présager leurs profondes blessures, même pas une cicatrice, juste un numéro tatoué à vie sur leur poignet, ces hommes avaient vécu d'immenses bonheurs et d'insondables souffrances. Ainsi était faite la vie. Une succession de hauts et de bas plus ou moins vertigineux. Plus celle-ci était contrastée, plus ils la vivaient pleinement.
Elle avait déjà remarqué que la souffrance engendrait très souvent le talent. Fallait-il subir le chagrin, le désespoir, la tristesse, le deuil pour être capable de devenir un véritable artiste ?
Elle se souvint avoir eu ce genre de conversation avec le maître. Il lui avait souri, de ce sourire rempli d'humanité, de bienveillance et de générosité.
« Le talent, c'est à moitié dans tes gênes et ça tu ne peux rien y faire. Je dirais même que c'est entièrement dans tes gênes. Tout l'environnement, l'éducation, la culture te permettront juste d'exprimer ce que tu as déjà en toi. Plus tu vis intensément, plus tu seras capable d'aller chercher en toi ces trésors. L'ardeur de vivre ne se traduit pas forcément par de lourdes épreuves. Sois heureuse, fais de ta vie un chef d'oeuvre et tu obtiendras ce que tu désires ».
Elle eut dix-huit ans. Son bac en poche, une simple formalité pour l'élève sérieuse et appliquée qu'elle était, il lui fallut choisir sa voie. C'était une évidence pour elle. Elle se renseigna sur les modalités d'entrée dans cette école prestigieuse qui forme les plus grands musiciens du monde.
On les accueillit, elle et ses parents. On leur remis une brochure, on les accompagna dans les salles de cours, on leur fit faire un tour de l'établissement lors d'une journée « portes ouvertes ». Elle était enchantée. C'était toute sa vie. Une école où elle apprendrait ce qu'il lui restait à apprendre mais surtout où, jour après jour, elle vivrait de sa musique, en compagnie d'autres élèves tout aussi motivés qu'elle. On remit une fiche à remplir à son père.
De retour à la maison, il lut l'imprimé. Au bas, en petits caractères, figurait les droits d'entrée, les émoluments destinés aux professeurs, les forfaits d'hébergement, la participation aux frais de fonctionnement, les diverses assurances...
Il se leva et vint se poster face à elle, lui parla les yeux dans les yeux. Les siens brillaient de son impuissance à satisfaire le rêve de sa propre fille. La période était mauvaise. Il allait certainement perdre son emploi à cause d'une stupide restructuration au sein de l'entreprise. Il ne pourrait pas réunir une telle somme. Il en était désolé. Et se mit à fondre en larmes. Il pensait qu'il était un mauvais père, même pas capable d'offrir à sa fille l'avenir qu'elle méritait.
L'automne fut splendide, doux et ensoleillé, comme si tout autour d'elle voulait se moquer du terrible cataclysme qui venait bouleverser sa vie. Elle voyait les gens flâner dans les parcs, bras dessus bras dessous, les amoureux s'embrasser sans se soucier de l'avenir. Une légèreté et une inconstance planaient partout. Elle en était d'autant plus affligée. Elle aussi aurait voulu avoir le cœur léger, l'esprit badin et l'âme heureuse.
Elle voyait son avenir s'assombrir d'heures en heures. En réalité, elle ne voyait rien du tout : qu'allait-elle faire de toutes ces années, de sa jeunesse ?
En désespoir de cause, elle s'inscrivit à une école moins prestigieuse, aux prétentions pécuniaires et artistiques moindres mais qui lui permettait au moins de pratiquer sa passion. Elle y rencontra d'autres artistes en herbe. Elle les estimait moins motivés, moins ambitieux. Leurs rêves n'avaient pas cette folie propre aux seuls artistes. Ils ne seraient, au mieux, que des artisans. Des seconds violons, des professeurs de piano, pire : ils deviendraient des journalistes critiques.
Noël vint. Les décorations qui ornaient les rues effacèrent un peu son amertume, son désenchantement. Elle embellit la maison une nouvelle fois. Comme chaque mois de Décembre, elle cuisina les traditionnels petits gâteaux. L'odeur sucrée de la pâtisserie était un fabuleux baume. Ces douceurs ne ravissaient pas que le palais, ils parlaient à l'âme, réchauffaient même les cœurs de pierre. Elle décora toute la maison de papillotes, de guirlandes en papier, de branches de houx et de sapin.
Elle continuait à rendre visite au maître. Une fois toutes les deux semaines ; son école, pour modeste qu'elle était, lui demandait et lui prenait tout de même tout son temps.
« Je n'ai plus rien à t'apprendre, lui confia-t-il. Maintenant, tu dois te perfectionner par toi-même. Trouver en toi les éléments qui vont faire de toi une grande artiste. Ca doit venir non plus de ton cerveau, ni de tes mains, mais de tes tripes ».
Elle soufflait dans un murmure qu'elle n'avait pas pu intégrer la prestigieuse école, alors à quoi bon tout ça ?
Là, il s'énervait, haussait la voix. Elle ne l'avait jamais vu dans un tel état de fureur. La malice et la douceur de son regard avaient subitement disparu. Ils lançaient des éclairs, des couteaux bien tranchants.
« Jamais, tu m'entends, jamais tu ne dois baisser les bras. C'est indigne de toi. C'est faire injure à ton talent. Au contraire, tu dois, non pas te battre, mais relever la tête, toujours chercher la perfection, l'excellence. Qui es-tu pour savoir ce que te réserve l'avenir ? »
Elle était rentrée chez elle, l'âme encore plus sombre et le dos courbé.
Elle repensa à l'une de ses premières leçons reçues du maître, désormais devenu un vieil homme. Toujours se tenir droite, bomber le torse, relever la tête, ne jamais courber l'échine – au propre comme au figuré. Connaissant désormais son histoire, elle comprenait d'autant mieux ces paroles.
24 Décembre. Elle enfila une nouvelle fois cette robe toute simple, bleu nuit depuis ses quinze ans. Ses parents l'accompagnèrent à Sainte Eustache. Une fois encore, plus aucune place de libre, les travées étaient bondées. Le prêtre vint lui serrer la main, puis rejoignit la sacristie pour se préparer à célébrer l'événement. La messe se déroula encore plus rapidement que d'habitude. Elle avait l'impression que, autant le prêtre que l'assistance, tous étaient impatient de l'écouter, elle.
Elle avait choisi le concerto pour violon numéro trois de Mozart. Délicatesse et émotion. Elle mit tout son art, à la recherche de la note parfaite, essayant de retrouver l'esprit du compositeur au travers son interprétation. Remonter le temps, en quelque sorte.
Samuel Rosenberg était là, au troisième rang. Parfois, elle jetait un regard vers son professeur. Elle le voyait souvent les yeux fermés, un sourire de ravissement sur les lèvres comme si les notes du violon s'adressaient directement à son âme à lui. Formidable moyen de communication, la musique parlait à la fois à tous ensemble et à chacun en particulier. Une belle mélodie, bien jouée, résonnait particulièrement pour chacun, lui racontant une histoire propre, le tutoyant, lui rappelant des souvenirs enfouis ou, à l'inverse, lui donnant l'envie.
A la dernière note, elle s'avança d'un pas, fit une révérence, toute simple, comme à son habitude. Les applaudissements résonnaient plus intensément que d'habitude. C'est ce qu'elle croyait, du reste. Tous, un à un puis par groupes entiers, se levèrent. Les applaudissements redoublèrent. Elle n'avait jamais été autant adulée que cette nuit. Cette nuit de Noël. Elle ferma les yeux et revit son tout premier Noël, la poupée de chiffon qu'elle avait découvert, le matin, au pied du sapin. Cette trottinette l'année suivante, puis le nécessaire à dessin jusqu'à ce fameux matin de Noël où elle avait remarqué le plus beau des cadeaux qu'on eut put lui offrir. Plus qu'un simple instrument, un véritable compagnon.
Ce soir, ce n'était plus un violon bas de gamme, mais un véritable Stradivarius. Dans l'assemblée, aux côtés du maître se tenait son propriétaire, vêtu d'un ample manteau et d'une écharpe de soie blanche qui lui entourait le cou. Il tenait à la main un magnifique chapeau. Il lui souriait. Ses paroles résonnèrent dans sa tête : « j'exige d'être présent à chacun de vos concerts, mademoiselle ». Le pauvre homme, pensa-t-elle, il sera réduit à venir m'applaudir dans des églises de seconde zone, des salles des fêtes miteuses, des maisons de la culture poussiéreuses, peut-être même des Ephad.
Alors, une révolution se fit en elle.
Bien sûr, elle aurait aimé se produire sur les scènes les plus célèbres, devant les plus illustres publics, jouer pour les rois et les princes, donner des récitals caritatifs afin que les puissants mettent la main au portefeuille – pas pour elle, la seule renommée de ses pairs lui suffirait amplement, mais pour la bonne cause. Elle aurait aimé faire le tour du monde. Changer d'hôtel chaque semaine, plusieurs fois même. Etre reçue dans les palais, les ambassades. Mais avant tout, jouer. Jouer et encore jouer. Toujours. Elle ne pouvait vivre sans.
Et, là, face à cent cinquante personnes, dont certains venaient chaque Noël pour elle, elle sut qu'elle allait réussir sa vie. Oui, parfaitement ! Elle allait jouer, évidemment. N'importe où, devant n'importe quel public. Des petits vieux à moitié sourds étaient-ils moins importants que les grands de ce monde ? N'avaient-ils pas droit, eux aussi, eux surtout, à la magie de la musique, à sa beauté, même s'ils ne la ressentaient pas comme des spécialistes.
Elle allait jouer. Toute sa vie. Dans des petites salles, des cabarets, devant des enfants et des vieillards. Ceux qui n'y connaissaient rien. Surtout eux. La musique s'adresse à tous, sans aucune distinction. Qui était-elle pour hiérarchiser ainsi son public ? Rien ne l'arrêterait. Elle y mettrait toute son âme, toute sa science, ne cessant de s'améliorer.
Tout ça, elle le devait à ce petit homme qui s'avançait maintenant vers elle. Elle qui tenait son violon et son archet le long de son frêle corps. Il ne prononça qu'une parole. Merci.
Puis l'Homme qui lui avait prêté son instrument, suivait, son grand chapeau à la main. Il le posa sur un guéridon juste à côté d'elle. Il y laissa tomber un billet vert. Deux cents euros.
Derrière lui s'était formé une chaîne, comme lors de la communion. Comme lors d'obsèques, lors des remerciements. Seulement, à cet instant, au cœur de cette nuit de Noël, on n'enterrait personne. On célébrait. On donna dix, vingt, cinquante euros, parfois plus. Le chapeau fut bientôt trop petit. On remplit alors l'étui à violon.
Elle ne comprenait plus.
Etait-ce l'oeuvre du maître ?
Ca ne pouvait être autrement. Il avait parlé autour de lui des droits d'inscription à la prestigieuse école. Les auditeurs de chaque messe de minuit étaient venu ce soir contribuer à son avenir à elle. Ils en avaient aussi parlé autour d'eux. Une tache d'huile qui allait se répandre parmi les amoureux de la musique mais aussi les autres, tous ceux qui ont le cœur sur la main, qui n'hésiteraient pas à venir en aide à leur prochain. Pour qu'il puisse réaliser sa vie. N'était-ce pas ce que prétendait le prêtre dans ses homélies, ce qui était écrit depuis deux mille ans dans les évangiles, n'était-ce pas, finalement, la parole divine ?
Elle intégra le conservatoire national à la rentrée suivante. Elle obtint son diplôme avec les compliments du jury. Elle devint soliste. Fit le tour du monde. Joua dans les plus grandes salles, devant un public prestigieux. Elle rencontra des ministres, des princes et des rois. Elle enregistra les pièces les plus ardues. Elle porta son art à sa perfection.
Cependant, jamais elle ne dérogea à cette simple promesse qu'elle s'était faite une nuit de Noël, dans cette petite église de quartier : jouer pour tous, sans distinction d'âge, de rang social, de compte en banque, de couleur de peau, de foi et même d'intérêt pour la musique.
Jusqu'à se produire dans le métro.