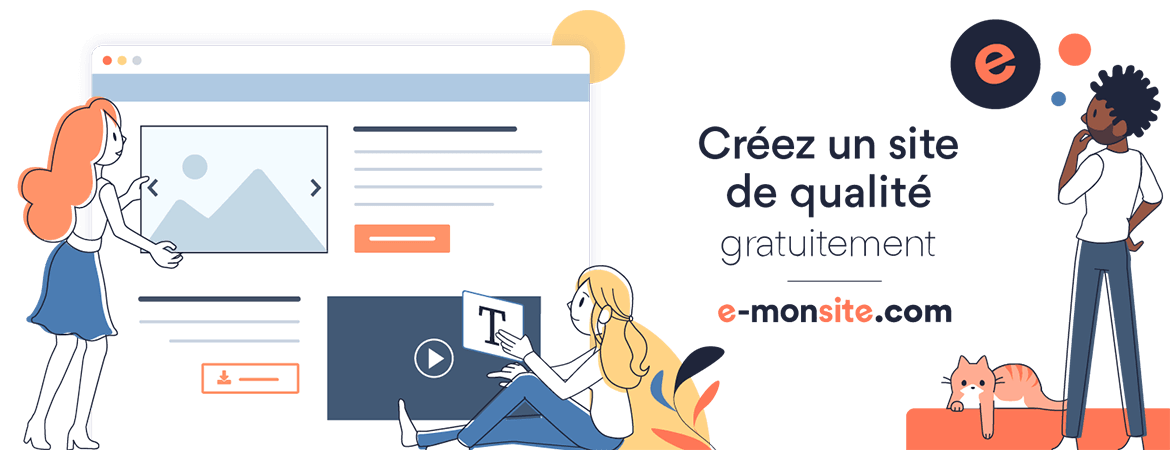la Légende du Père Noël
Cette année là, je grandi de douze virgule cinq centimètres. Si je peux être à ce point précis, c'est que papa avait disposé un ruban gradué le long du chambranle de la porte de la cuisine. Dès que je pus tenir seul sur mes jambes, il traça, chaque trimestre, le jour du changement de saison pour être parfaitement exact, un trait au feutre bleu nuit, correspondant au sommet de mon crâne.
Cette année-là, je gagnai donc quasiment dix pour cent de ma hauteur. Mais, dans ma tête, je vieilli de quelques années en un seul jour. Le 25 décembre.
Je suis né quelque part dans le quart nord est du pays, là où les collines ne se nomment pas encore montagnes, mais qui permettent, d'une part, de se rapprocher de Dieu si tenté que celui-ci existe bel et bien et qu'il réside quelque part aux cieux et, d'autre part, font mal aux mollets des champions colorés du Tour de France. L'un de mes premiers souvenirs d'enfance est un essaim d'abeilles de toutes les couleurs qui passa devant mes yeux, en ébouriffant mes quelques mèches de cheveux tirant sur le blond par le déplacement d'air du peloton lancé à pleine allure.
L'autre souvenir de ma plus tendre enfance est et restera, non le parfum citronné d'une quelconque madeleine, mais un homme à la longue barbe blanche. Non, pas lui. Pas encore.
Cet homme que je n'ai jamais appelé autrement que pépé, était le père de mon père.
Cet homme n'avait pas d'âge. Il était la sagesse incarnée. Il n'était d'ailleurs pas un homme. Il appartenait à une autre espèce. Une force physique et morale peu communes. Un roc. Immuable. Rien ne pouvait lui arriver et, par conséquence, rien ne pouvait m'arriver de grave en sa compagnie.
Dès que j'eus six ans, j'allais passer une partie des vacances d'été et une semaine à Noël chez pépé. Il habitait une vieille chaumière perchée tout en haut de la colline. La dernière habitation de la commune, qu'on ne pouvait atteindre qu'en marchant les cinq cents derniers mètres sur un sentier caillouteux.
Pépé n'a jamais eu de voiture. Pas même un vélo.
Il possédait deux jambes et ça lui suffisait. Et son robuste dos pour porter de lourdes charges. Quand celles-ci dépassaient son propre poids, il se faisait aider d'Albert.
Albert était un serviteur fidèle et dur au mal. Mais terriblement capricieux. Albert était un âne du Poitou, échoué dans ces douces montagnes on ne sait comment.
Pépé prenait régulièrement sa défense.
Un cheval possède une bonne mémoire mais est parfaitement stupide. Aucun d'entre eux ne fera jamais preuve d'initiative et sera désarmé devant toute nouvelle situation. Le cheval est peureux et s'affole d'un rien. Le cheval est à l'âne ce que la brebis est à la chèvre, le chien est au chat. Obéissant, certes, mais pas très futé. Du reste, ne dit-on pas qu'il est la plus belle conquête de l'homme. Or, on ne dominera jamais vraiment un âne. Il garde toujours son indépendance et son libre arbitre.
Albert faisait preuve d'une intelligence hors norme. On ne le commandait pas, on tentait de le persuader.
Cela demande davantage de jugeote assénait sans rire pépé.
Pendant ces journées de grande liberté, il m'a tout apprit. Comment fabriquer un sifflet dans de l'écorce de frêne ; les plantes qui soignent et celles qui guérissent. Où trouver les baies délicieuses, les racines à l'arrière goût sucré ou musqué. Savoir lire la météo dans le ciel : du jour au lendemain, ses prévisions étaient toujours confirmées. Comment capturer la truite dans le ruisseau ou approcher les animaux de la forêt sans les effrayer.
Pépé n'était pas chasseur : il préférait voir les biches bondir, les renards se faufiler dans les fourrés, les sangliers fourrager que les accommoder dans son assiette. Pourtant pépé était un fameux maître queue. Choux, pommes de terres, carottes, navets, poireaux, haricots, lentilles avaient une saveur incomparable une fois passés entre ses mains.
Je jouissais d'une immense liberté quand j'étais en villégiature dans la cabane perchée. A l'aube des jours ensoleillés, l'astre venait me réveiller par un rayon qui traversait obliquement la petite fenêtre de la chambre située sous le toit. Pas besoin de réveil matin. Pépé était toujours debout quand je prenais mon petit déjeuner. Parfois, il avait même déjà effectué une belle besogne : hacher les bûches qui viendraient alimenter le feu de cheminée l'hiver venu ou désherber le carré de potager à l'arrière de la bicoque, là où s'épanouissaient tous les légumes qui allaient finir dans nos assiettes.
Le rituel était toujours le même : un grand bol de chocolat chaud qu'on faisait mijoter cinq bonnes minutes à feu doux afin que les arômes du chocolat se dilatent. Le chocolat n'était pas cette poudre sans saveur qu'on vend à prix d'or et qui contient davantage de sucres que de cacao. Pépé achetait de grosses tablettes mal dégrossies. Il les râpait ensuite, enfin c'était là ma corvée – corvée est un bien grand mot : c'est lui qui m'a apprit à supporter les occupations désagréables parce qu'elles étaient le support de plaisirs futurs.
Tu vois, gamin (il ne m'a jamais appelé autrement, mais il mettait tellement de douceur et d'attention dans ce simple mot), tout est utile dans ce bas monde, même ramasser les poubelles. Surtout ramasser les poubelles. Tu imagines notre chaumière si y on laissait s'entasser les détritus, jour après jour ?
Les copeaux de chocolat étaient mélangés avec un peu de lait froid et une pincée de cannelle. Il fallait touiller bien fort pour obtenir une pâte que l'on allait faire chauffer en y ajoutant peu à peu le reste du lait. Juste avant ébullition, on réduisait le feu pour faire mijoter cinq minutes en n'arrêtant pas de tourner la mixture avec une pauche en bois. Ce petit rituel prenait toute sa saveur les matins d'hiver, avant que le jour ne vienne éclaircir la campagne et qu'une pellicule de givre recouvre les carreaux, que les parfums de cannelle emplissent l'unique pièce à vivre. Je me sentais alors le plus heureux des petits garçons.
Pépé faisait son pain lui-même dans un vieux four à bois situé contre la cabane. J'avais droit à deux belles tranches bien croustillantes, nappées de confiture d'airelles, framboises, fraises des bois, mûres, figues, groseilles... Toutes les baies que nous allions récolter par les chaudes après midi de l'été. J'aimais bien cette idée temporelle : je retrouvais là, étalé sur ma tartine les saveurs de l'été et je me rappelais les taons qui nous agaçaient, la sueur qui dégoulinait sur les yeux, les retours précipités devant l'arrivée soudaine de l'orage... Avec lui, j'ai appris à me situer à la fois dans les lieux et dans le temps.
J'ai aussi apprit à apprécier les petits déjeuner anglais – pour lui, c'était simplement le bon sens et en aucun cas un effet de mode.
Il faut manger le matin comme un prince, à midi comme un valet et le soir comme un mendiant aimait-il à répéter quand on s'étonnait de le voir engloutir lard, saucisse, tomme, pommes de terre au four dès potron-minet.
Pour accompagner mon grand bol de chocolat bien chaud, outre les tranches de pain maison, quelque viennoiserie qu'il s'appliquait à cuire dans le four encore chaud les jours de boulange, du fromage caillé et, pendant l'été, un bol de fruits fraîchement cueillis la veille.
Les journées n'étaient jamais pareilles. Il y avait toujours quelque chose à faire. Une tuile à changer, du bois à rentrer ou à débiter en bûches. Pépé n'avait évidemment pas de tronçonneuse.
Je ne suis pas venu m'exiler en dehors du tumulte des hommes pour saccager mes oreilles avait-il l'habitude d'affirmer face à tous ces appareils à moteur qui remplacent avantageusement nos muscles mais nous privent en même temps de notre dextérité, nous empêchent de savoir utiliser au mieux nos dix doigts.
Toutes ces activités imposées par une vie solitaire, ne devant compter la plupart du temps que sur soi-même, n'empêchaient pas les balades en forêt, les contemplations de ciels changeants, les réflexions un brin d'herbe aux lèvres à regarder un paysage sublime et, parfois, les animaux qui l'habitent déambuler comme si nous n'étions pas là, du moins comme si nous ne leur voulions pas de mal.
L'homme est le plus grand prédateur du monde soutenait-il mordicus. Tous les animaux s'en méfient, y compris le loup. S'il a si mauvaise réputation dans les contes et légendes, n'est-ce pas parce qu'ils ont été écrit par l'homme lui-même ? Oui, l'homme est un nuisible, y compris pour lui-même. Bien pire que le plus féroce des loups.
Je raffolais de ces périodes de vacances, toujours trop courtes, et le confort spartiate de la cabane ne me gênait pas le moins du monde. Vivre à dure permettait de mieux savourer les petits plaisirs de la vie. Mais il y avait une période que je vénérais sans égale. La semaine d'avant Noël.
Les préparatifs de la grande fête annuelle me réjouissaient au-delà de toute mesure.
J'aimais tout. Les échappées dans la forêt encore dégoulinante des averses de la veille à la recherche de houx fleuri, de feuilles colorées, de pommes de pin que je passais ensuite de longues après-midi neigeuses à décorer avec une habileté plus que douteuse. Pépé me regardait d'un œil malicieux. Lui parvenait à faire des merveilles avec un pinceau. Il possédait l'art d'accommoder les couleurs et pouvait se glorifier d'un joli coup de crayon.
Nous décorions l'unique pièce pendant que le four exhalait les doux parfums des bredele, ces petits sablés de Noël, qui cuisaient lentement. Biscuits aux amandes, parfumés de cannelle, d'anis, d'orange. Petits gâteaux en pain d'épice ayant la forme de pantin, autres formes savamment dessinées par pépé que je découpais la langue entre les dents pour mieux m'appliquer.
Des farandoles de bonhommes en papier pendaient au plafond. Des guirlandes naturelles d'herbes tressées.
Puis il y avait le 24 décembre. Dans mes souvenirs, c'était ma journée préférée. Mieux que le jour même de Noël, entendu que les préparatifs d'une fête sont plus passionnants que la fête elle-même.
Il régnait dans la pièce une ambiance électrique. Un bon stress, de ceux qui vous font vous dépasser vous-même.
Les parents avaient pour habitude de venir sur les coups de midi. Pépé n'avait jamais voulu quitter sa cabane isolée pour partager cette magie des fêtes en ville, chez les fous - comme il avait habitude de dire. Pour lui, dès qu'un village dépassait ce nombre approximatif de personnes où il était impossible de se rappeler le nom et quelques indications basiques (marié ou pas, nombre et prénoms des enfants, occupation professionnelle, passion, couleur des yeux, taille de la maison, marque de la voiture, habitude langagière, tics divers), cela devenait une ville avec tout son contingent de dérives modernes : pollution, indifférence, précipitation sans but apparent, futilités diverses et disparition des valeurs. Une déshumanisation paradoxale : plus l'humain s'assemblait, moins il réagissait en homme.
Cette année-là, nous devions être début Novembre. Le 2 pour être précis. Déjà, le soleil avait abdiqué. Depuis un mois, il peinait à gravir l'immensité bleue du ciel, laissant la place à ces brumes indistinctes qui remplacent les nuages les jours de mauvais temps. Il ne faisait pas froid, juste une humidité ambiante, pas même de franches averses, une imprégnation qui vous glace mieux qu'un bon et franc frimas de Janvier. Déjà, je ne l'aimais pas, ce triste mois de Novembre. Ca n'allait pas s'arranger.
Je me rappellerai toujours cette après-midi maussade où le crépuscule avait de l'avance sur l'horaire habituel. Il faisait sombre comme dans une cave mal éclairée quand je rentrai à la maison. L'école n'était située qu'à moins d'un kilomètre, séparée de notre petite maison que par un vaste parc où j'aimais baguenauder les beaux jours. J'y retrouvais, en partie seulement et avec un bel effort d'imagination, les sensations de la majestueuse forêt qui bordait la cabane de pépé. Les oiseaux pépiaient à peu près les mêmes airs, le vent jouait sa partition sensiblement de la même façon que dans les grandes orgues des sapinières, la rumeur de la circulation était tout juste atténuée, laissant croire à un bout de nature sauvage, ici, au cœur même de la cité trépidante.
Ce jour-là, tête baissée, je filais en ligne droite, insensible aux éléments. Les oiseaux ne chantaient plus, le vent était tombé et les bras des arbres semblaient pendre en désolation : ils se dépouillaient de jour en jour. Même les résineux me semblaient d'une tristesse morose. Le ciel était gorgé de brumes comme un marécage tendu au-dessus de nos têtes.
J'étais à la maison un bon quart d'heure avant l'heure habituelle. Maman me jeta un regard qui disait à peu près ceci : « oui, je comprends, ce n'est pas une journée pour gambader ».
Mais il y avait autre chose dans son regard. Une tristesse qui n'avait rien à voir avec le désastre météorologique enduré depuis trois jours. Nous nous regardâmes avec cette intensité qui précède les grandes révélations.
Alors, je sus. Comme une évidence.
Qu'est-ce qui peut peiner un petit garçon de huit ans ? La disparition de son animal de compagnie ?
Nous n'avions ni chat, ni chien.
L'annulation d'un goûter d'anniversaire ?
Le mien était situé en plein mois de Juin.
Un grave accident routier touchant quelqu'un de proche, papa peut-être ?
Précisément ce jour-là papa s'était rendu à son travail en bus.
Ne restait plus qu'une hypothèse. Je frémis. Maman hocha la tête. Elle venait de comprendre que j'avais compris.
C'est pépé, fit-elle, sans autre précision, comme une évidence. Dans ces trois mots, toute la tristesse du monde.
L'été passé, je l'avais trouvé un peu changé, pépé. Bien sûr, fierté de montagnard oblige, il n'en laissait rien paraître, mais j'avais remarqué comme une tristesse, une fatalité dans son regard quand il ne se sentait pas observé. Des grimaces de douleur contenue qu'il masquait assez mal. Aux rares questions que je posais sur sa santé, il me souriait, l'air rassurant, prétextant n'importe quel petit désagrément. Un repas trop lourd, la chaleur trop prononcée ou, à l'inverse, un petit vent froid se levant soudainement, un air vicié transportant des miasmes de pollution venue de la plaine, de la ville... Je lui souriais en retour, donnant le change, mais comprenant que quelque chose ne serait plus jamais comme avant. Pépé vieillissait comme tout le monde. Comme moi-même. Mais chez lui, cela ne se traduisait pas par quelques centimètres gagnés d'un trimestre à l'autre.
Chaque jour, chaque minute, nous perdons quantité de cellules mortes. Quasiment toutes sont remplacées aussi sec. Notre corps n'a jamais plus de cinq ou six ans d'un point de vue cellulaire. Seulement, dans le lot, certaines ne se régénèrent pas, à commencer par les neurones, ces particules qui permettent à ce que nous appelons l'intelligence de briller.
Tout ça, je ne le savais pas encore. Pas avec autant de précision qu'aujourd'hui. Je ne m'en portais pas plus mal.
Maman me prit dans ses bras. Ca n'arrivait pas souvent, du moins pas tous les jours comme chez Antoine, mon copain d'école, où les effusions maternelles étaient récurrentes sitôt qu'il rentrait de l'école ou lorsqu'il s'apprêtait à partir dans le petit matin sombre. Le cordon ombilical était encore bien présent chez Antoine. Parfois, je me demande ce qu'il a pu devenir, le petit Antoine avec son zeveu zur la langue. Je ne suis pas du genre nostalgique, mais il m'est arrivé, un morne soir de Novembre justement, où mon avenir professionnel semblait compromis, de regarder cette photo de classe, cm1 école des Grands Prés, année 1976-1977, et supputer la carrière et la vie de chacun et chacune.
Zoé, la petite brune aux lunettes démesurées qui se désolait de ne pouvoir intégrer l'équipe de football à cause de ses prothèses oculaires, a-t-elle troqué ses carreaux de vitrier contre une paire de lentilles de contact et débuté une grande carrière de footballeuse professionnelle ?
Martin, le grand costaud, le fils du boucher, fait-il désormais jouer ses muscles de Popeye dans l'arrière salle de la boucherie familiale ?
Guillaume, à l'inverse, frêle et timide, oeuvre-t-il dans l'ombre d'un ministre, conseiller d'un grand patron ou encore se cache-t-il derrière le pseudonyme d'un auteur à succès ?
Marion, la fine blonde aux faux airs scandinaves, dont je fus, le temps d'un été, secrètement amoureux, est-elle devenue le top model que j'imaginais ?
Mais, à cet instant ce cette après midi mourante de début Novembre, je suis blotti dans les bras de maman, sans verser une seule larme. Certains chagrins sont trop gros pour provoquer un vulgaire épanchement lacrymal. Il est des souffrances qui ne pleurent qu'à l'intérieur, comme le chantera plus tard Jean Jacques.
Le lendemain, nous prenions la route des vacances, mais pas pour les bonnes raisons.
Cette route, je ne l'avais quasiment jamais parcourue. Début Juillet ou une semaine avant Noël, papa ou maman – selon leur disponibilité – m'accompagnait à la gare centrale de la ville d'où je montais dans un omnibus – je disais la micheline – qui filait droit à travers les premiers moutonnements de la campagne jusqu'au cœur du massif. A cette époque, la compagnie des chemins de fer du Grand Est, n'avait pas encore été optimisée et desservait les infimes bourgades perdues au fin fond des vallées. Très souvent, j'étais le seul passager de la rame. A l'arrivée, sous un soleil mourant de fin de journée en Juillet ou sous une fine bruine glacée de Décembre, parfois la réjouissance d'arriver sous la neige, pépé m'attendait. Il avait attelé Albert à une antique carriole qui battait de l'aile et nous entamions la longue montée jusqu'à la dernière cabane du village dans un inquiétant couinement d'essieux.
Cette fin de journée pluvieuse de Novembre ne ressemblait en rien à mes arrivées triomphales au pays de pépé. Les sapins étaient désolés, pleurant des larmes de pluie le long de leurs branches tombantes comme les bras de ceux qui ont renoncé. Le ciel n'était qu'un amas de nuées imprécises, une mer de gouttelettes en suspension bousculées par de fortes rafales de vent.
Le corps du vieil homme reposait dans une salle sans âme du funérarium de la bourgade, jouxtant le cimetière. J'étais choqué. Jamais de la vie pépé n'aurait supporté d'attendre sa crémation ailleurs que chez lui, dans la petite cabane accrochée à la montagne.
Remarquant mon air renfrogné, maman m'expliqua que ce n'était pas facile pour les pompes funèbres de garder le corps à la cabane et puis, on n'allait pas le laisser seul là-haut. Comme j'arguais que pépé était bien tout seul dans cette salle impersonnelle et qu'il le resterait toute la nuit, alors que nous aurions été à ses côtés une dernière fois dans sa chaumière, elle eut un sourire de commisération, caressa ma tête, en soufflant un « je sais, mon chéri » qui ne me réconfortait nullement. Tout à coup, le monde des adultes me parut incompréhensible.
Pépé avait souhaité être incinéré et pas de tralala religieux. Cérémonie civile. Je crois même qu'il aurait préféré pas de cérémonie du tout et si les circonstances lui avaient permis, il n'aurait rien aimé plus que de disparaître en pleine mer. Dans la rivière de la vallée ou au cœur de la forêt, il y aurait toujours eu quelqu'un pour le repêcher.
Le lendemain, je portais mon beau costume sombre, inauguré pour le mariage de Nelly et Arnaud, des amis de papa, un beau jour de Juin dernier. La pluie avait cessée, un pâle soleil perçait au travers de brumes qui de déchiraient lentement, faisant tomber le mercure en dessous des normales saisonnières.
La cérémonie fut assez vite exécutée. La petite troupe de vagues connaissances – pépé, en solitaire, n'avait pas vraiment d'amis proches, mais on connaissait l'ancien et, même si on le trouvait un brin excentrique, on l'aimait bien, comme un bâtiment qui fait partie du paysage – s'éparpilla lentement. Juste une poignée de personnes qui se voyaient plus concernés ou, plus sûrement, qui n'avaient rien de mieux à faire, se réunit autour de mes parents. Ici, dans ces hautes vallées, la tradition veut que l'on se retrouve autour d'un breuvage quelconque, la plupart du temps un alcool fort (cognac, calva, prune) pour les messieurs, un café pour les dames. Pour l'occasion, on investit le café du coin, plus rarement on se rassemble à la maison du défunt.
La vie reprend toujours le dessus et, passé les cinq premières minutes où chacun pleure intérieurement la disparition d'un être cher, on en vient à se remémorer les bons moments partagés avec celui qui ne sera, désormais, plus qu'un souvenir, plus ou moins vivace, plus ou moins présent.
Un premier éclat de rire résonna dans la salle. Toutes les conversations feutrées se turent à l'instant. Chacun regardait en biais celui qui s'était égaré dans un sentiment hors de propos. L'homme, un grand dadais allant sur les quatre vingts ans, regarda autour de lui, un peu péteux d'avoir manqué à la plus élémentaire convenance. Il se justifia. Il narra alors, pour l'assemblée complète cette fameuse anecdote que pépé m'avait maintes et maintes fois relaté.
C'était l'occupation. L'armée allemande prenait ses aises, à quelques lieues à peine du territoire alsacien, parfaitement annexé au grand Reich. C'était le plein été, 1942 ou 1943, l'année diffère selon les versions. Il faisait une chaleur à chauffer le métal. Pépé était en forêt à débiter quelques troncs pour sa réserve de l'hiver suivant lorsqu'il entendit une troupe de la Wermacht dans l'une de leurs marches dans le massif. Ca rigolait et chantait comme des patachons. Par pur réflexe, pépé avait lâché sa hache et s'était dissimulé dans un buisson.
Soudain, la compagnie fit halte sur les rives du petit lac d'altitude qui reflétait les cimes des sapins, aux eaux sombres et fraîches. Sous le regard médusé du voyeur planqué dans le fourré à proximité, voilà que l'escouade pose l'uniforme vert de gris, casques, bottes et tout un lot de sous-vêtements et court, dans le plus simple appareil, se rafraîchir dans les eaux calmes du petit lac.
Ca s'éclaboussait en poussant des jurons gutturaux, ça riait aux éclats en chantant de plus belle. Même si pépé ne comprenait pas les paroles, au ton graveleux il se doutait qu'en Germanie, on connaissait aussi toute une bordée de chansons paillardes. Tout à leurs gesticulations et leurs barbotages, le régiment ne se rendit pas compte que, là-bas, discret comme le lynx, une silhouette rassemblait dans le grand sac prévu pour rapporter les petits branchages, idéals pour démarrer le feu, tous les vêtements laissés en désordre sur le bord du chemin. Ainsi chargé, pépé ne demanda pas son reste et se faufila entre les branches basses, son lourd et imposant fardeau sur le dos. Il ramena le tout à la chaumière et fit sûrement la plus belle flambée de sa vie, par un soir de canicule !
Pendant tout le trajet, pépé ne rit pas une seconde. Le chargement était imposant, pesait son poids et si d'aventure il était tombé sur une patrouille, il aurait eu l'air fin. Mais une fois à l'abri de sa cabane il ne put se retenir de rire en imaginant la douzaine de soldats allemands, seulement vêtus de branchages, débarquant à leur garnison, nus comme des vers, excepté leur casque. Il eut d'ailleurs les échos de son œuvre quelques jours plus tard. L'histoire s'était ébruité malgré les injonctions de la hiérarchie. En effet, un soir, un commandant un peu plus éméché que d'habitude, n'avait pu se retenir de raconter l'épisode au garçon qui officiait au comptoir du café du centre, celui-là même où nous nous trouvions quelque trente ans plus tard à relater les aventures de celui qu'on venait d'incinérer il y a une heure à peine.
Les confessions du commandant ne tombèrent pas dans l'oreille d'un sourd : le lendemain, tout le village était au courant des péripéties de la troupe rentrée à poil à la garnison, leur casque en guise de cache-sexe !
On menaça les pauvres garçons de les envoyer sur le font de l'est. Il n'y eu aucune représailles : c'était reconnaître implicitement l'épisode du bain improvisé et couvrir, dans le même mouvement, toute la garnison d'un ridicule définitif.
Et là, au milieu de cette petite foule qui avait connu mon pépé, je fus si fier de lui que j'ai compris à ce moment là qu'on ne meurt pas réellement quand notre corps devient froid. La chaleur du souvenir continue à perdurer dans la mémoire de ceux qui ont partagé la vie de celui qui n'est plus présent physiquement, mais qui continue de vivre à l'intérieur des autres.
Un mois passa. Et ce fut le Noël le plus triste de ma vie. Du moins, je pensais qu'il le fut.
Voilà ce qu'il se passa.
Pour la première fois depuis ce qu'il me semblait une éternité, j'allais passer les fêtes à la maison, cet appartement situé au cœur de la ville. Une éternité qui n'était que trois années. Trois malheureuses années, depuis mes cinq ans. Mais le temps n'est pas homogène : il se détend selon les circonstances. Enfant, une année semble durer un siècle, puisqu'à cinq ans, cela représente vingt pour cent de notre vie, tandis que pour un quinquagénaire ce n'est plus que deux minuscules pour cent de son existence.
D'autre part, le temps ne s'écoule pas de la même façon selon qu'on attende le résultat d'un examen crucial, qu'on patiente dans une salle d'attente, rongé par la crainte d'une terrible nouvelle, que l'on soit immobilisé par la maladie, l'handicap ou, à l'inverse, que l'on passe de merveilleux moments. Pourtant et paradoxalement, c'est l'habitude qui raccourcit notre perception du temps.
Ainsi ces trois Noëls et autant de vacances d'été, même si je ne voyais pas le temps passer puisque j'étais à peine arrivé qu'il me fallait déjà rentrer, le temps se distordait en se remplissant exagérément de souvenirs immuables. Des images pour toute ma vie future. Et plus il y a de choses dans un espace, plus celui-ci semble grand. Vivre constamment les mêmes choses, répéter des journées identiques ne procure aucun souvenir mémorable. Le temps s'efface en s'accumulant.
Les préparatifs des fêtes avaient une toute autre saveur. Si les gestes demeuraient les mêmes, je ne pouvais m'empêcher de faire des comparaisons. Le vaste appartement me semblait plus exigu que la modeste cabane des bois. Le sapin moins majestueux. Les guirlandes moins magiques. Et les odeurs de biscuits qui cuisent dans le four n'avaient pas ces mêmes arômes acidulés, épicés, exotiques.
A part les longues balades en forêt, les pieds dans la neige, mes activités restaient les mêmes mais elles ne concernaient plus que mes muscles. Mon esprit, mon âme étaient ailleurs.
Et ce fut la nuit de Noël car, quoique l'on pense, quoique l'on fasse, le temps continue de s'écouler, imperturbable. J'étais un peu anxieux et nerveux ce soir-là.
Nous avions dîné en famille. Le repas était succulent, les rires fusaient, la bonne humeur était de mise, mais tout au fond de moi, le souvenir de pépé empêchait un épanchement total de ma part. Une mélancolie s'accrochait de toutes ses griffes aux parois de mon esprit. Le fantôme d'une insondable tristesse planait dans mon cœur.
Je me retournais dans mon petit lit, ne trouvant pas le sommeil. Je pensais à ces veilles de Noël où j'avais tenté de résister au sommeil qui m'envahissait, dans le seul but de surprendre le fameux Père Noël avec sa hotte sur le dos, en train de déposer les précieux cadeaux enluminés au pied du sapin. Mais, l'agitation et l'excitation de la préparation du grand jour m'avaient fatigué outre mesure et je sombrais à chaque fois dans un profond sommeil jusqu'au lendemain, lorsque le soleil venait me réveiller, bien au-delà de l'heure habituelle. Ma déception d'avoir loupé le mystérieux bonhomme en rouge était vite effacée par la découverte, bien réelle, des paquets cadeaux autour de l'arbre sous les regards attendris de mes parents et l'oeil amusé de pépé. Je le soupçonnait de se lever en pleine nuit de Noël et d'offrir un bon verre de gnôle au visiteur emmitouflé. A chaque fois que je lui posais la question, il avait un malicieux sourire et me glissait dans un souffle « tu le sauras bien assez tôt ».
Cette nuit là, il devait largement être plus de minuit, quand j'entendis un craquement, comme un bruit de quelqu'un qui ne veut pas faire de bruit. J'en étais sûr, ça ne pouvait être que lui ! En étant très discret et en faisant le moins de bruit possible, j'allais enfin rencontrer le vrai père Noël – non ces copies pas toujours ressemblantes qu'on rencontrait lors des marchés de Noël. Devant mon air interrogateur, pépé m'avouait que tous ces père-Noël de pacotille n'étaient que des réclames, de la publicité, pour le vrai, le seul. Comme s'il envoyait des commerciaux au travers de toutes les villes et villages pour rappeler sa venue, dans la nuit du 24 au 25 décembre.
L'explication me convenait parfaitement. Du reste, à cette époque lointaine, la frénésie autour des fêtes n'avait pas encore atteint son apogée : les faux pères Noël étaient rares. En revanche, je trouvais parfaitement normal que le seul et l'unique puisse, en quelques heures à peine, livrer des milliers, des millions de foyer. L'esprit d'un petit garçon ne s'embarrasse pas de ces contraintes de temps et d'espace, d'où le succès des super héros. Pour un enfant de six ans, il est parfaitement normal qu'un être de chair et de sang puisse se trouver à plusieurs endroits au même moment, qu'à deux kilos de jouets en moyenne par enfant, son chargement puisse être tracté par un attelage de rennes volant dans les cieux qui plus est. Lorsqu'on a envie d'y croire, ces futilités répondant aux dures lois de la physique ne pèsent pas lourd dans la balance.
Je me glissais prudemment de mon lit. Je savais que l'ouïe du Père Noël était si fine qu'il était capable de percevoir la chute d'une plume sur un édredon à plusieurs lieues de distance. J'entrepris de descendre à pas de loup l'escalier qui menait aux pièces du bas : la cuisine et le vaste salon dont la large baie vitrée apportait lumière du jour et vue sur les toits de la ville. Là, tout était d'un noir d'encre. Juste une loupiote était allumée dans un coin.
Sans avoir cherché à en apprendre davantage, il me semblait pourtant que le Père Noël ne devait pas utiliser la technologie des hommes et préférer l'emploi de vers luisants pour éclairer les chaumières qu'il visitait lorsque celles-ci ne possédaient pas de feu dans leur cheminée, comme c'était le cas ici, dans cet appartement au cœur de la ville.
Patrick, un de mes camarades de cour d'école m'avait assuré qu'il fallait toujours laisser une lumière allumée dans la maison le soir de Noël sinon le Père Noël, n'y voyant que goutte, pourrait se tromper de paquet ou, pire, rebrousser chemin et offrir le fabuleux train électrique tant désiré au petit chenapan de voisin qui terrorisait les chats du quartier. Je lui répondais que la vue du Père Noël était suffisamment perçante pour éviter ce désagrément et lui parlais aussi des vers luisants. Cela l'avait un peu convaincu. En revanche, le grand Jérôme, dont toute l'école redoutait les bousculades, allait jusqu'à prétendre que le Père Noël n'existait pas. Que c'étaient nos propres parents qui déposaient les cadeaux au pied du sapin. Toute la classe s'était offusquée, par réflexe. Mais l'idée avait fait son chemin et certains commençaient à douter. Alors, je trouvai l'argument pour faire taire ces fausses rumeurs destinées à semer le trouble dans nos esprits, comme savait si bien le faire l'imposant Jérôme.
Si les parents se substituaient au Père Noël, comment expliquer que David, de l'assistance publique, avait lui aussi des cadeaux au matin du 25 ?
Tout le monde me regarda, puis interrogea Jérôme du regard. Cela dura dix secondes. Dix secondes pendant lesquelles aucun bruit ne traversait le préau. Dix secondes les plus calmes de toute l'histoire des récréations de l'école. Alors, Jérôme, pour ne pas perdre la face, bredouilla que c'était justement l'exception, comme dans ces détestables règles grammaticales de monsieur Lantier. Il tourna les talons en me jetant un regard belliqueux. Je savais ce que ça voulait dire. Avant le lendemain, il avait trouvé une occasion de me bousculer avec tant de violence que j'avais volé sur plusieurs mètres avant de percuter le coin métallique de la salle de gym. Le poignet fracturé. C'était bien la preuve qu'il avait tort. Quand on ne possède pas les arguments, on fait parler ses muscles.
J'étais maintenant à quelques mètres de l'homme en rouge, j'entendais le bruit de quelqu'un qui farfouille dans sa besace pour en retirer les colis endimanchés.
J'étirais ma tête comme un périscope.
Et là, ce fut le drame.
Devant moi, papa en pyjama, les cheveux en bataille. Il devait sortir du lit. Un moment, afin de refuser l'horrible vérité, je me convainquis que, lui aussi, désirait rencontrer le fameux personnage si discret. Mais mon optimisme sombra très vite quand je m'aperçus qu'il disposait lui-même les cadeaux qu'il tirait non pas d'une magnifique hotte en roseaux tressés, mais d'un vulgaire sac de commissions élimé.
Tout s'effondrait autour de moi. Ainsi Jérôme avait bien raison contre l'immense majorité de l'école – même madame Pouffin, la maîtresse des petits et encore monsieur Lantier, notre si ascétique instituteur, à qui on avait demandé des précisions, avaient été très clairs : bien sûr que le Père Noël existait.
Je vis alors Jérôme hausser les épaules, mais ne remarquai pas le brin d'ironie qui brillait dans l'oeil de notre maître ni même l'étincelle de compassion qui troublait à peine la voix de la maîtresse.
Le monde entier s'était ligué contre ses propres enfants, leur faisant croire des sornettes pour mieux les dominer.
Je remontais l'escalier sans prendre aucune précaution et je crois bien que papa m'entendis – je le vis dans l'éclat de son œil le lendemain quand il me demanda avec une insistance inaccoutumée si j'avais bien dormi.
Une fois dans mon petit lit, je ne pouvais décidément plus m'endormir. Les pensées se télescopaient dans ma tête, dansant la carmagnole. Perdre à la fois son pépé adoré et découvrir que le Père Noël n'existait pas la même année, c'était beaucoup trop pour l'entendement d'un petit garçon de huit ans.
Si le Père Noël n'était ni plus ni moins qu'une légende, comme les fables de monsieur de la Fontaine ou les contes de Perrault, alors à quoi croire ? A qui faire confiance ? Nous étions seuls au monde et nous ne pouvions compter que sur nous mêmes. Mais nous étions des enfants. Rien que des enfants, si fragiles, si faibles, si petits. Encore.
Finalement, je finis par sombrer dans un mauvais sommeil sur la fin de nuit, cette nuit déplorable où j'avais vieilli de plusieurs années en quelques heures.
Il devait être au moins sept heures du matin. Pas un bruit dans l'appartement. Je redescendis l'escalier à pas de loup. Je tenais une lampe torche à la main pour m'orienter afin de ne pas trébucher sur quelque objet délicat qui aurait fit un raffut de tous les diables en tombant. Je dirigeai le pinceau de lumière vers le sapin : les cadeaux étaient disposés en cascade à son pied, donnant l'impression d'une visite merveilleuse pendant la nuit. Pourtant, je croisais le fameux sac à provisions, laissé négligemment dans un coin de la cuisine, preuve irréfutable du crime paternel. Cela entérina ma décision. Je longeais le vestibule, mon petit sac à dos sur les épaules. J'y avais glissé quelques vêtements de rechange, mon kway roulé en boule, ma brosse à dents, une vieille peluche qui ne quittait jamais mon sommeil, un petit carnet dans lequel je notais toutes les grandes questions existentielles qui attendaient une réponse acceptable (si les nombres sont infinis et que les nombres pairs le sont aussi, pourquoi y en a-t-il deux fois moins ? Qu'y avait-il AVANT le commencement de l'univers ? Quelle était la recette des croquants à la noix de coco de la boulangerie Martin?). Je chipais au passage dans la cuisine un paquet de gâteaux, un saucisson à peine entamé, deux pommes et une bouteille d'eau minérale. Je m'apprêtais à ouvrir délicatement la porte d'entrée en ayant un petit pincement au cœur. J'avais laissé une lettre à l'attention de maman, expliquant maladroitement mon geste, justifiant ma décision de quitter définitivement la maison pour aller vivre ailleurs, loin de la dissimulation et du mensonge. C'étaient mes propres mots. Grandiloquents. Mais la situation l'exigeait amplement.
Je refermai le plus doucement possible la lourde porte blindée et j'étais dans le couloir au bout duquel l'ascenseur ouvrit ses portes à mon commandement. Pendant la descente des huit étages, une larme s'est formée au coin de mon œil droit. Je la séchais d'un geste rageur avant qu'elle ne tombe sur ma joue. Pas d'état d'âme, j'étais résolu, sûr de ma bonne décision, la seule possible.
Dehors, la rue était encore éclairée par les lampadaires d'une lumière jaunâtre. Le jour attendrait encore une bonne heure pour étendre ses brumes annonciatrices d'une belle journée de Noël. J'allongeai le pas, direction la gare.
Dix minutes me furent nécessaires pour atteindre la place qui s'étalait devant le large immeuble à l'horloge centrale démesurée. 7h21. Je savais que les guichets seraient fermés, mais j'avais appris que l'on pouvait acheter son billet au contrôleur dans le train, à condition de le prévenir avant sa tournée de contrôle.
Il me restait à découvrir s'il y avait bien un départ suffisamment proche. Si ce n'était pas le cas, inutile de rester à attendre ici, première destination où iraient me chercher les parents.
Sur le grand panneau d'affichage, des noms de villes plus ou moins lointaines, parfois situées à l'étranger. Une invitation au voyage.
Je repérai assez vite ma destination, un nom aux sonorités rugueuses comme ces montagnes qui n'en étaient pas tout à fait. Face à ce nom porteur d'espoir et de délivrance, un horaire et un numéro de voie. 7h37, voie E. Un quart d'heure.
Je m'avançai lentement vers les quais qu'une lourde porte séparait du grand hall carrelé d'une mosaïque à trois couleurs, rose, bleu ciel et jaune pâle. Sur le quai, pas un chat. Juste une odeur d'huile et de goudron. L'odeur des trains en partance. Justement, un omnibus attendait, son moteur diesel ronronnant dans la nuit finissante. J'aimais ces passages souterrains qui desservaient les autres voies. B et C étaient accessibles par un premier long escalier. Un second desservait les voies D et E. Les murs des couloirs étaient tapissés de carreaux rectangulaires d'une blancheur discutable, comme une gigantesque salle de bains, mieux : des bains douches.
Je remontai le large escalier et débouchai sur le quai. Face à la sortie de l'escalier, un encart publicitaire sous verre vantait les plaisirs d'un Cinzano. J'allai, par curiosité, voir au dos si la réclame était la même ou si, par un effet du pur hasard, quel produit allait-on associer au célèbre apéritif. Je fus déçu. Il n'y avait rien au dos de l'affiche. Et pas un train qui attendait sur l'une ou l'autre des voies. 7h28. L'omnibus ronronnait toujours, mais au-delà, plus loin dans l'alphabet des voies, J ou K. A cet instant, j'eus le désir un peu fou de connaître combien la gare disposait de voies. Jusqu'à quelle lettre pouvait-on aller ? Je fis demi-tour. J'avais le temps. Je dévalai les escaliers et tournai à droite. Nouvel escalier, voies F et G. Je pressai le pas. Voies H et I. J'avançai, mon cœur battant davantage. C'est alors que je remarquai une grande affiche collée sur le mur de carreaux rectangulaires de bains douche. Une montagne, une vraie, comme un V renversé, un pic dirigé vers le ciel, un couteau de roches cuivrées qui pointait au travers des brumes s'accrochant à mi hauteur. Le ciel était d'un bleu nuit, contrastant avec les névés d'une blancheur immaculée qui pendaient le long des couloirs vertigineux. Je fus littéralement happé par cette montagne qui défiait les lois de l'apesanteur. 7h33. J'étais hypnotisé par ces lignes d'une pureté sans égale. Des coups de crayons définitifs qui avaient pris des millions d'années à percer la croûte terrestre et qu'une poignée d'homme sans lâcheté désirait gravir au prix de leur vie. Mais, à leurs yeux, rester sagement dans la vallée, pire dans la vaste plaine du grand fleuve, était-ce réellement vivre ? Je sentis naître en moi une nouvelle passion. Mon intérêt pour les étoiles et les galaxies trouvait son lien avec notre bonne vieille Terre : en gravissant ces éperons dirigés vers les cieux, je me rapprocherais de l'univers si mystérieux. 7h35.
Les hauts-parleurs grésillèrent. Un souffle d'air s'en échappa juste avant qu'une voix nasillarde annonce le numéro de mon train et son entrée imminente en gare. Merci de ne pas vous approcher trop près de la voie.
Je fus immédiatement réveillé de mon songe. Alors, je me mis à courir comme un dératé, faillit rater le bon escalier des voies E et F, fis demi-tour en haletant. Je grimpai quatre par quatre les escaliers pour me retrouver sur le quai, le cœur au bord des lèvres. A ma droite, un long train reprenait son souffle après soixante kilomètres sans halte dans la campagne endormie. 7h37. Les trains sont toujours à l'heure quand nous, ne le sommes pas tout à fait.
Je désignai la première porte qui s'offrait à moi. Je grimpai d'un bond et me retrouvai dans un long couloir. La première rame était vide. Je m'assis sur le premier siège. J'étais en nage. Mon cœur gambadait dans ma petite poitrine. Je ne saurais jamais combien y avait-il de voies dans cette gare.
Je ne vis aucun contrôleur. A un moment, un vieux monsieur a traversé tout le compartiment sans même m'accorder un regard. Puis ce furent deux militaires en tenue qui me dévisagèrent plus longuement. Mes parents avaient-ils donné l'alerte ? La gendarmerie avait-elle déployé des moyens hors de proportion pour me retrouver, allant jusqu'à détacher un régiment de l'armée à ma poursuite ? Finalement, les deux troufions continuèrent leur avancée en gloussant comme deux rosières. J'imaginais ces voyageurs marcher indéfiniment le long d'un couloir qui allait d'une gare à l'autre, rendant inutile le, principe du train. Je finis pas d'endormir sur la banquette.
Je sentis qu'on me secouait l'épaule vigoureusement.
Affolé, je me levai, attrapai d'un réflexe mon sac à dos et descendis du train en courant et sans demander mon reste. Dans mon dos, une femme plus toute jeune, employée au ménage des compartiments aux terminus, me regardait sans comprendre.
Sortir du village fut un jeu d'enfant. Je le connaissais bien, ce petit village blotti au creux de la vallée. La voie ferrée ne pouvait aller plus loin : partout, la pente était trop sérieuse pour y hisser plusieurs centaines de tonnes. Pépé m'avait un jour expliqué qu'un savant fou avait tenté de continuer la voie par un tramway à crémaillère. Et il y était parvenu. Il m'avait raconté ça, preuve à l'appui. Nous marchions sur un large chemin couvert d'herbes mais dont on sentait bien l'ancien l'empierrage sous nos croquenots. De ce jour, j'ai compris qu'il ne fallait jamais avancer une assertion sans preuves.
Ce savant fou était parvenu à ses fins. Pépé avait ajouté : c'est justement parce qu'il ne savait pas que c'était impossible qu'il l'a fait. A tous les autres qui cherchaient le pourquoi, lui avait simplement rétorqué : pourquoi pas ?
Mais, passé cette grande guerre qui avait fait tant de victimes, tant de dégâts, on n'eut plus l'utilité d'un tramway des cimes (c'était son nom) et la voie désaffectée finit par être colonisée par les mauvaises herbes. Dix ans plus tard, on vint récupérer les rails afin de les fondre pour en faire de nouveaux obus, car une nouvelle guerre allait se déclarer, juste vingt ans après la « der des der ». On récupéra aussi les traverses en bois à différents usages. On peut encore en voir quelques vestiges, abandonnés ici ou là dans la vallée.
Une fois sorti du village qui somnolait encore à neuf heures passées, je pris le raide chemin de cailloux qui grimpait vers la forêt. Des pans de brumes s'élevaient des cimes d'un vert presque noir.
Je longeai un temps la lisière pour enfin atteindre la cabane de pépé. Il me semblait voir s'échapper un mince filet de fumée de la cheminée. Impossible. Personne n'habitait là, la cabane n'avait pas encore été vendue. Je connaissais l'emplacement de la clé, sous un pot de fleurs renversé, à côté du petit banc qui jouxtait la fontaine. Elle n'y était pas. Je m'approchai de la porte et tendis la main pour actionner la clenche lorsque des bruits de pas me firent me retourner. Je failli m'effondrer d'effroi. Pépé s'avançait lentement, les bras chargés de petit bois. Je ne pus retenir un cri. Il s'en amusa comme s'il était l'auteur d'une bonne blague.
Qui voulais-tu que ce soit ? Me fit-il en ricanant de plus belle. Aide-moi plutôt à ouvrir la porte, tu vois bien que j'ai les bras chargés.
Je n'en revenais pas. Ce n'était tout simplement pas possible. J'étais allé à son enterrement un bon mois auparavant. Je n'avais pas rêvé tout de même ! Comme il déposait son chargement dans un coin de l'âtre, je me fis la réflexion qu'après tout je n'avais pas vu son corps, juste un cercueil qu'on allait brûler. Quelle était cette mystification ? Mes parents étaient-ils au courant de la supercherie ?
Finalement, je partageai son rire. Il nous avait bien eu. Quelle mauvaise blague !
Il s'assit à la longue table comme tant de fois et m'invita à en faire de même.
Puis il devint soudain plus grave. Son sourire disparut pour laisser place à un visage sérieux.
Ecoute gamin, je dois te dire quelque chose. Quelque chose d'important, de primordial. Quelque chose qui devra dicter tes choix toute ta vie durant.
Je l'écoutai avec attention. Jamais il ne m'avait parlé de la sorte, même quand il m'expliquait les plantes et les animaux.
Bien sûr, ce sont tes parents qui t'offrent les cadeaux pour Noël, comme le jour de ton anniversaire. Mais cela ne veut pas dire que le Père Noël n'existe pas. Je veux dire, l'idée du Père Noël.
Je pensai qu'il allait me parler de lui, comment il avait organisé sa fausse mort, de quelle méprise nous nous étions rendus coupables, le pourquoi du comment et tout et tout. A la place, il me racontait le Père Noël. Je n'y comprenais plus rien.
L'important, ce ne sont pas les choses, mais ce qui se cache derrière. Ce qui fait bouger le monde. Pas le comment, mais le pourquoi. C'est bien de savoir comment la Terre tourne, c'est mieux de savoir pourquoi. Car le pourquoi est toujours antérieur au comment. Sans pourquoi, pas de comment.
Sur le coup, je ne saisissais pas bien où il voulait en venir avec ses pourquoi et ses comment. Je ne le compris que bien plus tard.
Toutefois, il existe deux types de personnes : celles qui observent le monde et se disent pourquoi et celles qui le rêve et se disent pourquoi pas ? Fais en sorte de toujours appartenir à la seconde catégorie. Ce sont ces gens qui font avancer le monde. Imagine ta vie plutôt que vouloir simplement la vivre. L'imagination est plus importante que l'intelligence. Elle est le moteur quand l'esprit n'est que le carburant. Croire au Père Noël, c'est croire en la vie. Ce n'est pas le personnage que l'homme a inventé qui importe, mais cette volonté de partage, d'offrande et d'amour. Donner sera toujours plus gratifiant que de recevoir. Penses à ça. Cela doit dicter ta vie. Ne l'oublie jamais. Ne m'oublies pas.
Alors, il se passa quelque chose d'extraordinaire. Je vis son visage frétiller comme des bulles qui exploseraient à la surface du bain. Tout son être devenir des milliards de petits grains de sable. Je vis les atomes qui le constituaient se transformer en autre chose. Une sorte de poussière, de nuage. La table, elle-même, fourmilla de la même façon. Puis ce fut la pièce toute entière, les murs, le toit. Autour de moi tout disparaissait dans une recomposition atomique. Les molécules s'agençaient différemment. J'eus la révélation que le monde entier, l'Univers dans son ensemble n'était qu'une composition particulière de tous ces atomes. Une structure parmi d'autres possibles. Un agencement qui ne demandait qu'à se modifier. Que rien n'était immuable. Tout changeait tout le temps. Même les idées.
Je me retrouvai dans ma petite chambre, assis sur mon lit, la tête encore pleine d'images. Pépé était bien présent en moi, même s'il avait cessé d'exister physiquement. Tout comme le Père Noël. Tout comme toutes les idées qui allaient sortir de mon imagination pendant les années à venir.
Pendant toutes ces années, pépé et le Père Noël furent à mes côtés, jour après jour, nuit après nuit. Ils m'accompagnèrent lors de mes années collège, puis celles du lycée, des grandes écoles, lors de mon premier poste à l'institut national de cosmologie.
Je suis astrophysicien. J'ai voué toute ma vie à la recherche du pourquoi en tentant de comprendre le comment.
Et, cette nuit encore, pépé est venu visiter mes rêves. Et je crois bien qu'il m'a donné la clé.
Cette théorie du « tout » que nous autres, physiciens quantiques, cherchons depuis des décennies. Une simple équation qui explique tout, de l'infiniment petit à l'infiniment grand. Qui réconcilie toutes les théories en une toute simple et facilement compréhensible. L'explication ultime qui est à la base de tout.
Merci pépé.