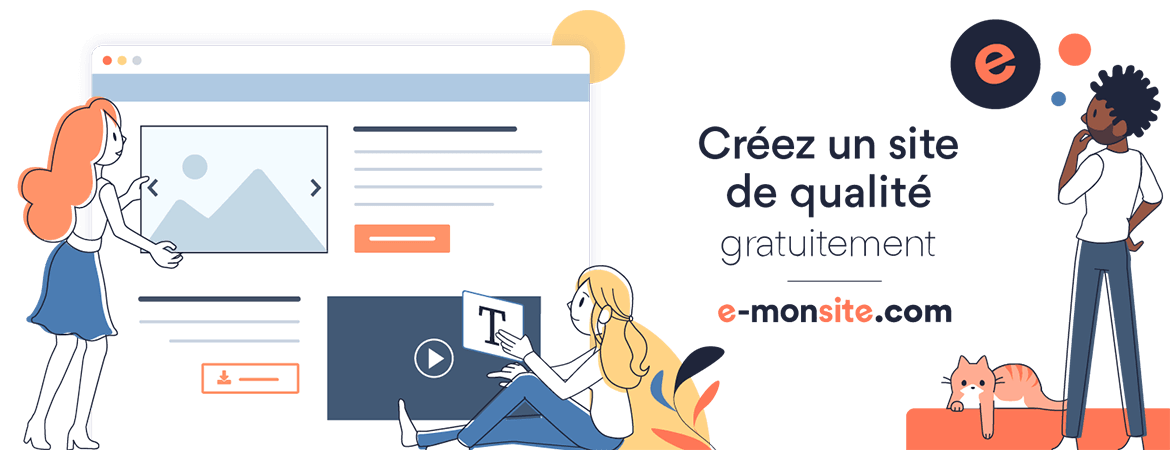Gran Paradiso
Gran Paradiso
***
1.
L’animal se tenait debout, campé sur ses deux larges pattes postérieures ornées de griffes comme des sarcloirs bien affutés, droit de ses deux bons mètres cinquante. Pour le moment, il n’émettait que des grognements indistincts qui avaient pour seul but de dissuader l’adversaire. Pauvre bête! S’imaginait-il que ce malheureux bipède allait le provoquer dans un duel de mâles dominants? La semi obscurité qui commençait à se répandre dans le jour finissant n’ôtait rien du cocasse de la situation ni de son impitoyable menace qui planait dans l’air. Les soixante quinze kilos d’un homme sédentaire et privé d’exercice à part quelques joggings un Dimanche sur trois et encore à peine une heure durant ne pesaient pas lourd face à quatre cent cinquante kilos de muscles entrainés à la rude vie sauvage. Le pelage de l’animal se dressait maintenant tandis que ses oreilles se plaquaient à l’arrière de son crane. Pas bon signe. L’homme ne savait rien du comportement animalier en général et encore moins des réactions de défense d’un grizzli au meilleur de sa forme. Que fallait-il faire? Dans une telle situation, la théorie s’évanouit dans les brumes d’un cerveau mal préparé à de telles circonstances et la pratique est paralysée par la peur. Une peur irraisonnée comme toutes les peurs. Une peur ancestrale. Celle qui tétanisait déjà l’homme primitif et dont les séquelles génétiques habitent encore l’Adn de cet homme du vingt et unième siècle. Son corps réagissait, uniquement mû par son cerveau reptilien. Instinct de conservation. Rien d’intellectuel là-dedans. Il arrive un moment dans ces conjectures extrêmes où le savoir et l’expérience ne comptent plus. Seul entre en action nos plus bas instincts. Et là, c’était la fuite.
La raison commande à ne rien faire justement. S’accroupir, voire s’aplatir au sol en signe de soumission. Mais la raison avait quitté le cerveau de l’homme, revenu à sa plus simple expression : évacuer le danger par tous les moyens et pas forcément les plus judicieux. De surcroit, il n’était pas de ceux qui ont du temps à perdre devant des documentaires animaliers diffusés à la télé. La bête n’avait pas de téléviseur non plus et ne voyait là qu’un intrus sur son domaine. Un visiteur non désiré avait pénétré sur son territoire, point final. Pas besoin de chercher midi à quatorze heures, il n’était pas le bienvenu et allait l’apprendre à ses dépends. Déjà le plantigrade émit un râle dissuasif et battait l’air de ses deux pattes, un peu mal à l’aise dans cette position qui ne lui était pas commune et qui lui demandait à la fois un équilibre précaire qu’il rechignait à adopter plus longtemps et une énergie en pure perte : l’humain n’entrait pas dans son régime alimentaire.
L’homme se prit le pied gauche dans une racine et s’étala au sol, la cheville visiblement foulée. Il se tordit de douleur. L’ours avait reposé ses pattes antérieures au sol et s’apprêtait à donner une gifle majestueuse à l’intrus. Ca l’apprendrai à pénétrer chez les gens comme ça. Mais la nouvelle attitude du visiteur le stoppa net. Peut-être l’envahisseur n’avait-il pas de mauvaises intentions, après tout?
On s’imagine que les supers prédateurs passent leurs journées à chasser tout azimuts, se dépensant sans compter, courant du matin au soir la jungle ou les forêts, exhibant leur force physique à la moindre occasion. C’est bien mal connaitre la vie au grand air. Bien au contraire, l’animal sauvage se comportera avec une économie de moyens troublante. Il ne dispersera pas son énergie à tout va, sachant trop bien combien cela lui en coûte. A quoi bon se nourrir si c’est pour dépenser ses précieuses calories par jeu? Avant de s’attaquer à une proie, l’animal sauvage pèsera toujours le pour et le contre : cela en vaut-il la peine? Qu’ai-je à y gagner? Le crédit à venir est-il supérieur au débit que va provoquer cette chasse?
Le grizzli a résolu le problème en ne s’attaquant majoritairement qu’à des proies facilement attrapables : des baies et un peu de miel. Le reste n’est que défense du territoire, le plus souvent par intimidation. Et ça marche généralement.
L’animal secoua sa grosse carcasse d’une demie tonne, cela lui donnait un air pataud mais personne n’avait envie de rire ou de se moquer à cet instant présent. Audiard prétendait que lorsque les gars de 150 kilos affirmaient quelque chose, ceux de 70 kilos écoutaient sagement. De même on y regarde à deux fois avant de ricaner d’une masse de muscles qui, d’une simple caresse, pouvait vous arracher aisément un bras. L’ours avançait son museau vers l’homme affalé. Il est des situations où l’on semble faire preuve de courage en ne fuyant pas. A ce stade, ce n’est plus de la témérité, c’est juste la peur qui pétrifie et annihile toute volonté. On ne fait pas face, on est simplement dans l’incapacité de détaler.
L’homme regardait sans comprendre l’ursidé qui le reniflait comme on hume un délicieux repas. Toutes les connaissances du trader étaient orientés vers les marchés, la haute finance, les enjeux politico-économiques. Son monde était fait d’acier et de verre, de gratte-ciel et d’immenses salles de réunion, d’un smart-phone et d’un ordinateur portable. Son attention se focalisait sur un monde d’apparence et d’argent. Il ne savait rien du comportement animalier en général et de celui des plantigrades en particulier.
On ne le dira jamais assez mais il existe des moments de grâce dans ce monde brutal. Des rencontres inopinées qui peuvent se transformer en longues amitiés, des coups de foudre qui deviennent de vrais romans d’amour. Parfois le guépard prend en pitié la gazelle apeurée. On a observé sans le croire des associations et des complicités invraisemblables : le chat et le moineau, le hérisson et la vipère, le renard et la poule, l’aigle et le loir. La science est impuissante à expliquer ces phénomènes, rares certes, mais qui défient l’entendement.
L’ours rétracta ses griffes et tendit sa patte droite pour caresser le corps de l’homme comme on le fait d’une peluche. Pour une fois les rôles étaient inversés, c’était la peluche qui cajolait l’humain. L’homme d’affaires ne put savoir combien de temps la scène dura. Il se trouvait hors du temps. Une minute ou un an pouvaient se comparer. Les pensées naissaient à toute vitesse, comme les images d’un rêve qui peuvent raconter une histoire de quelques années en deux minutes. Il parait qu’à l’heure de sa mort, on revoit défiler toute sa vie en accéléré. Dans le cas présent, c’était tout le contraire. Était-ce la preuve qu’il n’allait pas mourir? Le champion de la finance comprit soudain toute la vacuité de sa vie jusqu’alors. Des valeurs qui n’en étaient point. Des centres d’intérêt totalement futiles. Des amitiés de surface. Un gigantesque château de carte qui s’écroulait devant l’évidence. Il comprenait enfin que l’argent n’existe pas plus que les frontières érigées par les hommes. C’est une invention diabolique pour diviser, régner, assujettir, creuser des inégalités entre les hommes. Là, le museau d’un grizzli à dix centimètres de son propre nez, sentant l’haleine chargée de l’animal tout contre ses narines trop habituées aux parfums hors de prix, la lourde patte qui le massait gentiment des épaules aux lombaires, et le regard de l’animal. Ce regard si profond, qu’il n’avait jamais croisé de sa vie durant chez des créatures censées être le summum de l’intelligence. Il y avait tant de choses dans les yeux de l’animal, bien davantage que chez l’humain d’un certain rang, d’une certaine caste. Comme si la bête était habitée par une puissance divine. Cette rencontre aurait pu le rendre pieux, lui révéler l’existence de Dieu. Non. En revanche, il comprenait que la vie animale était sinon supérieure, du reste au moins égale à celle des humains. Il allait changer sa vision des choses… et des êtres.
Maintenant, le cours du temps reprenait sa marche inexorable. L’homme savait qu’il n’avait plus à craindre pour sa vie. Il ne subirait même aucune blessure, excepté cette maudite foulure qui, d’un sens, l’avait sauvé en le maintenant à terre et en l’empêchant de fuir. L’ours avait cessé ses caresses mais continuait d’observer cet étrange animal que son instinct savait garder à distance. Son instinct lui dictait de se tenir à l’écart de cette espèce incompréhensible. Toute son éducation était basée là-dessus. Il savait que certains de ces concitoyens osaient s’aventurer jusqu’au cœur des villes où proliférait cette espèce vorace comme du chiendent, histoire de se remplir la panse à moindre frais. On racontait que là-bas, au pays des hommes, une nourriture riche et sucrée s’offrait à tous les gosiers, il suffisait simplement de se baisser. Lui préférait encore rester à l’abri de la forêt qui l’avait vu naitre et qui serait certainement son tombeau. Il se méfiait de ces bipèdes à l’odeur prononcée qu’il voyait de temps en temps courir en bordure de son Territoire. Même s’il fallait s’en méfier, le spécimen qui gisait à ses pattes n’était pas un mauvais bougre. Selon l’odorat de l’animal, il puait fortement une odeur fausse, avait un drôle d’air avec son pelage noir qui ne semblait pas naturel comme s’il l’avait emprunté à une autre bête, mais il avait de la compassion pour ce bipède singulier. Cela aurait pu même devenir un compagnon de jeu pour sa descendance mais pour le moment, l’ours n’avait honoré que deux femelles cette saison et il était trop tôt pour que la nature lui ait offert une progéniture. L’ours se releva sur ses pattes arrières comme il avait vu se déplacer l’étrange créature qui gisait, apeurée, à ses pattes et, au cœur du silence intégral des ténèbres qui s’étaient dorénavant répandues sur l’immensité de la forêt, poussa un cri rauque qui se répercuta dans toutes les clairières de la forêt, dépassant la cime des plus hauts arbres et venant mourir au pied des étoiles. Les êtres nocturnes stoppèrent soudain leur activité, tendant l’oreille et humant le fond de l’air; les créatures diurnes se redressèrent d’un seul réflexe, à peine inquiètes. Puis la quiétude de la nuit étendit à nouveau son royaume. L’ours s’en était allé. L’homme restait à terre, gisant pitoyablement, l’air pantois, son costume Armani tout froissé et ses sous-vêtements souillés de la sueur de la peur et de l’effroi et d’autres substances moins nobles dont la complète frayeur avait déclenché le honteux et dégradant épanchement. Mais il ne se souciait dorénavant plus de ces considérations sociales. Quelque chose s’était modifié en profondeur dans son cerveau.
Patrick Bonfils allait changer de vie. Radicalement.
2.
Le réveil sonna à cinq heures quarante comme chaque matin depuis maintenant presque trente ans.
Un corps se retourna en gémissant sous les draps chiffonnés par une nuit de sommeil agitée. Ces longs weekend ne lui valait rien. Elle préférait le rythme habituel des semaines identiques qui s’enchainaient en années semblables pour constituer une vie monotone. Cette année-là, le jour de la fête nationale tombait un Mardi et, exceptionnellement, à vrai dire pour la première fois depuis qu’elle travaillait dans cette entreprise, on avait accordé aux employées un jour supplémentaire de repos. En l’occurrence, le Lundi. On appelle ça « faire le pont ». Et ce matin, juste rançon de cette libéralité incongrue, il fallait reprendre le rythme. Et c’était presque aussi dur qu’un jour de retour de vacances. Elle appréhendait ces maudits Lundi matins de la fin Août où, après avoir passé trois semaines loin de cette cité ouvrière coincée entre deux mégapoles nordistes, elle devait retrouver le rythme quotidien de l’employée d’une fabrique d’ustensiles de cuisine à destination des cantines de collectivités. Pendant trois semaines, chaque mois d’Août depuis ses vingt ans, elle allait rejoindre sa sœur sur la côte bretonne. Un beau jour du mois de Septembre 1978, celle-ci avait coupé tous les ponts en s’enfuyant loin de la grisaille de la grande banlieue Lilloise au bras d’un marin qui portait une ancre bleue sur son t-shirt gris. Elle était prête à tout pour échapper à une vie tracée d’avance : caissière de superette ou bien bosser à l’usine de gamelles comme allait le faire sa sœur ou encore, tout simplement, pointer chaque mois au chômage. Pedro n’était ni beau, ni riche, il ne possédait même pas de forts pectoraux et ne sentait surement pas le sable chaud des mers lointaines. Mais il était prêt à l’épouser et lui permettre de filer d’ici au plus vite. Le mariage eu lieu deux mois plus tard lors d’une escale du marin au long cours. La sœur ainée ne revint plus jamais dans cette région triste et morose, oubliée par ceux qui font avancer le monde. Pedro louait une petite bicoque battue par les vents sur une petite ile au large d’Ouessant. Elle était attenante à un vieux phare abandonné et parfois Louise grimpait les cent vingt huit marches (elle les avait patiemment compté un jour de spleen) et allait profiter d’une vue sur les flots et la houle à vingt mètres de hauteur. Pedro embarquait sur d’imposants cargos qui sillonnaient les océans. Il avait calculé qu’en douze ans de mer, il avait déjà fait dix-sept tours du monde. On ne pouvait raisonnablement pas parler d’amour entre eux. Le couple s’était uni davantage par association que par un réel penchant. Un contrat où chacun y trouvait son compte. N’était-ce pas le but primordial du mariage au fond, loin de ces passions et inclinations qui ne sont que l’héritage du siècle des lumières ou bien la conséquence d’un romantisme Allemand du XVIIIème ou bien les séquelles du faste de la Renaissance Italienne. Peut importe puisque Pedro avait ainsi trouvé quelqu’un qui puisse tenir la masure pendant ses longues absences, une cuisinière et une servante lors de ses rares escales. Louise, quant à elle, avait pu s’enfuir d’une région détestée et ça, ça valait tous les sacrifices. Du reste, elle n’était pas malheureuse. Elle vivait toute seule sur son ile pendant des mois entiers, son mari ne revenant de ses voyages au long cours que trois ou quatre fois l’an. Elle avait appris à naviguer sur une petite barque afin de traverser les trois milles marins qui la séparait de la côte, exclusivement à marée haute. Pedro avait été intraitable là-dessus. Un soir, en fait le premier soir où ils s’étaient retrouvés sur l’ile, il l’avait pris fermement par les épaules et, prenant un air sérieux qu’elle ne lui connaissait pas, lui avait expliqué très lentement et très clairement le seul commandement de cette ile.
- Tou dois toujours prendre la mer par marée haute et jamais lorsque la tempête menace. Là, il avait tapoté un sabot fixé au mur juste à côté de la porte d’entrée. Un baromètre qui allait être le compagnon de route de Louise pour des années.
- Tou m’entends. Jamais la mer à marée basse avec la barque, sinon les courants t’entraineraient au large comme oune vulgaire chiffon de papier.
Elle s’était contentée de hocher simplement la tête. Elle avait compris. Ne jamais sortir sur les flots par risque de gros temps et surtout attendre la marée haute pour gagner la côte. Au retour, de même. Elle ne devait pas se laisser griser par une marée qui allait lui éviter de donner le moindre coup de pagaie mais qui l’aurait surement emportée, elle et sa frêle embarcation, bien au-delà de la petite ile. Les journées se succédaient ainsi dans une nonchalance propre à ceux qui vivent isolés du monde qui avance. A bien y réfléchir, elle aurait été aussi seule dans une grande ville, perdue et isolée au milieu de millions de solitudes posées les unes à côté des autres sans le moindre contact véritable. Au moins, là, sa solitude avait quelque chose de grand, de pur, de démesuré. Si, au début, elle cabotait chaque jour vers la côte, en respectant scrupuleusement les recommandations de Pedro, et allait se balader dans le village côtier qui ne proposait même pas de quoi assouvir un lèche-vitrine digne de ce nom, au bout de six mois elle n’allait sur le continent qu’une fois tous les deux jours, parfois même juste deux fois par semaine : le Mercredi, jour de marché et le Samedi à cause de l’atelier vannerie.
Avant même de quitter son nord natal avec l’intention de ne jamais y remettre les pieds, elle s’était découvert une passion pour le tressage des branches de saules. Elle réalisait des paniers et des corbeilles en osier, mais aussi toute sorte de créations plus ou moins artistiques, plus ou moins fonctionnels. Elle avait proposé à une association d’activités pour ménagères désoeuvrées de tenir un atelier vannerie. On avait été enchanté de son idée, personne ici n’avait jamais tressé quoi que ce soit. Ainsi, chaque Samedi après-midi ou matin (selon l’évolution de la marée), elle expliquait, guidait, formait, instruisait une demi-douzaine de femmes s’étageant de trente à soixante-dix ans. En quelques mois, l’atelier affichait complet avec vingt-cinq membres actifs. Sur son ile, elle continuait à inventer de nouvelles formes. De l’art en osier, en saule, en bambou, en paille, en lin, en chanvre… Tout ce qui présentait des fibres pouvant se tresser passait dans les mains expertes de celle qu’on nommait jusque-là la ch’ti et que bientôt les autochtones finiraient par appeler de son prénom. Il lui avait fallu presque un an complet pour se faire admettre dans la petite ville côtière. Mais désormais elle était intégrée comme le vocabulaire de ce XXIème siècle naissant le prétend.
Quand elle vit une navette de la gendarmerie foncer droit sur la petite crique qui servait d’embarcadère, elle comprit que quelque chose clochait. Et ce quelque chose avait forcément avoir avec Pedro, puisqu’elle avait sa conscience pour elle et savait que la maréchaussée n’avait rien à lui reprocher.
Ce fut alors une chance de n’être pas tombée amoureuse. L’annonce de la mort de son compagnon ne fut qu’une information comme on peut en lire en quatrième page du journal local dans la rubrique décès et remerciements. Les gendarmes prenaient soin de trouver les bons mots, la bonne attitude, une contenance digne et respectueuse. Elle les laissait se dépatouiller mais cela ne lui faisait ni chaud ni froid. Rien n’allait changer dans sa vie, du moins le pensait-elle.
Or il advint que le précautionneux Pedro avait contracté une assurance sur la vie, sa vie en l’occurrence, et que les circonstances de son trépas entraient parfaitement dans les clauses d’indemnisation. Ajouté à la prime versée par la compagnie qui l’embauchait, elle reçut une jolie somme. La bicoque lui revenait par succession, rien à ajouter à cela. Mais elle pouvait désormais acheter le reste de l’ile et investir dans un canot à moteur qui pouvait aisément se jouer des courants marins. Elle n’était plus dépendante du cours des marées pour rejoindre le continent. Cependant, on ne la vit pas davantage en ville. Comme elle était la gentillesse même et que son atelier vannerie était un franc succès, on s’accommodait de cette lubie de vouloir vivre en reclus, sur sa petite ile. Bien qu’elle fut la gentillesse même et fit preuve envers les continentaux d’une affabilité et d’une courtoisie de bon aloi, elle ne put empêcher qu’on la surnomme dorénavant Louise la Farouche. Elle s’en fichait pas mal.
C’est ainsi que, chaque mois d’Août elle voyait débarquer sa soeurette au village. Celle-ci lui écrivait une semaine à l’avance (il n’y avait pas de téléphone sur l’ile et son courrier l’attendait au bureau de poste le plus proche) des circonstances de son arrivée. Les deux sœurs tombaient dans les bras l’une de l’autre et utilisaient le petit canot au moteur assez puissant pour ne faire qu’une bouchée des trois milles marins. difficultés
Ces trois semaines loin de tout, à commencer de la civilisation et son cortège d’habitudes, d’embarras, de complications, de tourments, de tracas et de crises plus ou moins sérieuses faisaient un bien fou à l’employée de l’usine d’ustensiles pour cantines de collectivités. Chaque matin, elle était debout avant six heures, habitude oblige, et partait pour « son » tour de l’ile. A peine sept kilomètres. Elle était de retour pour huit heures un panier rempli de coquillages divers et de crustacés variés. Elle avait encore le temps de préparer une bonne cafetière et de faire réchauffer les croissants achetés la veille pour qu’ils retrouvent une seconde jeunesse, un croustillant et un moelleux comme s’ils venaient d’être cuits. Sa grande sœur s’éveillait alors et elles partageaient un copieux petit déjeuner, assises sur la terrasse face à la mer. C’était le premier changement dans son existence. Là-bas dans la routine de sa vie nordiste, elle ne prenait jamais le temps d’un petit déjeuner conséquent. Avec les restes de son héritage, l’ainée avait fait faire quelques aménagements à la bicoque. Triple vitrage, achat d’un poêle, colmatage des combles, assainissement de la cave et cette terrasse en lattes de pin des landes où il faisait si bon prendre le soleil au petit matin. Pendant ces trois semaines d’Aout, elle décompressait, oubliait un moment sa vie maussade même si, au large de la pointe bretonne, même au cœur de l’été, il n’était pas exclu qu’un petit crachin s’invite au déjeuner et alors c’était parti pour toute l’après-midi ou bien de fortes averses lavaient un ciel qui redevenait radieux moins d’une heure après et on pouvait profiter d’une centaine de minutes d’un temps radieux avant que l’incessant ballet des nuages et des ondées ne reprenne.
Elle aimait cette ambiance iodée et cette sauvagerie marine aussi. Pour rien au monde elle n’aurait pu s’allonger sur une plage de sable fin, au milieu d’une foule qui rôtissait de dix heures à midi et de quinze heures jusqu’à l’apéro. Et bien qu’elle ne faisait pas grand chose d’autre sur cette ile, s’abandonnant à une certaine léthargie de rentière, l’ambiance était différente. Elle trouvait la campagne sale. Pas sale dans le sens où l’on n’était pas certain d’éviter une bouse ou patauger dans la gadoue les jours de pluie. Non, sale dans le sens de tous ces produits chimiques que les agriculteurs modernes utilisaient sans retenue. Pesticides et nitrates. Elle avait lu quelques articles là-dessus. Et le ronronnement continuel des machines agricoles, devenues en l’espace d’une génération, des mastodontes aux mâchoires d’acier : moissonneuses diverses, tracteurs surdimensionnés, faucheuses, tronçonneuses… A bien y réfléchir, cette mécanisation rurale et son cortège de produits chimiques déversé comme une pluie d’automne rendait la ville plus salubre. La montagne ne lui disait rien. Tout compte fait, c’était d’une monotonie de jour chagrin, d’un Lundi matin par exemple. Des vallées où serpentait un torrent charriant ses pierres, des cols, des pics, des forêts et des alpages et au-delà du col, une autre vallée avec un autre torrent remuant d’autres cailloux, copie conforme, des aiguilles de granit surplombant les mêmes alpages disputant la pente à quelques sombres forêts de résineux, ensuite un nouveau col, une énième crête et puis une nouvelle vallée et ainsi de suite autant que la patience voulait s’en accommoder. Pas de quoi fouetter un chat. Par contre, elle aimait bien la représentation de la montagne. Ainsi lors du passage du facteur pour les étrennes, elle choisissait toujours le calendrier qui présentait glaciers immaculés et arêtes vertigineuses. Elle possédait dans son petit deux pièces de cette banlieue nordiste quelques beaux livres sur les hauts sommets du monde : Cervin, K2, cordillère des Andes, McKinley. Et un grand poster au-dessus de son lit. Une belle étendue de neige d’où s’échappaient quelques rochers, doigts tendus vers le ciel. Vers Dieu? Il fallait qu’il y ait de la blancheur, neige immaculée car inaccessible, glaciers meringués dissimulant leurs mortelles mâchoires sous le pas de l’alpiniste imprudent. Bizarrement ce n’était pas le Mont Blanc qui dominait sa couchette mais un quatre mille suffisamment célèbre pour être imprimé sur une affiche de 1,5m sur 3. Le Gran Paradiso, le Grand Paradis en français. Le nom était déjà une promesse, bien autre chose que le Mont Rose qui n’était pas plus rose que l’homme blanc est opalin.
Finalement, ces trois semaines d’Août lui convenaient parfaitement. Ce n’était même pas le prétexte familial qui la poussait vers cette extrémité bretonne; elle considérait sa sœur davantage comme une bonne copine que partageant ces mystérieux liens du sang. On raconte tant et tant de choses sur la psychologie des sœurs, entre complicité et rivalité, entre connivence et jalousie. Elle ne s’était jamais posé la question sous ces dualités qu’elle n’avait jamais vraiment vécues. Son enfance avait été d’une banalité affligeante. Pas de secrets partagés ni de guerre déclarée. Cela aurait peut-être pu venir plus tard, à l’adolescence, mais à ce moment là, Louise avait déjà mis les bouts.
Sa journée était immuable, excepté les jours de marché où elle suivait sa sœur sur le continent. N’ayant pas la fibre du tressage, elle ne participait pas aux ateliers de vannerie et poursuivait ses activités sur l’ile déserte. Pas si déserte que ça en réalité. Partout où l’homme ne s’est point répandu comme une trainée de poudre, les espèces prolifèrent sans danger. Et c’était le cas sur la petite ile au large d’Ouessant. Après avoir rempli une grille de mots croisés, dénichée dans un vieux magazine ou quelque journal que sa sœur conservait par habitude, elle flânait autour de la petite bicoque. Parfois elle préparait le repas en compagnie de sa sœur ou mitonnait, seule, une recette sagement découpée dans la page culinaire d’un magazine féminin. D’autres fois elle allait se poser sur un rocher, un promontoire, et restait ainsi quelques heures à regarder le paysage se transformer lentement au gré de la course des nuages, du ballet des mouettes, du vent jouant dans les haies ou les branches des rares arbres qui parsemaient cette ile stérile. Elle s’allongeait sur une plage de galets et se laissait aller à des rêveries sans but ou encore elle baguenaudait en laissant tous ses sens s’éveiller à l’environnement.
Elle ressentait intensément la nature autour d’elle. Chose impossible le reste de l’année : trop de stress, pas assez de temps dans une ville qui oblige ses habitants à une précipitation sans but. Là, au milieu de nulle part, elle ouvrait grand les oreilles et écoutait le chant des pinsons, des moineaux et des mésanges, les cris outrés des goélands et les réponses comme autant d’injures de la part des mouettes. Parfois elle fermait les yeux pour mieux s’imprégner des sons, une musicalité qu’on était bien en peine de trouver au contact de l’homme, de la civilisation, y compris (et surtout) à la campagne. C’était comme si le prétendu progrès avait détraqué l’harmonieux balancement de l’horloge naturelle. Comme si l’homme avait souillé une œuvre d’art en en proposant une vague copie plus bruyante. Elle réapprenait à écouter. Pas seulement entendre le tumulte autour d’elle, une sorte de grondement sourd en guise de bruit de fond auquel on ne fait plus attention au contact de la civilisation. Il lui semblait parfois posséder une paire d’oreilles toutes neuves, celles des nourrissons qui découvrent pour la première fois tous les sons de la vie. En fermant les yeux pour mieux ouvrir ses oreilles, elle se rendait compte de la richesse sonore de cette ile, perdue au large des côtes bretonnes.
Elle redécouvrait des sensations perdues. Peut-être ne les avait-elle jamais ressenties tout à fait. Les caresses ou les bousculades du vent, jamais pareil. Son souffle, sa force, sa puissance et son parfum aussi. Elle avait l’impression de développer tous ses sens, réduits à néant le reste de l’année, emprisonnés dans un air contaminé. Son odorat s’était déployé et amplifié. Elle pouvait percevoir des senteurs infimes comme un amateur de grand vin sait discerner les divers éléments olfactifs contenus dans un simple verre de Bourgogne. La brise marine transportait des effluves venues des navires qui croisaient au large. Elle pouvait en déterminer les molécules relatives aux émanations du bateau. Elle se laissait aller, profitant de chaque élément qui venait titiller sa peau. Elle respirait alors profondément, lentement, laissant toutes les nuances des émanations marines pénétrer ses muqueuses. C’est comme si un homme doux et prévenant lui faisait l’amour. De ce côté-là, c’était le calme des après tempêtes. Seulement, il n’y avait jamais eu de tempête.
Les articles récurrents sur le sujet que proposent habituellement les magazines féminins la faisaient doucement rigoler. Les orgasmes multiples, le point G, c’était de la science fiction pour elle. En revanche, un gars pas bien futé, avec un bide de buveur de bière en guise de plaquettes de chocolat et une rusticité à peine déguisée les rares fois où il portait un costume cravate, ça elle connaissait. Les aubes ternes achevant les soirées dans quelque boite minable où l’ivresse fait faire souvent n’importe quoi, de ces choses que l’on regrette si on n’a pas la chance de les oublier sur le coup. Les rendez-vous miteux, les diners en tête à tête dans un chinois surfait, rien de romantique là dedans. De toute façon, le romantisme, ça ne la faisait pas vibrer. Les limousines, les palaces, les déclarations au clair de lune, les promenades en barque avec ombrelles et bouquets de fleurs, les soirées habillées et tout le tralala, elle s’en foutait un peu à vrai dire. Tout ce qu’elle voulait, ce qu’elle aurait voulu, c’est un gars gentil mais pas idiot, prévenant sans être complaisant, qui saurait la rassurer sans se prendre pour son père. Pas un prince charmant ni même l’homme idéal. Juste un mec bien avec qui elle aurait pu faire un bout de chemin, tout le chemin même avec, pourquoi pas, un ou deux mouflets qui leur ressembleraient. Mais elle allait avoir cinquante deux ans, elle vivait seule dans une banlieue d’une cité du nord, avait un boulot à la con et ne s’échappait de cette gangue de vie insipide que ces fameuses trois semaines d’Août.
Ce Mercredi quinze Juillet, le réveil avait été difficile. Elle n’arrivait pas à émerger de ce long weekend inédit. Elle n’avait même plus l’excuse, comme les années précédentes dès les beaux jours, de penser à son prochain séjour sur l’ile bretonne en décomptant les jours. Cette année, elle n’irait pas voir sa sœur. Sa sœur, elle l’avait vue en Mars dernier. Jamais elle ne l’avait vu comme ça, sa grande sœur si dynamique et qui ne s’était jamais fait marcher sur les pieds, qui avait toujours relevé la tête. Oh, ce jour-là, elle ne baissait pourtant pas le menton. Il était bien droit, bien lisse. Tout son visage était franc et volontaire comme à son habitude. Sauf que son corps reposait à l’horizontale dans un cercueil capitonné. Elle était restée trois jours à Quimper. La succession, le notaire, les papiers à signer. L’ile lui revenait mais elle n’avait pas le cœur à y passer ses trois semaines de congé. Pas cette année. Plus tard, peut-être.
Le bol de café n’avait aucun goût. Rien à voir avec les odeurs et les sensations qu’elle éprouvait sur l’ile. Elle attrapa le bus 67 à la dernière minute. Juste essoufflée par ce sprint inattendu, elle regarda autour d’elle tandis que son cœur cognait sa poitrine. Une France cosmopolite et matinale partait, comme elle, vers des boulots pas choisis, obligatoires et obligés, la tête basse et le regard éteint. Elle descendit à l’arrêt de l’avenue des Muguets et releva son col. La nuit avait été froide pour la saison et le pâle soleil parvenait difficilement à réchauffer l’air pollué d’une zone industrielle. De larges bâtiments se déployaient jusqu’à l’horizon et elle pensa tout à coup que le monde moderne avait si bien compartimenté la vie : ici des banlieues dortoir de petits pavillons identiques ou, pire, de barres de hlm décrépis, là des centres commerciaux étendant leurs parkings démesurés sur des hectares, plus loin d’anciens terrains vagues parsemés d’ateliers au kilomètre où une foule soumise et fatiguée venait pointer chaque jour à sept heures du matin.
Il y avait un rassemblement devant les grilles de l’usine. Elle ne les avait jamais vu fermées ces foutues grilles. Pour cela, il aurait fallu venir un jour de congé ou un Dimanche. Autre chose à foutre! Ca parlait vigoureusement. Elle reconnut Francine, sa collègue d’atelier et puis Bébert, un grand blond aux cheveux filasses d’origine hollandaise, il y avait Fatima et Fetnat, une berbère et une malienne qui parlaient plus fort que tous. Il y avait de l’agitation devant ces grilles résolument fermées. Quelque chose clochait. C’est Jean Louis, un ancien champion régional d’haltérophilie dont la graisse n’avait pas complètement noyé les muscles qui, d’un coup d’épaules, fit céder le cadenas. Dès lors, la petite troupe d’employés, comme intimidés par cette intrusion ironique (forcer une grille pour aller bosser, faut vraiment être con parfois!), avança à pas mesuré dans un soudain silence de cimetière. Si la grille était cadenassée, la porte de l’atelier n’était même pas fermée. José poussa délicatement la porte d’acier. Jamais encore elle n’avait vu quelqu’un prendre autant de précaution envers cette porte qu’on maltraitait à longueur de journée, en y faisant passer sa rage de devoir se lever chaque matin aux aurores pour s’enfermer huit heures durant dans cet enfer de monotonie. La troupe s’y engouffra, les uns après les autres puis se tint debout, les bras ballants, n’osant pas avancer plus loin. L’atelier était vide. Toutes les machines, les pressoirs, les tours, les découpes, les chaines de montage, les recoins à peinture, à émail, tout avait disparu.