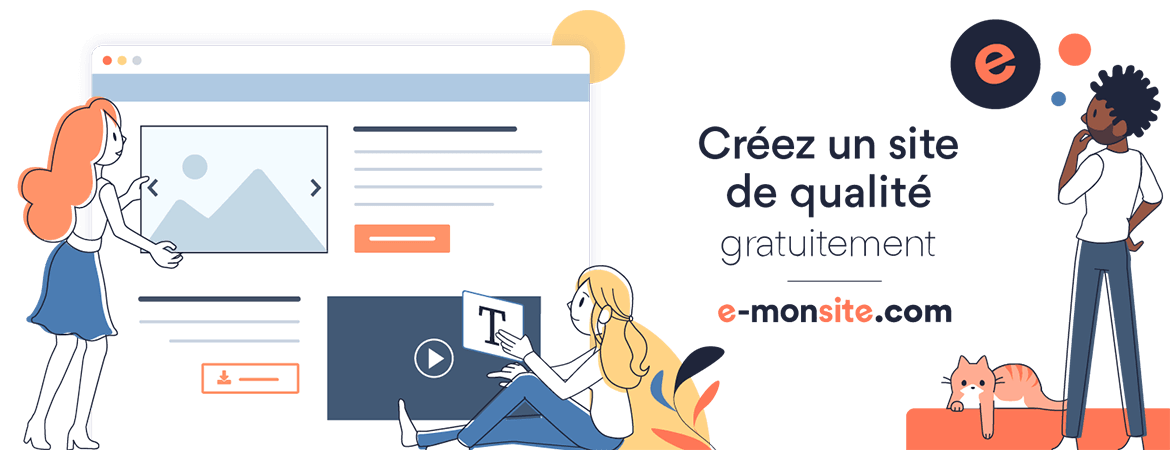la Petite Fille au Loup
Il était une fois, pas si longtemps que cela néanmoins, vivait une mignonne petite fille au cœur de la grande forêt.
Elle habitait dans une demeure, pas une maison, ni même une chaumière, pas plus un chalet, disons une cabane, une simple cabane de bûcheron. C’était d’ailleurs l’occupation de son père.
Dès l’aube, après avoir avalé un grand bol de chocolat bien fumant qui embaumait de ses saveurs épicées l’unique pièce à vivre ; après avoir mordu de bel appétit dans de larges tranches de pain qu’il cuisait lui-même, des tranches bien épaisses que sa femme beurrait avec tendresse et où il étalait lui-même une mince couche de confiture d’airelle ; après avoir croqué une belle pomme rouge comme l’étaient les joues de son unique petite fille par jour de grand froid ; après avoir dégusté bruyamment un frichti de lard fumé, revenu à la poêle avec deux œufs brouillés par ces sombres matins d’hiver ; après avoir coupé une jolie portion de la tomme qui finissait de s’affiner précieusement dans le buffet au-dessus de l’évier ; après toutes ces agapes dignes d’un roi – il avait dit, un jour, sur le ton sentencieux qu’il prenait quand il s’occupait d’inculquer à sa fille quelques rudiments de morale : il faut manger le matin comme un roi, le midi comme un valet et le soir comme un mendiant –, il endossait une pelisse élimée mais qui tenait bien chaud, ouvrait grand la porte par laquelle un air glacé pénétrait soudainement dans la pièce tiède, et cela aurait réveillé un mort, puis, sans un mot, partait pour une longue journée de travail en forêt. On ne le revoyait que le soir.
La petite fille aimait bien son papa. Comme toutes les petites filles du reste. Mais peu de gamines peuvent prétendre avoir un papa qui était capable d’un seul coup de hache de fendre une bûche, tellement grosse et lourde qu’elle ne parvenait à la porter qu’au prix d’un louable effort. Rares étaient celles dont le papa connaissait tous les sentiers de la forêt, presque tous les arbres. Et aucune n’avait la chance de vivre en pleine nature, au milieu de cet océan vert, réveillée chaque matin par le chant des oiseaux ou le bruissement des feuilles agitées par le vent du nord. Elle avait réellement une vénération pour celui qui rentrait le soir, les épaules couvertes de sciure de bois, ces petits copeaux qui sentaient si bon la résine encore fraiche.
Bien sûr, la fillette aimait aussi sa maman. Mais ce n’était pas pareil.
Parfois, son papa l’emmenait en forêt pour une belle balade, lui expliquant les arbres, leur pouvoir, leur grandeur et comment il fallait les respecter.
Quand elle lui avait demandé pourquoi il coupait ces arbres si magnifiques, il lui avait répondu que c’était le cycle de la vie, qu’après avoir été coupés, de nouveaux arbres allaient pouvoir germer, grandir à leur tour. La forêt ne mourrait jamais. A condition de la respecter et de ne pas couper tous les arbres d’une seule fois. Il lui montrait ces majestueux troncs qui s’élevaient au-delà de son regard puis les minuscules rejets qui tapissaient parfois le sol. Il lui disait qu’aucune pousse n’avait la chance de pouvoir se développer sous ces géants de la forêt. En revanche, les clairières formées par ses coupes permettaient à un peu de lumière de favoriser les bébés arbres qui, un jour, seraient de magnifiques sapins, hêtres, chênes ou pins. C’était le cycle de la vie. De la même façon que certains animaux en mangent d’autres pour vivre.
Sa maman ne quittait quasiment jamais la cabane. Elle tricotait des chandails bien chauds avec de la laine de toutes les couleurs, elle cousait, elle brodait, elle décorait la petite chaumière qui avait bien un joli cachet ma foi. Elle cuisinait aussi.
Quand la fillette jouait dehors et qu’elle sentait s’échapper de délicieuses odeurs de cannelle, de vanille, d’amande ou d’autres parfums tout aussi subtils et exquis, elle ne pouvait résister à l’envie de venir aider sa maman à la confection d’une tarte aux pommes ou aux poires, une brioche bien dodue, des cannelés caramélisés, toutes sortes de gâteaux aux fruits des bois, des fondants au chocolat, des gaufres si croustillantes que mordre dedans faisait le bruit du cristal que l’on pile. La demeure exhalait des relents sucrés et c’était une promesse de gourmandise.
La vie s’écoulait ainsi au fil des saisons.
Le père coupait des arbres, en débitait certains en bûches pour alimenter la cheminée, réparait ici ou là la petite cabane.
La mère confectionnait de jolis napperons, des mouchoirs brodés, des rideaux ouvragés comme des œuvres d’art.
La fillette passait ses journées dehors, à courir après un papillon, à jouer dans les branches basses des géants de la forêt, à fabriquer mille et unes choses éphémères, artiste d’un jour.
Elle apprenait aussi, comme toutes les petites filles et les petits garçons de son âge. Sauf que son école était la forêt et son professeur son papa adoré ou alors sa classe devenait les murs protecteurs de la cabane et sa maitresse était sa maman. Elle étudiait les choses dont elle aurait besoin. Savoir lire et savoir écrire. Mais sans se contenter de déchiffrer des pages et des pages. Sa maman insistait bien pour qu’elle comprenne ce que l’auteur avait voulu dire. Ressentir la beauté des mots choisis. Connaitre les plantes et les arbres, savoir les identifier et les reconnaitre, leur donner un nom mais aussi être capable d’en connaitre les propriétés et les pouvoirs. Avoir des notions de physique (être capable de mesurer la hauteur d’un arbre en restant au sol), de chimie (cuisiner de délicieux gâteaux), de mathématiques (pouvoir prévoir toutes sortes de choses). Chaque connaissance avait ses applications directes dans la vie de tous les jours.
***
Un jour qu’elle se passionnait au plus haut degré devant l’activité singulière qui règne aux abords d’une fourmilière, y restant ainsi quelques heures en contemplation et curiosité assidue, elle devina un mouvement dans son champ de vision.
Bien sûr, elle avait déjà pu apercevoir cerfs et chevreuils à la dérobée, les surprenant dans leur vie quotidienne. Leur instinct les tenait à l’écart de la présence humaine, mais les bêtes étaient suffisamment intelligentes pour comprendre qu’une toute petite fille n’était pas un grand danger et parfois, elles s’avançaient plus près qu’elles ne l’auraient fait devant une grande personne. L’animal stoppait à une bonne dizaine de mètres. Deux regards se croisaient dans un dialogue impossible puis, sans aucune raison, du moins de celles dont usent les humains, la biche s’enfuyait dans la forêt en quelques bonds gracieux.
Cette fois, l’animal était plus discret. La fillette ne l’avait pas entendu venir. C’était une bête sans ongles aux pieds, qu’on appelle sabots. Un renard, peut-être. Elle avait déjà croisé plusieurs maitres Goupil à la robe rousse, la queue trainant au sol comme si elle voulait y donner un coup de balai et le regard chafouin à la recherche d’une pitance bien dodue et caquetant.
Cette fois, ce n’était pas ça.
Un chien sans doute. Mais l’animal faisait encore moins de bruit. Il semblait ne pas respirer.
La petite fille tourna lentement la tête dans la direction où elle avait repéré le déplacement.
Alors, elle le vit.
Le poil était comme argenté et semblait scintiller sous les rares rayons qui pénétraient le couvert des arbres. Ses pattes étaient fines et musclées, l’animal devait être habitué à parcourir de longues distances. Il était superbe. Mais le plus extraordinaire était son regard. On sentait toute l’intelligence animale, toute la puissance du prédateur, nulle place au moindre doute, cette confiance en soi que partagent ceux qui règnent.
C’était un loup.
La fillette n’eut pas peur.
Jusque là, elle n’avait rencontré l’animal chargé de légendes que dans les contes que ses parents lui racontaient le soir avant de s’endormir et qu’elle lisait maintenant toute seule comme une grande. La plupart du temps, l’animal était décrit comme une vraie bête sanguinaire, sans âme ni remords. Mais la petite fille savait pertinemment que tout ce qu’il y avait d’écrit dans les contes n’était pas nécessairement la vérité de tous les jours. Elle connaissait les images et les symboles et que, comme les dragons et les fées n’existent pas, que les rois et les princes n’ont plus que leur titre comme seul pouvoir et que les sortilèges et enchantements n’ont rien de magique. Le loup, comme tous les animaux sauvages, craignait plus l’humain que ne pouvait se faire l’inverse et que la peur ancestrale liée à la rencontre avec ce terrible prédateur de forêts avait fait long feu, de la même façon que les montagnes n’étaient plus le repaire inaccessible du diable et les forêts de dangereux et impénétrables lieux emplis de mystère.
Elle ne bougea pas, contempla l’animal qui la fixait en retour avec une sorte d’étonnement dans le regard. Ce n’était pourtant pas un louveteau de l’année, surement une jeune femelle n’ayant pas encore eu de portée, donc moins méfiante qu’une louve qui se doit de protéger sa progéniture.
La scène aurait pu durer des heures, mais soudain un bruit, à peine perceptible mais que l’oreille exercée de la gamine put aisément distinguer, un coup de hache dans le lointain ou la chute d’un objet contondant sur du métal, un simple bruit inoffensif eut raison de cette rencontre inattendue.
Le loup fit demi-tour et, sans se presser, s’enfonça dans la forêt silencieusement.
La fillette ne dit rien de cette rencontre à ses parents. C’était son secret. A elle et au loup.
Il se passa deux jours. Le surlendemain, même scène, à peine plus loin que la clairière à la fourmilière. Le loup apparut entre les fougères. Plus près, cette fois. La fillette et l’animal se regardèrent le temps d’une chanson. Aucun bruit n’alerta l’animal et il continua son chemin, flânant parmi la végétation, comme si la petite fille n’existait pas.
Elle le revit le lendemain. Encore plus près, encore plus longtemps. Il apparaissait que la bête recherchait sa présence.
La petite fille possédait un grand livre sur les animaux de la forêt. Elle relut les quatre pages consacrées au loup. Elle n’apprit pas grand-chose de plus qu’elle ne sut déjà. Ils vivent en meute mais parfois sont seuls, en quête d’un partenaire pour fonder une famille, une nouvelle meute. Il faudrait qu’elle demande à son papa de lui rapporter un grand livre spécifique sur l’animal la prochaine fois qu’il irait au village.
Les rencontres se multipliaient de jour en jour. La fillette se souvint d’un petit livre joliment illustré qu’elle avait lu quelques années plus tôt, un des premiers qu’elle avait eu la chance de lire toute seule, juste un peu aidée par sa maman pour les mots difficiles et les situations compliquées, les états d’âme qu’elle ne comprenait pas tout à fait. Il y était question de l’amitié entre un petit garçon et un renard. Ce dernier donnait une jolie définition de l’apprivoisonnement : quand une bête et un humain se font mutuellement confiance.
Il arriva un jour que le loup vienne si près qu’en tendant doucement le bras, la petite fille put le caresser d’une main timide.
Le poil était soyeux, un peu rêche mais bien chaud. La bête ne devait pas craindre les frimas de l’hiver avec une fourrure pareille. Mais c’était surtout le regard qu’avait le loup pour elle qui troublait la petiote. Elle savait bien qu’un loup est un carnivore, c'est-à-dire qu’il ne se contenterait ni de pommes ni de légumes. Mais elle ne pouvait se résoudre à voler un lapin des clapiers de son père. Elle n’avait que son amitié à lui donner en échange de la confiance qu’il lui accordait en se laissant ainsi approcher.
Une nouvelle amitié improbable naquit entre la petite fille et le loup, de ces amitiés qui sont belles car impossibles.
Parfois la bête et la fillette restaient ensemble à contempler le paysage autour ou que le loup suive la petite comme un chien aurait suivit son maitre dans quelque balade sans but.
Dans sa vie au fin fond de la forêt, la petite fille n’avait pas d’ami, pas de grand frère ou de petite sœur pour partager ses jeux, pas de confidente pour échanger ses secrets. Il y avait bien Platon, le chat tigré de la maison, mais il était trop hautain pour s’abaisser à partager la vie d’une petite fille. C’était un vrai chat, se prenant pour un roi et agissant en conséquence. Lorsque l’homme nourrit le chien, ce dernier imagine que son maitre est un Dieu, lorsqu’il nourrit le chat, celui-ci le considère comme son valet.
Cette rencontre avait de vrais airs de confiance et la petite fille jouissait de la compagnie étrange de cet animal.
Chaque jour, la fillette et le loup se retrouvaient pour partager un peu de leur temps, le temps béni de ceux qui n’ont pas d’obligations.
Ca devait être le milieu de l’après-midi, le soleil commençait sa longue plongée vers l’horizon et l’air s’était sensiblement rafraichi. Le loup, dont l’ouïe et l’odorat étaient nettement plus développés que ceux de la petite fille, avait émit un grognement. Ce n’était certes pas la première fois. Souvent, la fillette avait remarqué cette réaction sauvage. Ca ne manquait pas : deux ou trois minutes plus tard, elle entendait à son tour un bruit de branches craquant sous le pas d’un promeneur, un voisin. La plupart du temps, le passager croisait au loin, mais quand il s’approchait trop près de la fillette, le loup se tapissait dans un fourré, immobile, invisible, sans émettre un seul son. Une ou deux fois, il s’était carrément enfui. Des aboiements ultérieurs expliquaient cette dérobade.
Suite au grognement du loup, la petite fille s’attendait à voir apparaitre un nouveau visiteur, mais personne ne s’approcha. A peine dix minutes plus tard, le loup grommela de nouveau et il commençait à filer entre les arbres pour s’échapper quand une détonation déchira l’air. Le bruit fut terrible. Comme un coup de tonnerre. L’écho renvoya une réverbération dans toute la vallée. Le ciel était dégagé, pas de nuages, ce ne pouvait être l’orage. Toutefois, comme lors d’un coup de tonnerre, il était impossible de déterminer le lieu précis d’où provenait le fracas.
La surprise passée, la petite fille regarda dans la direction par où s’était éclipsé son ami le loup. Et là, elle vit une forme allongée, secouée de spasmes. Son meilleur ami gisait au sol, inconscient. Elle se précipita vers l’animal qui semblait avoir été tué sur le coup, sans souffrir, piètre et maigre consolation. Son pelage argenté était soudainement devenu terne, excepté cette tache rouge qui prenait de l’ampleur et souillait maintenant le sol tapissé d’aiguilles de sapin. La blessure avait profondément entaillé le haut de l’épaule, juste au-dessus de sa patte droite. Elle voulut serrer la dépouille de l’animal mais une voix forte stoppa la tendresse de son geste. C’était la voix de son père, impérieuse, inexorable. Le « non, ne le touche pas ! » avait été prononcé avec une autorité absolue.
La fillette s’était immédiatement immobilisée. L’injonction paternelle avait gommé l’élan de l’amitié. Mais son cerveau travaillait à toute vitesse. Des pensées venaient en pagaille, toutes ensembles, comme des flots trop longtemps contenus lâchés par une digue qui se rompt.
L’amitié qui la liait au loup n’était pas de même nature que l’amour qu’une fillette doit à son père. Les deux sentiments étaient certes proches, mais puisaient leur fondement dans différentes parties de son cœur. Jusque là, elle n’avait pas eu à choisir. Elle aimait, elle admirait, elle vénérait son papa depuis toujours. Elle appréciait la compagnie du loup, c’était son espace de liberté. L’amour filial ne lui avait pas été imposé, il allait de soi mais la tendresse qu’elle éprouvait envers l’animal relevait de son choix exclusif à elle. Ils s’étaient choisis tous les deux, sans aucune influence extérieure. Comme on ne choisit pas la couleur de ses cheveux, même si on l’aime, mais on peut décider de leur longueur ou de leur forme.
En un centième de seconde, ces deux passions qu’elle partageait au plus profond d’elle-même se livrèrent un combat acharné. Pourquoi son père avait-il eut ce geste inouï, presque amoral ? De quel droit usait-il pour décider qui devait vivre ou mourir ? Etait-il Dieu ? Si elle l’avait pensé quelques années plus tôt, elle savait bien que toutes les qualités de son papa n’en faisaient pas un être tout puissant.
Soudain elle n’entendit plus aucun son, aucune parole, ne vit plus la lumière du sous-bois, juste la dépouille inerte de son nouvel ami étendu là, à ses pieds. Elle resta immobile quelques secondes puis, sans réfléchir, elle se mit à courir à perdre haleine, droit devant elle. Sans s’arrêter, sans réfléchir. Elle fuyait ce spectacle immonde. Elle fuyait son père, horrible imposteur qui avait pressé la gâchette d’un fusil qu’il n’utilisait quasiment jamais. Et pourquoi ?
Soudain, tout l’amour filial s’estompa dans une haine toute neuve, à fleur de peau, de celles que l’on ne rumine pas, qui vous tombent dessus sans prévenir.
Le père resta quelques secondes, hébété par la réaction de sa fille. Il ne comprenait pas. Lui n’avait vu que sa petite fille à deux pas d’un loup, une bête sauvage capable des pires instincts. Il avait devant lui cette scène impossible : sa propre fille en compagnie d’une bête sanguinaire et en même temps se superposait une autre scène, jaillie de sa mémoire, celle-là : son jeune frère étendu sur le sol, un bras ensanglanté et la gorge maculée de sang. Il n’avait pas encore l’âge de sa fille. On l’avait immédiatement tourné dos à la scène abominable, son visage de petit garçon dans les jupes de sa mère qui s’effondrait sous le poids du destin. On avait évoqué ensuite l’attaque d’une louve à la recherche de ses petits. Peut-être que son frérot avait découvert les louveteaux et avait joué avec, sans malice, sans savoir, sans imaginer l’instinct d’une mère prête à tout. La bête était apparue et le garçonnet ne s’était pas méfié. Incompréhension de l’enfant devant le danger imminent. Incompréhension de l’animal prenant le petit d’homme pour le prédateur de la chair de sa chair. Elle avait réagit en mère protectrice. L’enfant n’avait pas survécu. Le père de la fillette en avait gardé une haine féroce contre cette espèce, la seule capable sous nos latitudes de s’en prendre à l’homme. Face à ce danger potentiel, il n’y avait qu’une réponse : le fusil.
Abasourdi par cette scène qu’il ne comprit pas sur le moment, le père mit quelques dizaines de secondes avant de s’élancer à la poursuite de sa fille. Mais elle était partie droit dans les bosquets, trop denses pour faciliter le passage d’un homme de la stature du père mais laissant passer une gamine en furie, affolée et habituée à se faufiler entre les arbustes entremêlés.
La fillette courut tant qu’elle put. Elle courut pendant de longues minutes, presque des heures. Parfois, elle trébuchait. Se relevait. Continuait sa fuite éperdue. Elle voulait à tout prix s’éloigner de cet endroit où les papas attentionnés sont capables de tuer une pauvre bête inoffensive. Les branches lui lacéraient le visage, elles se prenaient dans les boucles de ses cheveux, voulant en apparence la retenir, la freiner. Sa figure, ses bras, ses genoux étaient salis par la terre à chaque chute, les ronces empêchaient ses pas mais elle continuait, vaille que vaille, droit devant elle, ce qui est toutefois la meilleure solution pour s’extraire de la plus ténébreuse et gigantesque forêt possible.
Elle avait maintenant en horreur cette forêt qu’elle adorait il y a quelques heures encore. Elle ne voulait plus jamais revoir son père.
Soudain, une trouée se fit dans cet océan de verdure, cette immensité d’arbres. Une saignée parfaitement rectiligne, une coupure bien droite. Et deux rails qui touchaient à l’horizon, parallèles comme un trait tracé par Dieu. Et, posé dessus, comme par miracle, comme par magie, un train ronronnant, stoppé pour on ne sait quelle raison au milieu de la plus dense des forêts. La petite fille était fatiguée de courir, haletant et la poitrine en feu. Elle grimpa les quatre marches en acier qui donnaient accès à une plateforme située entre deux wagons. Elle n’eut pas la force de pénétrer dans le compartiment des voyageurs et s’effondra, en pleurs, à même le sol.
Le train se remit en marche. Et personne ne vint à passer devant elle. Le train emportait-il seulement des voyageurs ? Après tout, il était possible que ce fut un convoi de marchandises et on n’a pas encore vu des containers de produits manufacturés s’inquiéter d’une petite fille allongée entre deux wagons dans un train qui filait on ne sait où.
Un violent choc la réveilla.
Un instant elle crut qu’elle avait fait un mauvais rêve et que sa maman allait venir la réconforter par de douces paroles et un baiser sur le front. Mais tout lui revint en mémoire comme un coup de fouet claque dans l’air : son père abattant son nouvel ami le loup, sa confusion mentale, sa fuite éperdue au travers de la forêt, le train et puis un lourd sommeil qui l’avait plus fatiguée que reposée.
Elle descendit sur le quai. Il était désert et il faisait nuit. Une nuit sans étoile. Elle marcha comme dans un rêve, sans but précis. Elle n’avait nulle part où aller. Elle ne savait même plus pourquoi elle était ici. Juste une chose : elle ne voulait plus jamais revoir son papa, ne plus en entendre parler. Jamais. A l’occasion, elle écrirait une gentille lettre à sa maman. Pour lui expliquer. Tout redeviendrait normal sous peu.
L’inconscience des enfants.
La gare se situait en plein centre de la ville. Une grande ville. Car, même au cœur de la nuit, elle rencontrait des passants. Et personne ne s’inquiétait de la présence d’une petite fille déambulant toute seule à une heure pareille. Certains jetaient un regard à peine étonné sur elle, d’autres la dévisageaient, mais aucun ne s’enquit de ce qui pouvait lui arriver.
Epuisée, à bout de forces et en manque de volonté, elle s’allongea sur le perron d’une église, une grande et belle église. Ici, on appelle cela une cathédrale.
Ce fut madame Pipin, la bonne du curé, pardon : la servante de monseigneur l’évêque, qui la découvrit au petit matin. Elle grelottait dans son sommeil agité. Elle eut pitié. La simple et bonne femme courut à petits pas vers la sacristie et cela lui donnait l’air d’une poule se précipitant sur quelques grains de maïs jetés au hasard du poulailler. Elle ouvrit d’un grand geste énergique l’armoire qui renfermait quelques couvertures, en choisit la plus épaisse, la plus chaude et revint, dans son trottinement grotesque pour envelopper chaudement la petite orpheline, du moins c’est ce que croyait dur comme fer madame Pipin. Elle la prit dans ses bras. La pauvre enfant ne pesait pas plus qu’un moineau tombé du nid. Elle la coucha sur une paillasse de la sacristie et fila au presbytère afin de préparer une tisane brûlante. Elle s’enquit de belles tranches de pain puis se ravisa. Il devait rester quelques vestiges de brioche dans un placard, une brioche maison bien tendre et moelleuse.
Lorsque Monseigneur fit son entrée sur le coup des huit heures et demie, la petite fille était attablée dans un coin du presbytère en train de dévorer à belles dents la brioche parfumée à la fleur d’oranger. Madame Pipin n’avait pas eu l’audace de réveiller la gamine dans son sommeil, évoquant d’incorrecte manière l’adage « qui dort, dine ».
Avant même que Monseigneur ne mette une parole sur l’ébahissement que traduisait son regard rond, madame Pipin raconta son étrange découverte.
On posa des questions à la petite fille.
Pendant qu’elle mangeait de bon appétit la délicieuse brioche et qu’elle se brûlait la langue au contact de la tisane qui sentait la camomille et une pointe de vanille, elle avait réuni ses idées. Il ne fallait pas dire la vérité, sinon on la renverrait aussitôt chez elle, chez cet assassin qu’elle avait côtoyé depuis sa naissance sans s’en rendre compte.
Elle devait mentir. Oh, jute un tout petit mensonge. Elle savait bien que c’était mal de ne pas dire la vérité. Alors elle décida de ne rien dire, de faire semblant d’avoir tout oublié. C’était plus simple et ce n’était pas réellement mentir.
La commotion lui aura sans doute effacé toute sa mémoire récente, supposa Monseigneur. Cela reviendra d’ici quelques heures.
Mais une journée entière passa et la fillette ne paraissait se souvenir de rien.
On ne peut pas la garder ici, comme ça. Il lui faut un environnement rassurant, une famille.
Monseigneur réfléchissait à voix haute, comme toujours, si bien qu’aucun secret ne pouvait demeurer dans sa tête et que madame Pipin devenait, par obligation, comme la conscience de l’évêque.
Elle regarda Monseigneur avec l’air de vouloir dire « il y a surement bien quelque famille qui accepterait, pour un temps, de se charger de ce fardeau là ».
L’évêque hocha la tête.
En effet, il y avait bien les Lantier. Une famille qui ne ratait sous aucun prétexte l’office du Dimanche. Le mari, un riche négociant en spiritueux, et sa femme, dépensant ce que lui allouait son tendre époux autant en bonnes actions pour les nécessiteux qu’en clinquante toilette et dépenses de coiffeur, ne parvenaient pas à concrétiser leur sincère et profond amour en une descendance qui les aurait comblés de bonheur. Ils se rendaient, chaque Dimanche, à la grande messe de dix heures, celle où on s’y montrait davantage que l’on venait y prier. Cela désolait quelque peu l’évêque qui aurait souhaité que les Lantier lui préfèrent l’office du pauvre comme on disait alors. Une messe semblable à celle, plus clinquante, qui attirait la noblesse et la bourgeoisie qui ne se lève jamais si tôt, spécialement le Dimanche. Pourtant, Monseigneur en était intimement convaincu, les Lantier étaient de bons chrétiens, ne pensant pas à mal, mais trop influencés par leur réussite sociale et pécuniaire qui éloignait souvent les meilleures âmes du droit chemin tracé par Notre Sauveur Jésus Christ sur la voie de la rédemption. Monseigneur pensait que l’absence de progéniture aggravait cette légère déviance égoïste et que l’arrivée d’une fillette toute rose serait bénéfique à ce couple un peu trop narcissique. Quelqu’un qui les détournerait de cette trop grande avidité de représentation, d’exhibition de leurs richesses qui, Monseigneur en était intimement convaincu, ne servait qu’ à combler un immense vide affectif au sein même de leur foyer.
Madame Pipin avait déjà passé son châle mangé aux mites et coiffé un vieux foulard sans couleur et avait pris la direction des quais, là où demeuraient les Lantier.
Le couple avait acheté une modeste maison aux débuts de monsieur dans le monde des affaires. Mais le succès emplissant la bourse et contraignant à un certain train de vie, le négociant avait voulu déménager. Sa femme s’étant habituée à ce quartier assez tranquille sans être excentré, ayant développé un vrai penchant pour ces boiseries qui lui rappelaient sa Normandie natale, ils s’étaient résolus à agrandir la modeste habitation en une villa moderne et brillante. Monsieur y recevait ses futurs clients, y entretenait les habitués des carnets de commande et Madame se constituait, mois après mois, un réseau de relations digne d’une grande dame. Son maintient et sa toilette en étaient témoin, tandis que Monsieur restait classique dans son apparence, sauf que son tailleur était plus huppé, ses costumes mieux coupés et de bien meilleure étoffe.
Madame Pipin était une bonne femme. Elle ne voyait malice nulle part. Les mauvaises langues, toujours promptes à déceler le mal en toutes choses, même et y compris les plus nobles, auraient assuré qu’elle était un peu simplette. Or c’était seulement une bonté christique. Au pire, elles plaignaient avec ironie et sarcasmes ce couple un peu trop obnubilé par l’apparence et qui ne savait pas profiter des plaisirs simples qu’offre, chaque jour, l’existence, si on ne lui en demande pas trop.
Elle sonna. Un majordome vint ouvrir. Depuis que les Lantier recevaient le grand monde, ils s’étaient résolus à engager un maitre queue et une cuisinière pour la préparation des repas, une servante et bonne à tout faire et un majordome, portier à l’occasion pour le train domestique.
C’est la vitrine de notre maison arguait Madame, qui était passée maitresse dans l’art de recevoir et de paraitre. Un portier est la première personne qu’un visiteur rencontre, il est de notre devoir de n’engager que la crème du petit personnel. Ainsi Arthur, pur produit de l’école Londonienne, cultivant un accent qu’il risquait de perdre dans le Tout Paris, satisfaisait en tous points à cette définition de maitre domestique : élégance naturelle, digne des grandes familles britanniques, discrétion assurée, physionomiste aguerri avec un air agréable tout en respectant une certaine distance. Il parvenait, tout naturellement, à montrer qu’il n’appartenait plus à cette vulgaire valetaille tout en témoignant sa position secondaire à tout visiteur.
Il savait, de surcroit, reconnaitre et repérer les visites domestiques de moindre importance et le demi sourire qu’il affichait à toute visite, composé à la fois d’agrément et de soumission, qui voulait dire muettement « vous êtes le bienvenu dans cette maison où vous êtes déjà apprécié » et cette contenance qui faisait sentir à tout visiteur sa propre importance dans une maison telle que celle-ci, ce demi sourire et cette prestance s’effacèrent aussitôt devant la dégaine de madame Pipin. Il prit alors un air suffisant en lui demandant d’attendre dans le vestibule où on faisait patienter les coursiers le temps qu’il prévienne Madaaaame.
Josseline Lantier était une belle femme qui avait dû être jolie plus jeune. La différence est appréciable. Il y a dans la beauté une profondeur auxquels de simples traits harmonieux ne peuvent prétendre. Si la joliesse n’est qu’en apparence, la beauté est avant tout, intérieure. Madame Lantier avait acquis, tout au long de ses années de confort, une prestance et une assurance qui sont certains piliers de ce flamboiement qui donne aux belles femmes une étincelle de feu dans le regard.
Ses manières étaient celles d’une femme du monde, habituée à côtoyer la meilleure société, du moins ceux qui prétendent en faire partie. Elle possédait cette nonchalance propre à celles qui savent profiter des privilèges que leur accorde une existence sans manque, du moins en ce qui concerne les choses matérielles et elle possédait l’aplomb de celles qui savent se faire obéir.
Cette grande dame reçut donc madame Pipin. Le tableau était savoureux. Les deux femmes, d’un âge égal, représentaient les antipodes de la condition féminine. La grandeur et l’excellence d’un côté, la modestie et l’humilité de l’autre. Pourtant, en sondant plus profondément l’âme de ces deux contraires en apparence, on aurait certainement trouvé quantité de points en communs. Après tout, le sang de tous les hommes est de la même couleur.
Il fut convenu d’une rencontre avec la fillette pour le lendemain matin. Monsieur Lantier serait absent, ne pouvant s’offrir ne serait-ce qu’une demi matinée de congé et faisant entièrement confiance à sa femme en ce qui concerne sa propre vie, du moins la partie familiale et intime de celle-ci.
La petite fille fut éblouie par la cachet de la vaste demeure et sa timidité augmenta encore lorsqu’apparut madame Lantier dans un négligé en mousse rose pâle. Celle-ci trouva instinctivement la fillette de la meilleure composition et s’avança doucement.
Elle caressa d’une main tiède et douce le front volontaire de la fillette, déjà sous le charme de cette grande dame qu’elle appelait Madame.
Appelle-moi simplement Josseline fit madame Lantier dans un large sourire, se retenant au dernier moment de prononcer le mot maman. Il ne fallait pas effaroucher l’enfant. Même si celle-ci n’avait plus de mémoire, elle savait très bien qu’elle avait une maman bien à celle. Il était hors de question d’imposer des liens filiaux d’emblée. Ceux-ci viendraient tout naturellement avec le temps.
Madame Lantier était ravie de l’enfant qu’elle trouvait belle comme un cœur, d’une propreté irréprochable et douée d’une politesse qui est un réel passeport dans ce milieu policé et huppé.
La petite fille ne rencontra celui qui allait dorénavant lui servir de papa que le soir, assez tard somme toute. Ce fut, après l’étonnement des proportions gigantesques de sa nouvelle maison, une nouvelle découverte : ici, on ne se couchait pas avant minuit et les enfants, s’il y en avait eu, n’auraient regagné leur couche pas avant dix heures. Elle se souvenait qu’elle allait au lit avant huit heures dans la petite cabane au fond des bois.
Monsieur Lantier, dont elle ne sut jamais le premier nom, portait le costume trois pièces que sa profession exigeait. Le week-end, il endossait une veste de velours sur un gilet en cachemire. Il lui arrivait souvent de porter aussi la cravate en ce qu’il nommait « sa tenue de sport ».
C’était un homme de taille moyenne mais, tout comme Josseline, son habitude de vivre en constante représentation lui avait accordé une certaine prestance allant jusqu’à une autorité qu’il ne possédait pas de nature.
D’allure distingué, une légère moustache soulignant une lèvre supérieure trop mince, mais arborant le menton bien dessiné des ambitieux, un nez au milieu de la figure, deux yeux laissant percer le regard perçant d’une intelligence de commerce et de beaux cheveux noir de jais aux reflets bleutés lorsque les rayons du soleil faisaient miroiter ses mèches corbeau.
Il avait posé une main paternelle sur l’épaule de la fillette et prononcé d’une voix grave et chaude ces quelques mots :
« Tu es ici chez toi ».
En privé Monsieur Lantier était peu disert, il gardait ses arguments et ses beaux mots pour les négociations professionnelles et encore, il savait économiser sa salive et ne l’utiliser qu’à bon escient. Il était un homme qui écoutait davantage qu’il ne pérorait. C’était sa marque de fabrique et le garant de son succès. Toujours laisser les autres, les clients, les concurrents, les marchands, les acheteurs, les vendeurs, toujours laisser ce petit monde parler pour ne rien dire et n’avoir que le mot de la conclusion, le seul qui vaille la peine d’articuler quelques phonèmes. Cela lui avait réussit au-delà de toute espérance.
La petite fille prit rapidement ses marques. A force de jouer les amnésiques, elle s’était prise à son propre jeu et avait quasiment oublié sa vie humble et modeste d’avant.
Maintenant, elle portait de belles robes, coupées dans les meilleurs tissus, de ceux qui ne râpent pas la peau, qui sont si doux au toucher et qui ne froissent pas. Ils sentaient bon aussi. Josseline lui déposait quelquefois une goutte d’eau de rose sur ses petits poignets. Elle était ravie au-delà de tout ravissement.
Elle découvrait au jour le jour les secrets de la grande maison aux pièces innombrables. Elle possédait sa propre chambre qu’elle pouvait décorer à loisir selon ses propres goûts. Cette nouvelle liberté l’enivrait. Dans la petite cabane spartiate de la forêt la promiscuité était de mise. Ici, elle était en train de devenir une vraie demoiselle.
La capacité d’émerveillement d’un enfant est immense, quasiment infinie. Cela provient des « premières fois » que rencontre l’enfant. Toutes ces choses qu’il voit, qu’il entend, qu’il sent, qu’il découvre pour la toute première fois. Tout est neuf, inédit, original, inattendu, insolite. Ensuite, la vie n’est qu’une répétition de ces premières fois.
La petite fille était éblouie par tout le luxe qui entourait dorénavant son existence. Tout lui était une joie, un plaisir renouvelé à chaque instant. Cela commençait par ses habits. Jusque là, elle s’était contentée d’une robe de tissu grossier tirant sur le bleu ciel, de grosses chaussures ne craignant pas les flaques et la boue. Maintenant, elle possédait déjà trois robes aux froufrous de princesse.
L’une était couleur abricot, presque chair, se boutonnait comme une chemise et était ornée de fanfreluches de cretonne blanche au col et aux poignets. La seconde était couleur lilas, entre le rose bonbon et le mauve tendre des violettes. On l’enfilait comme n’importe quelle robe car elle n’avait point de bouton, juste une petite fermeture dans le dos qu’elle ne parvenait pas encore à fermer toute seule. La coupe était plutôt stricte, en satin soyeux et rehaussé de points de diamantine aux épaules et de touches de dentelles en mousseline. L’habit était fragile et la petite fille ne la portait que rarement. Enfin la troisième tenue était une robe droite, façon sari, composée de satin et tussor aux couleurs vives, orange, rouge sang, bleu de Chine et quelque touches d’un vert d’eau qui lui donnaient l’aspect d’une vraie petite indienne.
Elle possédait également un chemisier en organdi qu’elle portait sous une veste de velours côtelé. On lui avait offert un chapeau, une sorte de canotier orné d’une plume d’oie turquoise.
La petite fille adorait toutes ces fanfreluches, en raffolait comme à la fête foraine. Cette journée avait été l’une des plus merveilleuses de sa vie. Lorsqu’elle avait découvert le vieux manège de chevaux de bois, coincé entre un grand huit qui donnait déjà le tournis lorsqu’on se cassait la nuque pour observer son sommet et une baraque à loterie (« il n’y pas de perdants, tous les numéros sont gagnants » annonçait une voix nasillarde amplifiée par le micro et donnant dans des haut-parleurs comme un écho). Le manège respirait l’authenticité précieuse du temps d’avant. Elle avait levé le regard vers monsieur Lantier avec une prière dans les yeux. Le négociant avait regardé la petite avec le sourire de celui qui est sur le point de faire une bonne action.
« Vas-y, puisque tu en meurs d’envie ». Et la petite avait enchainé trois tours de suite, dont un offert. Bien sûr, elle appréciait le luxe des chevaux dorés, recouverts d’un velours grenat, vert émeraude ou jaune d’œuf. Elle n’avait d’yeux que pour les superbes lustres qui éclairaient la piste en lançant des scintillements dans ce début de soirée estivale. Mais ce qui l’enivrait le plus c’était cette ronde sans fin, comme si elle tournait sur elle-même. Mieux : que ce fut le monde entier qui tourna autour d’elle. Tout cela était si nouveau pour elle.
Ce soir là, quand elle rentra, tenant les mains de monsieur et madame Lantier placés de part et d’autre de la gamine, elle était heureuse comme elle ne l’avait jamais été. Elle ne se souvenait plus du tout de la belle et grande forêt, elle avait oublié jusqu’au souvenir de ses parents.
Les repas étaient une autre source de joie. Les besoins énergétiques d’un bûcheron ne cadraient pas avec les désirs cachés de finesse d’une fillette. Dans la cabane, c’était des pommes de terre tous les deux ou trois jours, accommodées de diverses façons, mais c’était quand même toujours la même chose. Et puis il y avait du chou, bouilli, en choucroute, ou coupé en lamelles et frit à la poêle. Elle n’échappait pas davantage aux diverses légumineuses de saison. Courges, courgettes, citrouilles, navets, salsifis, rutabagas, potiron. Sa maman était un vrai cordon bleu mais ici, dans la grande ville, elle découvrait quantité de nouveaux produits, tous plus fins les uns que les autres. La cuisinière connaissait son affaire et savait apprêter ces nouvelles friandises comme personne.
Asperges tendres comme une poire bien faite, langouste et homard aux saveurs raffinées, coquelets fondants sous la langue, foie gras délicieux comme une cuillérée de confiture de figues, aubergines et tomates aux herbes de Provence où l’on entendait presque chanter les cigales. Et bien sûr, il y avait les desserts. Là bas, au fin fond des bois, elle ne connaissait que les tartes maison à la pâte croustillante et lourdes de pommes, myrtilles ou encore de poires. Ici, c’était un festival à chaque fin de repas. Le petit déjeuner même était un enchantement : crêpes miniatures que l’on appelait pancakes avec un délicieux accent américain (elle avait, bien entendu, droit à des cours d’anglais, deux fois par semaine), brioches qui embaumaient l’orange et le citron, croissants si dodus qu’elle ne pouvait mordre dedans sans se défaire la mâchoire, petites bouchées remplies de confiture ou de compote. Mais l’apothéose c’était ces conclusions de repas ornées de forêts noires dégoulinantes de crème, ces Paris-Brest moelleux comme un Jésus qui sort du four, ces mille-feuilles croustillants et qui répandaient leurs miettes sur la table pour mieux les récolter ensuite en humectant son index et tapotant la table comme un moineau ou un pinson picorant des graines oubliées. Il y avait des mokas tendres et moelleux, des coupes de fruits exotiques en plein automne, des crèmes glacées et des sorbets, si rafraichissants au cœur de l’été. Elle avait eu droit au baba au rhum, dont la recette avait été adaptée en remplaçant le trop fort alcool des iles par de l’inoffensif cidre de Normandie (Josseline en profitait pour vanter à nouveau les mérites).
Et cela aboutit tout naturellement à un Dimanche à Deauville. La petite fille exultait. C’était la première fois qu’elle voyait la mer, mieux : l’océan.
Ce n’était pas à proprement parler une journée de pluie mais, la réputation de la région aurait pâtit d’un trop fort soleil et une belle averse venait de laver la plage juste avant leur arrivée. La lumière du soleil n’en était que plus vive, découpant l’horizon comme une paire de ciseaux taillerait d’un coup sec les flots infinis du ciel immense. Les vagues venaient fracasser leur écume aux pieds de la fillette qui riait sans raison. C’était même mieux que la fête foraine. Elle ne le savait pas encore, mais ses penchants pour la nature ne s’étaient point totalement effacés de son être. Les couleurs étaient sublimes, moins clinquantes qu’à la fête, mais plus vraies, plus authentiques. Le soleil jouait avec les nuages qui prenaient des formes animalières (elle vit successivement la tête d’un cheval, les contours d’un lapin, la silhouette d’un canard et même la physionomie d’un loup… A cette évocation, elle perdit son sourire, plongée subitement dans une mélancolie amère qu’elle ne comprit pas sur le coup et s’évertua très vite à faire disparaitre en courant comme une petite folle dans l’eau mourante, éclaboussant sa toute neuve tenue de marin).
Elle dormait du sommeil du juste, pelotonnée à l’arrière de la voiture silencieuse, excepté une sonate de Bach qui chuintait par les hauts parleurs de l’installation stéréophonique que Monsieur Lantier avait fait installer dans sa belle Mercedes dernier modèle. Madame Lantier posa sa douce main sur l’épaule de son mari en jetant un œil sur la petite. L’image du bonheur.
On inscrit la petite fille dans une école. On se fia à son âge car, n’ayant jamais été scolarisée, on ne savait pas quel était son niveau. Toutefois, lorsqu’elle l’écoutait, son éloquence, ses réparties, ses réflexions, son regard sur le monde et les choses, madame Lantier envisageait une entrée au collège. Monsieur Lantier, plus pragmatique, opta pour l’une des deux dernières années de primaire. Il serait assez temps de rectifier le tir au bout d’un mois. Il était en effet plus facile de gravir un échelon ultérieurement que de plonger la fillette dans un programme trop difficile pour elle d’emblée, cela pourrait la traumatiser et avoir des conséquences néfastes à long terme.
On prit rendez-vous avec la directrice d’un établissement correct. Ce qui étonna la petite fille, c’est que mademoiselle Franchon, qui avait de surcroit en garde le cours élémentaire première année, parla plus longtemps avec les Lantier qu’avec elle, comme si c’était eux qui allaient user leur fond de culotte sur les bancs du cours moyen première ou deuxième année.
Ce fut une catastrophe.
Dès le premier jour de la rentrée. Elle n’avait jamais vu autant d’enfants dans un si petit espace, y compris les rares fois où son papa l’emmenait au village le plus proche. Ca piaillait, ça criait, ça braillait dans tous les coins de la cour de récréation. Elle en avait mal aux oreilles. Elle s’était dirigée instinctivement vers un groupe de filles, mais celles-ci la snobèrent gentiment, lui faisant avoir par des regards hautains et méprisants qu’elles ne l’accepteraient jamais dans leur cercle privilégié. Un autre attroupement gloussait et jacassait sur des bêtises du niveau maternelle et un troisième ne parlait que d’acteurs et de chanteurs à la mode dont elle ne connaissait aucun nom et n’avait que faire.
Elle alla voir du côté des garçons. Mais ce n’était pas mieux. Quelques-uns jouaient au ballon et ne voulaient pas d’une pisseuse dans leur équipe, d’autres semblaient trop violents, dans leur vocabulaire et dans leurs gestes. Enfin, un dernier groupe, très volubile, se tut instinctivement à son approche. On la regardait comme une espionne ou une pestiférée.
En classe, c’était pire.
Elle savait et connaissait déjà par cœur tout ce que la maitresse leur présentait, trouva que celle-ci s’adressait à eux comme à des bébés et commença à s’ennuyer ferme.
Les jours s’écoulèrent. Elle n’avait pas besoin de repasser ses leçons, elle connaissait tout d’avance. Mais le jour de la première composition, sur laquelle on allait se baser pour évaluer on niveau réel, elle reçut la plus mauvaise note de la classe, ce qui ne facilita pas son intégration parmi ses camarades qui lui tournaient maintenant régulièrement le dos. Si ses réponses étaient correctes, elle ne possédait pas la méthode. « Un esprit frondeur », se fit en réflexion la maitresse lors de l’annotation de la copie, une facétie et une malice qu’il fallait mater au plus vite au risque d’en faire un élément incontrôlable dans l’avenir.
Elle restait donc seule, adossée à un mur, pendant les récréations, apercevant les moqueries des autres dans son dos. Elle rêvassait d’ennui pendant les cours, ne se sentant à sa place nulle part dans cette école.
Et pour la première fois depuis sa nouvelle vie, elle pensa à la petite cabane au fond de la forêt, à sa maman et à son papa. Il y avait un petit pincement dans son cœur de petite fille.
Il restait, bien heureusement, la famille Lantier et tout ce monde, si riche en nouveautés, à découvrir. Elle avait l’impression de vivre dans un pays magique où tout semblait possible, où il se passait toujours quelque chose.
On l’avait emmené visiter un musée d’art pictural. C’était une grande bâtisse qui avait dû abriter de vastes ateliers où l’on fabriquait des casseroles de toutes les tailles et de toutes les formes, ou bien des bottes en caoutchouc ou des poignées de porte ou des nappes de cuisine ou des boules de pétanque… Cela pouvait tout aussi bien avoir abrité d’innombrables métiers à tisser d’où sortaient des kilomètres de tissus de toutes les couleurs, ou encore une imprimerie qui, toutes les nuits dans un vacarme de champ de bataille, tatouait les nouvelles sur du papier journal dont l’encre, encore fraiche, maculait les doigts de ceux qui se levaient avant l’aube. Si ce vaste hangar avait été le siège d’une manufacture d’objets essentiels à la vie quotidienne, dorénavant c’était un lieu dédié à l’art avec un grand A.
La fillette demeurait interdite devant cette multitude de toiles, gigantesques pour certaines. Elles représentaient une foule à l’assaut d’une place forte et elle pensa au 14 Juillet 1789, un navire de pêche tourmenté par la tempête et elle songea à Moby Dick. Une scène de bataille Napoléonienne dans les brumes matinales, le foisonnement de couleurs d’une jungle exotique, le portrait d’un vieil homme qui semblait accablé de souvenirs trop lourds à porter désormais, un lac répandant sa quiétude et son ennui sur trois mètres carrés, encore des foules véhémentes, des portraits d’inconnus qui, un jour, ont dû poser des heures devant le chevalet de l’artiste pour daigner passer à la postérité dans un mélange de couleurs savamment choisies et accommodées. La fillette restait bouche bée devant cette débauche de fresques, évoquant des sentiments forts et puissants, se dégageant des tableaux exposés.
La nuit suivante, ses rêves avaient toutes les couleurs de l’arc-en-ciel.
Mais ce n’était rien comparé à sa première séance de cinéma. Elle n’avait jamais vu de film de sa vie. Il n’y avait pas de téléviseur dans la cabane. A quoi bon ? La vie se vivait en direct, comme on le dit si bien aujourd’hui.
Madame Lantier l’avait accompagnée lors d’une séance en matinée en lui expliquant que cela voulait dire en journée. Il y avait d’autres séances, où l’on projetait toujours le même film, mais le soir. Les matinées étaient plus pratiques pour les enfants.
Elles s’assirent dans une salle aux murs tendus de velours beige. Quelques dizaines de rangées de fauteuils, tous pareils et tous orientés vers un écran gigantesque. Elles prirent place bien au milieu de la salle, au premier tiers. Il n’y avait quasiment pas de public à cette heure là. Un grand rideau coulissa comme au théâtre et madame Lantier lui promit de l’emmener un jour voir un vaudeville. La petite fille ne comprit pas ce nouveau mot mais n’osa pas en demander la signification. Les lumières s’estompèrent. L’écran s’alluma. Et ce fut comme dans un rêve. Le cinéma, c’était le rêve d’une personne, partagé par des centaines, des milliers, parfois des millions d’individus.
Le film était une comédie musicale. Des gens chantaient, puis dansaient, puis chantaient en dansant, puis s’embrassaient tendrement, puis se quittaient, chantaient encore, mais d’une façon plus triste et, à ce moment là, ils ne dansaient plus. Et alors, ils se retrouvaient et dansaient, chantaient en souriant et tout le monde était content parce que l’histoire finissait bien.
Pendant plusieurs jours, la petite fille eut encore les airs des chansons dans sa tête.
Vint Noël.
Elle se souvint des décembres passés. Les préparatifs commençaient le jour de la Saint Nicolas, le 6 décembre. L’après-midi se passait en cuisine où, avec sa maman, elle préparait une belle quantité de petits gâteaux, des sablés décorés en forme d’étoile, de cœur, de pantins, de trèfle, de flèche… Il y avait des bonhommes en pain d’épice, des biscuits à l’orange, à l’ananas. Un parfum de cannelle et de diverses épices chaudes et exotiques flottait dans la cabane, chauffée par le four qui enchainait les fournées de tendres friandises. Une odeur de sucre volait dans l’air.
Pendant plusieurs soirées, toute la famille allait peindre les cocottes et les pignes de pin récoltées en forêt durant novembre de jolies couleurs, rouges comme les belles tomates d’août, vertes comme l’herbe du printemps, bleues comme le ciel de juillet, jaunes comme les blés d’automne, pourpres comme les couchers de soleil ou mauves comme les violettes du mois de mai.
Un soir, la fillette et sa maman tendirent à travers la pièce de grandes guirlandes de bonhommes découpés avec attention et précision dans du papier multicolore. Cela faisait de curieuses spirales et d’étranges volutes qui côtoyaient les pignes décorés et les petits biscuits pendus ici et là dans toute la cabane. Les lutins de papier se donnant la main frétilleraient sous les assauts de l’air chaud, valseraient au rythme des effusions du feu de cheminé qui embaumait les pelures d’orange que l’on disposait dans l’âtre. Pour la seule et unique fois dans l’année, elle découvrait des fruits qui ne poussaient pas dans la forêt : oranges, bananes, ananas, mangue. Elle attendait cette période comme on s’impatiente du temps des cerises, des premières fraises ou du mois des poires acidulées.
Les fenêtres étaient ornées de branches de houx, cueillies lors de balades en forêt à marcher sur un tapis de feuilles jaunies par les froides aubes de novembre, on y ajoutait des branchettes de sapin comme des peignes naturels ou encore ces aiguilles de pin qui forment une sorte de houppe hérissée et qui ressemblaient au hérisson d’acier qu’utilisait son papa pour ramoner la cheminée à l’automne.
Elle disposait aussi les jolis pompons colorés qu’elle avait patiemment fabriqués pendant les journées pluvieuses du dernier automne avec les chutes de laine que sa maman utilisait pour confectionner de superbes chandails bien chauds pour l’hiver à venir.
Toute la cabane prenait des airs de fête, des couleurs chaudes et rassurantes, s’étalant du rouge au vert en de subtiles nuances. L’air était saturé de senteurs délicates, sucrées et exotiques. La fillette adorait cette période au cœur de l’hiver, saison qui lui interdisait pourtant quantité de sorties au dehors, de crapahutage et d’échappées forestières.
Elle se réjouit donc de l’approche des festivités de la fin de l’année avec une grande impatience. Puisqu’ici tout était plus joli, plus grandiose, plus majestueux, plus noble, elle s’attendait à une débauche de couleurs et de senteurs épicées, de belles et grandes journées à préparer cette fête des enfants qu’est avant tout Noël.
Sa déception fut à la hauteur de son attente.
On avait acheté un bébé sapin au marché de Noël de la grande ville. La fillette ne comprenait pas pourquoi on sacrifiait un être aussi innocent pour le seul plaisir de se faire plaisir. On lui affirma que c’était le symbole de Noël, que toutes les familles décoraient un sapin au mois de décembre.
Elle en fut grandement affectée et les paroles de son papa résonnèrent à ses oreilles. Lui s‘enorgueillissait d’abattre des arbres parvenus à maturité pour fabriquer les grands navires qui vogueraient sur les océans lointains, les poutres démesurées qui soutiendraient des cathédrales, des nobles arbres qui deviendraient, sous le geste précis et entrainé de véritables artistes, de superbes meubles et tout autant d’objets utiles et beaux, agréables au toucher, ayant une âme.
Mais sacrifier un petit sapin qui n’avait pas vécu cinq hivers pour le voir dépérir sous un flot de décorations… Et quelles décorations !
Elles n’avaient rien de naturel et on ne passait pas une minute à les fabriquer, tout juste une moitié de journée à les installer. Ce n’étaient qu’ampoules aveuglantes, guirlandes clignotantes et projections lumineuses sans queue ni tête. Un projecteur envoyait carrément des messages dans le ciel, Joyeux Noël et Bonne Année, qui se reflétaient dans la pénombre nocturne, effaçant la magie et la poésie des étoiles. Lorsqu’un léger brouillard stagnait en fines nappes, cela déformait la calligraphie, lui donnant l’air de vouloir danser dans le ciel. Tout le monde s’extasiait.
Le voisinage était d’une jalousie maladive : une fois encore, les Lantier possédaient le plus bel éclairage de Noël du quartier, peut-être même de la ville. Tout le monde était estomaqué, tout le monde se répandait en félicitations, feintes ou sincères. Tout le monde, sauf la petite fille qui avait simplement hoché la tête et sourit de sa seule bouche. Son cœur était triste.
Ce qui faisait l’admiration du quartier tout entier n’avait coûté que l’achat d’un arbre enfant et une simple journée où monsieur Lantier, aidé d’un commis, prélevé parmi ses employés, avait disposé des kilomètres de fils électriques, arpentant le jardinet dans toutes ses longueurs, grimpant l’échelle pour inonder la façade et le toit (partie du commis) de ce qui allait s’illuminer automatiquement le soir venu, lorsque la clarté deviendrait moindre. C’était la partie réservée à monsieur Lantier. Il avait passé tout le reste de la journée à programmer un logiciel qui régirait ce spectacle censé être grandiose, à la seconde près. Lorsque, le soir du 6 décembre, monsieur Lantier, bien campé sur ses jambes face à sa splendide demeure, comme un cowboy s‘apprêtant à défier un adversaire dans un ultime duel, posa l’index doigt sur son smartphone, la tension était à son comble. Il n’aurait supporté aucun raté.
L’index toucha la petite icône symbolisée par un bonhomme de neige sur son téléphone intelligent et tout s’illumina pour trente jours. Monsieur Lantier se gonfla d’une fierté de coq régnant sur la basse-cour. C’est du moins l’impression que la fillette en eut à ce moment où la petite dizaine de badauds du voisinage applaudit, des éclats de lumière se reflétant sur leurs pupilles de béotiens. Madame Lantier enfonça le clou en prédisant que l’année prochaine, ils en feraient profiter leur entourage à partir de la mi-novembre et jusqu’au 15 Janvier. La petite fille trouva cela écoeurant.
Mais le plus lamentable ce fut ce bonhomme de neige, une vulgaire baudruche gonflée comme une grossière chambre à air et qui attendait patiemment une neige qui, ici, ne tomberait jamais. Le mauvais goût atteignait ici le ridicule.
Elle se souvint d’un Noël d’antan, elle ne devait avoir pas plus de quatre ou cinq ans.
Après un repas de fête la veille de Noël, composé d’un canard rôti aux châtaignes accompagné de pommes dauphines délicieusement croustillantes et moelleuses, de filets de saumon au citron servis sur des planchettes de sapin et d’une ile flottante qui embaumait la noix de coco et légère comme de la dentelle, elle s’était couchée, le cœur battant. Cela avait été la plus belle journée de sa vie. Comme elle avait confié ce sentiment à sa maman qui était venue la border dans son petit lit, celle-ci lui avait assuré, dans un demi-sourire plein d’indulgence, que ce ne serait pas le seul et loin d’être le dernier.
Elle s’était endormie sur cette idée du premier meilleur jour de sa vie en espérant un joli cadeau déposé dans ses chaussons, au pied de l’âtre, dès l’aube du lendemain.
Quelle ne fut pas sa surprise lorsque son papa la réveilla au milieu de la nuit. Il devait être quatre ou cinq heures du matin. Sans faire de bruit, il lui tendit un pantalon de grosse toile, son plus chaud pullover tricoté maison et lui intima la précaution de chausser ses bottes fourrées. Alors, il ouvrit la porte de la cabane et là, dans la faible lueur de la loupiotte qu’il tenait à la main, un paysage immaculé étendait son duvet blanc jusqu’aux premiers sapins, recouverts, eux aussi, d’une pellicule de neige. Des flocons gros comme la main (celle de la fillette, n’exagérons pas), tombaient avec cette nonchalance propre aux oisifs de tout poil, qui donne à toute chose futile un pouvoir essentiel.
A genoux dans cette première neige, elle avait aidé son papa à créer le plus beau bonhomme de neige de l’univers. Elle riait aux éclats de sa petite voix n’appartenant qu’à la petite enfance, toute enrobée d’airs de naïveté et d’innocence. Elle n’avait d’yeux que pour Albert, le bonhomme de neige qui grandissait sous ses yeux emplis de bonheur de petite fille et qu’ils venaient de baptiser ainsi, son papa et elle. Les cris de joie réveillèrent la mère qui se contenta de jeter un regard plein d’amour au travers de la fenêtre embuée qu’elle effaçait d’un revers de main comme un pêcheur inuit fait son trou dans la banquise pour pêcher. Elle allait ensuite préparer un bon chocolat chaud, avec des vrais carrés de chocolat et du miel qui allait mijoter de longues minutes, tout le temps qu’il faudrait pour peaufiner Albert en n’oubliait ni le vieux chapeau troué, ni une belle carotte en guise de nez pas plus que le balai de brindilles grossières dont on se servait pour assembler les feuilles à l’automne. Papa avait même déniché une vieille pipe dans un fond de tiroir. Albert avait fière allure. Le père et la fillette se réchauffèrent ensuite en entourant de leurs mains les deux bols emplis du délicieux breuvage et mordant à pleines dents dans les brioches mises à tiédir au coin du feu.
La petite fille pensait à tout ceci en regardant d’un air désolé le faux bonhomme made in China, trois fois trop gros et sans aucune âme. Si elle avait raconté quantité de secrets en cachette à Albert, nul doute qu’elle ne s‘épancherait pas devant ce bonhomme en plastique. Celui-ci ne possédait pas de cœur, c’était certain.
Tandis que la ville s’illuminait de mille feux, que la maison des Lantier scintillait des décorations de Noël, le cœur de la petite fille s’était chagriné par un nouveau sentiment, plus amer que n’importe lequel des rares déceptions de sa petite enfance. Souvent elle pensait à sa vie d’avant, au cœur de la forêt, à ses journées à gambader parmi les sapins majestueux, à ses soirées douillettes dans la cabane.
Le soir en particulier, dans son petit lit avant de s’endormir, une nostalgie venait s’immiscer dans ses pensées. Une sorte de mal du pays que l’on ressent loin de chez soi et qui nous fait prendre conscience de la valeur des choses que l’on ne prenait pas la peine de remarquer jusque là, parce qu’on les avait sans cesse sous le nez. On ne voit bien souvent plus clairement que les choses qui sont cachés, comme l’attachement ou l’amour que l’on a pour les êtres.
Sa maman lui manquait.
Son père aussi. Elle ne lui en voulait plus vraiment pour son terrible geste. La scène terrible qui l’avait poussée à s’enfuir commençait à se déliter dans sa mémoire. Ses contours étaient moins acérés, son souvenir moins vif.
Elle comprenait à présent les raisons qui l’avaient poussé à une telle impulsion, une sorte de réflexe. Maintenant, elle se souvenait très bien de l’histoire du petit frère, victime des assauts d’une louve qui, elle aussi, avait réagi sans réfléchir, ne voyant que la sécurité de ses petits en danger. Le petit frère ne voulait que jouer avec les louveteaux, ça elle ne l’avait pas compris. De la même manière, son papa n’avait pas vu cette amitié irréelle entre sa petite fille et un loup mais au contraire un danger affreux et imminent.
Elle lui pardonnait.
Jour après jour, soir après soir, le moral de la fillette s’assombrissait, elle avait davantage de mal à rire, à sourire, même à respirer parfois. Elle ne s’amusait plus autant. Jusqu’aux séances de cinéma qui ne l’animaient plus comme avant.
Elle se rendait compte surtout de la futilité de toutes les belles choses de la ville. Toutes ces choses qui l’avaient ravie, enchantée et charmée. Toutes ces nouveautés qui lui avaient ouvert si grand ses yeux de petite fille. Toute cette vanité, cet orgueil, lui apparaissait maintenant au grand jour. Elle ne voulait pas devenir imbue de connaissances que n’ont pas ceux de la campagne, une prétention propre aux citadins qui pensent tout savoir et ne savent rien en définitive, se trompant largement sur les choses essentielles de la vie.
***
C’était la veille de Noël et tous ces sentiments se bousculaient sans ordre dans sa tête de petite fille. Elle ne comprenait pas toutes ces émotions toutes neuves, d’où elles prenaient naissance et comment ces sensations évoluaient. Ce qu’elle savait fort bien, en revanche, en ce jour magique, c’est qu’elle n’était pas heureuse. Et quelqu’un qui n’est pas heureux le jour – ou même la veille – de Noël ne peut continuer à vivre de cette façon.
Après le déjeuner, qui fut pourtant un véritable feu d’artifice de saveurs délicieuses, mais dont elle n’arrivait plus à apprécier ces délices à leur juste valeur (on lui avait même autorisé à tremper ses lèvres dans une coupe de champagne pour accompagner un Paris-Brest d’anthologie), après ce déjeuner qui devait, qui aurait dû être un régal, elle se retira dans sa chambre. Elle se saisit d’une belle page bleu ciel et écrivit une lettre. Les mots venaient tous seuls. Tout en écrivant, elle se rendit compte qu’elle n’avait jamais écrit à ses parents, à sa maman, comme elle se l’était pourtant promis. Elle eut honte. Et ce sentiment était le pire qu’elle put éprouver, semblable au poids d’un éléphant sur ses épaules ou sur sa poitrine. Cela l’empêchait de bien respirer.
Elle expliqua en quelques mots simples le pourquoi de son geste. Elle laissa la missive bien en évidence sur le petit bureau qu’on lui avait aménagé afin qu’elle puisse faire ses devoirs dans les meilleures conditions. Cette lettre était pour les Lantier.
Elle n’avait pas besoin d’écrire à ses parents. Elle y retournait, tout simplement.
Elle n’emmena aucune affaire. Les beaux habits étaient bien pour la ville mais elle avait tout ce qu’il lui fallait là-bas, au cœur de la forêt. Chez elle.
Elle sortit comme si allait se promener au parc qui jouxtait la belle demeure clinquante. Arrivée au coin, elle se retourna et eut un dernier regard sur les derniers mois de sa vie. Elle ne regrettait rien et si elle partait maintenant c’était justement pour ne pas avoir à se lamenter plus tard.
Elle prit la direction des premières collines, ventres de géants qui semblaient se repaître d’un trop bon repas. Le soleil brillait dans le ciel, mais en restant prudemment à proximité de l’horizon, comme s’il n’avait plus la force de s’élever bien haut dans l’azur comme il le faisait si bien au milieu de l’été.
Le froid mordant de ce 24 Décembre donnait en revanche de l’entrain à la fillette. Elle marchait d’un bon pas, serrant la petite broche que lui avait offert madame Lantier pour sa fête, le seul objet de la grande ville qu’elle emportait avec elle. Elle n’avait pour bagage que les plus jolis souvenirs récents et une envie irrésistible de rentrer chez elle.
Elle marcha deux heures avant de se retrouver devant cette belle et majestueuse forêt où se nichait la cabane. Mais alors, un doute vint l’assaillir.
Tout comme il est plus facile de vider un tube de dentifrice que de le remplir, il était plus aisé de sortir de cet océan vert : il suffisait de marcher toujours droit devant soi. On finissait immanquablement par émerger du flot sylvestre. Par contre, comment retrouver ne serait-ce que le centre d’une telle étendue ? Elle se sentait désorientée, déboussolée, désemparée. Tout en continuant d’avancer d’un pas moins sûr, elle se posait toutes sortes de questions. Et si elle ne parvenait pas à retrouver le bon chemin ? Si la nuit surgissait sans qu’elle ait trouvé la cabane ? Il ferait alors certainement très froid en plein hiver. Et la nuit tombait si tôt en cette période.
Comment allait-elle faire ? Elle essaya de se rappeler son chemin de fuite, mais cela ne servait à rien. Elle était, à ce moment là, si troublée, tellement affolée et traumatisée qu’elle n’avait pu noter aucun indice, aucun signe pour se rappeler le chemin. Ce gros rocher, l’avait elle vu ? Cette source, était-elle sur le bon chemin ? Tous les arbres se ressemblaient comme autant de clones qui ne servaient qu’à l’égarer davantage. Une chouette hulula dans son dos. Elle eut peur, soudain. Le cri de la chouette ne l’avait pourtant jamais effrayée. Mais cette fois, cela sonnait comme un avertissement, un mauvais présage, un rire moqueur qui semblait lui annoncer qu’elle allait se perdre, que la nuit viendrait et qu’elle allait errer toute cette nuit de Noël sans pouvoir retrouver le bon chemin.
Elle se mit à courir, alarmée. Et c’était la pire des choses à faire. Cela ne la poussait que mieux à tourner en rond. Ce gros rocher, ne l’avait-elle pas déjà croisé, cette source n’était-elle pas la même que tout à l’heure ? Et toujours ce cri terrifiant, cet avertissement lugubre que poussait l’oiseau de mauvais augure. C’était certain maintenant, elle était perdue. Perdue au milieu d’une forêt tellement gigantesque qu’on ne la retrouverait pas de sitôt. Elle allait surement mourir, là, dans le froid et les ténèbres, loin de ceux et celles qui l’aimaient et tout ça par sa faute.
Elle imaginait les Lantier commençant à s’inquiéter parce qu’elle n’était pas rentrée pour le goûter de quatre heures. Ils savaient bien qu’elle ne pouvait jamais longtemps résister aux belles tartines de confiture de myrtille, à la clémentine acidulée qui picote la langue, au grand verre de jus de pomme ou au chocolat chaud qui embaumait toute la maison dès qu’elle ouvrait la porte d’entrée. Et un vertige s’empara d’elle : elle n’avait jamais, ou si peu, pensé à l’inquiétude de sa maman, le tourment de son papa à ne pas l’avoir vue rentrer en ce jour néfaste. Quels avaient pu être leur angoisse, leur crainte, leurs soucis ? Ils l’avaient peut-être crue morte. Quelle horreur ! Et elle eut encore plus honte de son geste. Il fallait à tout prix qu’elle retrouve le chemin de sa maison.
Mais c’était impossible. Et toujours ce gros rocher dont la silhouette évoquait une face de monstre dans la lumière déclinante de cette journée d’hiver, cette source dont le chuchotement semblait se railler d’elle et le cri moqueur de la chouette dans son dos. Elle revit la cour de récréation où les autres élèves se moquaient d’elle.
Alors elle tomba par terre, au pied d’un pin Douglas et de grosses larmes se mirent à couler sur ses joues toute rouges d’avoir ainsi couru en pure perte. Jamais plus elle ne reverrait ses parents. Ils auraient raison alors de la croire morte. Plus jamais elle ne reverrait les Lantier et leurs dispositions à se faire voir. Mais c’étaient de bonnes personnes, toujours prêtes à rendre service et débordantes d’amour. Du reste, il était probable, il était même certain que la disparition de la fillette, une fois l’affliction d’une telle perte guérie, leur fasse comprendre la futilité de leur besoin de paraitre à tout prix. Monseigneur l’évêque allait se réjouir : ce couple deviendrait de bons chrétiens, toujours prêts à aider et moins sujets à une représentation stérile. Là encore, c’est le manque d’un être devenu cher à leurs yeux, qui les feraient changer d’avis, les feraient changer de vie.
Elle pleurait sur son égoïsme à elle. Elle avait fuit le nid maternel sans chercher à comprendre le geste de son père. Elle avait fuit sans réfléchir, en faisant surement une immense peine à ceux qui l’aimaient par-dessus tout. Son papa était un papa formidable, elle ne le savait que trop bien maintenant qu’il était trop tard pour le lui dire, le lui montrer.
Elle avait fuit sa maison d’accueil à la ville, où on l’avait toujours traité en princesse. Elle ne le méritait pas, pauvre enfant gâtée qui ne s’en rend pas compte. Pour seul remerciement de toutes ces bontés, elle s’était enfuie, laissant le chagrin dans le cœur de ceux et celles qui l’aimaient tendrement. Elle eut honte à nouveau. Et ses larmes redoublèrent. Elle était perdue, autant géographiquement que moralement.
C’est alors qu’elle sentit tout contre elle quelque chose de chaud. La nuit commençait à tomber et elle aurait dû plutôt avoir plutôt froid que chaud. Elle pensa que ça devait être ça, la mort : quelque chose de chaud qui vous engourdissait lentement, inexorablement, fatalement.
Elle ouvrit les yeux et ce qu’elle vit prouvait forcément qu’elle était arrivée au pays des morts. Un loup, son loup, la regardait droit dans les yeux. Elle comprit qu’elle ne reverrait pas encore ses parents, elle devrait attendre qu’ils meurent à leur tour. Mais peut-être ici, dans ce pays de la mort, le temps ne s’écoulait-il pas de la même façon que sur Terre ?
Elle regardait le loup qui se tenait devant ses yeux, son pelage était toujours aussi beau que de son vivant, un gris bleuté avec des reflets argentés sous le pâle éclat de la lune. Tout ressemblait au monde des vivants à s’y méprendre. Les arbres qui l’entouraient avaient la même grandeur, le gros rocher semblait fait de pierre, la source murmurait la même chanson. Elle comprit que l’autre monde était une copie du réel, mais que les êtres qu’elle rencontrerait seraient des fantômes, des âmes disparues de la surface du monde réel. Elle caressa le flanc du loup qui se laissa faire, s’approchant davantage. Lui aussi semblait heureux de la retrouver. Sa main rencontra une touffe de poils plus doux, comme un duvet. Elle fut étonnée. Elle observa mieux, là, au niveau de l’épaule, à l’endroit exact où l’animal avait été mortellement blessé. Le pelage avait été comme rasé afin de soigner la blessure et de nouveaux poils avaient repoussé, plus tendre. Comment une blessure pouvait elle… Elle n’eut pas le temps de terminer sa réflexion, la chouette hulula dans la nuit de décembre. Et, cette fois, ce cri lui sembla rassurant, plus du tout moqueur comme il y a quelques minutes. Si elle entendait la chouette, elle bien vivante, c’est que, peut-être, elle n’était pas tout à fait morte ? Et si la blessure du loup avait été soignée, ça ne pouvait être que par son papa.
Mais déjà l’animal, impatient, réclamait qu’elle le suive. Elle se leva, chancela un temps, puis reprit un peu de force et de vigueur. Oui, c’est ça : elle n’était pas morte, la chouette lançait son cri dans la nuit, à la recherche d’un partenaire car on ne peut vivre seul, même le plus solitaire des animaux a besoin d’une compagnie. Elle allait suivre le loup jusque chez elle, elle en était sûre maintenant. Aussi certaine que la rédemption de son père qui avait recueillit le loup, avait pansé sa blessure, lui avait apporté des soins en espérant, par cet acte de contrition, que la guérison de l’animal sauvage lui ramènerait sa petite fille chérie.
Le loup connaissait parfaitement son chemin. Il devait connaitre surement la forêt toute entière. La faible clarté de la lune aidait à ne pas trébucher sur les branches au sol. La fillette suivait sagement la bête qui, de temps en temps, donnait un coup d’œil par-dessus son épaule. Dans sa poitrine d’enfant, la petite fille sentait son cœur battre comme jamais. Et plus elle s’approchait de la cabane au fond des bois, plus celui-ci cognait fort. Une émotion toute nouvelle s’empara d’elle toute entière, inonda chaque cellule de son être.
Enfin, par delà une touffe de jeunes épicéas qu’elle reconnut, apparut une lumière orangée. La cabane était là, sous ses yeux, à portée de voix, son toit trapu d’où s’échappait une fumée blanche par la petite cheminée comme la respiration d’un être bien vivant. Les carreaux des fenêtres étaient badigeonnés de givre, on ne voyait pas l’intérieur et personne n’aurait pu voir un étranger arriver.
Mais elle n’était pas un étranger. Et ses parents avaient dû ressentir une présence amie, une présence aimée. Comme mue par un sixième sens, la lourde porte en chêne s’ouvrit dans la nuit de cette veille de Noël.
Là, se trouvait le plus beau des cadeaux jamais offert à Noël. Dans la nuit glaciale, une petite fille grelottante qui retrouvait ses parents. Et dans cette chaude et accueillante chaumière, les parents soulagés de retrouver leur petite fille adorée.
Le loup resta en lisière de la forêt. Il eut un regard de reconnaissance lorsque le bûcheron le fixa comme pour lui dire merci.