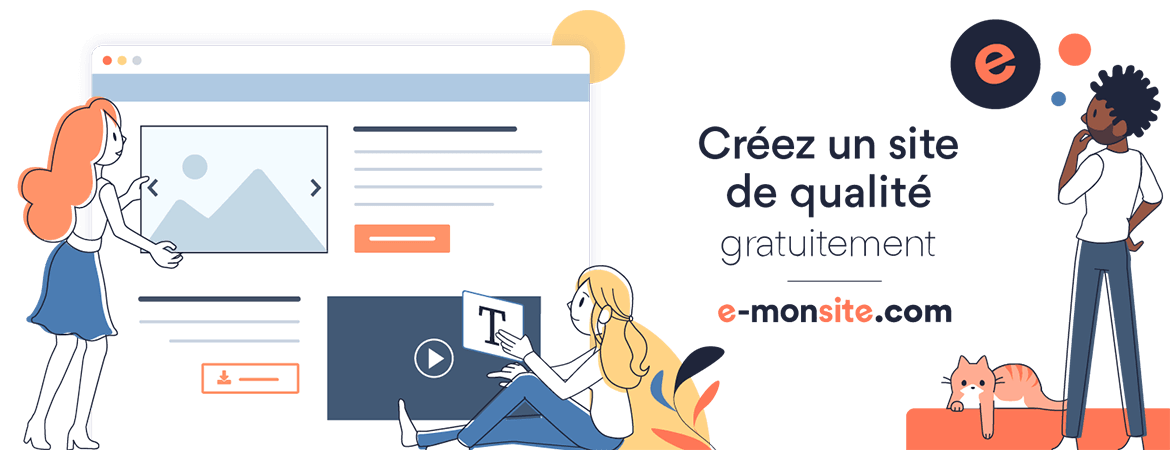Recette pour écrire une histoire
Ingrédients: un stylo, un bon dictionnaire, beaucoup de matière grise.
Une histoire c’est un château, une cathédrale ou plus modestement un petit nid douillet, une cabane perchée dans les arbres, une chaumière robuste. Bref, un endroit où l’on aime se réfugier.
Les briques sont toutes contenues dans cet épais volume à l’allure maussade, ennuyeux et rébarbatif mais sous ces dehors repoussants c’est une vraie mine, un trésor. Elles sont toutes bien rangées par ordre alphabétique, il n’en manque pas une. Et si l’envie te vient d’en fabriquer de nouvelles, libre à toi d’imaginer leur forme et leur consistance, mais elles doivent être équilibrées et harmonieuses de façon à ne pas déstabiliser l’ensemble.
La truelle, c’est le stylo. Qu’il soit flambant neuf, doré ou argenté, qu’il soit commun et pratique ou encore vieux et usé, qu’il soit numérique ou libre de courir sur le papier, peu importe. Chaque ouvrier possède son outil. Il ne se prête pas. C’est un contrat à vie. Et si l’envie te vient d’utiliser une antique plume, libre à toi d’être soigneux et appliqué.
Le ciment se compose de deux principes pour lier les briques entre elles afin de leur donner leur équilibre et leur robustesse. La syntaxe et la grammaire. Elles répondent à des lois comme les murs de parpaings sont soumis aux lois élémentaires de la physique. Ne pas faire n’importe quoi sous prétexte d’innovation, d’originalité, car alors, tout l’édifice risque de s’effondrer, du moins de perdre en harmonie et en beauté.
Les invités doivent se sentir bien à l’intérieur de cette construction de mots. Ils peuvent être surpris, déroutés, choqués même, mais leur intérêt ne doit à aucun moment décroître. Ils doivent rire. Ils doivent pleurer. L’émotion est le feu qui brûle dans l’âtre du roman, réchauffant le cœur du lecteur.
L’outil est entre tes mains. Les briques sagement rangées dans l’épais volume. Le mortier bien assimilé. Il ne reste plus qu’à élever les murs.
Comment vient l’inspiration? C’est-ce que nous allons voir sans plus attendre.
Voici le premier maçon.
Une minuscule chambrette située sous les toits parisiens. Le jour n’y entre que par un étroit vasistas, il n’est secondé que d’une faible lampe incapable même de projeter la moindre ombre sur des murs nus et crasseux. Il n’y fait pas chaud. L’homme porte un épais chandail tricoté de grosses mailles. Il garde en permanence un bonnet de laine couvrant ses rares cheveux gras. Des mitaines enferment ses doigts longs et fins comme ceux d’un pianiste de renommée internationale. Peut-être était-il musicien avant de s’enfermer dans ce réduit?
Il griffonne six heures par jour sur des pages qu’il conserve dans une boite à chaussures. La mince fenêtre ne lui est d’aucun secours car il ne travaille que la nuit, parfois bien après minuit, jetant ses derniers mots à l’aube. Dans un coin, gît un petit lit mou et grinçant où il se repose. Il repose son esprit plus que ses membres. Il ne sort presque jamais de cette tanière. Une bouilloire de café fort à réveiller un mort laisse s’échapper une fumée odorante sur un coin du bureau où il noircit page après page des kilomètres de papier.
Cet homme est un vampire, n’évoluant que pendant les ténèbres, à la seule différence que le sang dont il se nourrit exclusivement a des relents de moka et d’arabica. Nulle trace d’alcool comme pourrait le laisser croire cet abandon social, cette indifférence pour les détails domestiques. Peut-être a-t-il eu un problème de boisson dans sa vie passée? Toutes les nuits, il s’épanche feuille après feuille, il transpire de pensées fiévreuses, il dégouline de mots qu’il jette tel un exutoire, il saigne de toutes ses veines. Et ce sang c’est de l’encre.
Tu trouveras le second bâtisseur de phrases, de paragraphes, de chapitres à la terrasse d’un café donnant sur une rue passante ou en embuscade près du bar d’un troquet encombré, carrefour d’une multitude de vies qui se croisent, s’interpellent, se répondent. Sa matière première c’est les autres. Il observe, il discerne. Son stylo est un scalpel qui dissèque l’âme humaine. C’est une loupe qui détaille les plus infimes manies de la foule.
Parfois, on le trouve installé sur une banquette de métro, effectuant d’incessants aller retour d’une station à l’autre. Il arpente les parcs et les jardins, se posant sur le banc le mieux disposé pour observer ses contemporains. Il semble être l’unique spectateur d’une scène jouée par des milliers d’acteurs, sans cesse renouvelée. Le jeu de la vie. Une pièce vieille comme le monde où nous sommes tous les propres acteurs de notre histoire. Lui, il note, il répertorie, il classe pour mieux faire rejaillir nos traits, nos manies, nos envies et nos désirs. Il enregistre tout, rien ne lui échappe. Il est là lors des vernissages huppés, dans la foule hurlante des stades, toujours présent aux heures de pointe. Il peut se glisser dans les cocktails les plus mondains ou les rassemblements les plus pitoyables.
Il est l’œil de son époque.
Celui-ci a fuit la compagnie des hommes. Il marche pendant des heures, seul en forêt ou arpentant les crêtes des montagnes. Ses pas semblent rythmer le débit de ses pensées, les organiser, les ordonner tel un métronome. Au retour de ses longues promenades solitaires, il rapporte une riche matière qui se met aussitôt à crépiter sur son antique machine à écrire. Le cliquetis de la mitrailleuse de mots se répand dans le chalet aux tons chaleureux, véritable nid douillet.
Qu’il pleuve, qu’il vente, que le gel emprisonne la vie sauvage ou que le soleil fasse éclater l’abondance naturelle, il est dehors, avançant sans but ni même d’itinéraire précis. Simplement, il chemine dans ses pensées plus que sur les sentes à peine tracées. Ses pas quotidiens sont remplacés le soir venu par la marche des caractères gras sur la feuille enroulée. Les lettres reprennent le même chemin de son esprit, en sens inverse. Il déroule son parcours sur la feuille.
Cet autre ne se repose jamais. Sa vie, il la vit dans celle des autres. S’il désire écrire une page sur un fleuve, il Le parcourt dans toutes ses longueurs. S’il veut parler d’une tribu africaine, il part vivre deux mois perdu dans un village Sénégalais. Pour relater le quotidien des pêcheurs, il se fait embaucher sur un cargo. Il copie les gestes, apprend leur langage, singe leurs manières. C’est un caméléon. Il traverse déserts et banquises pour parler de la solitude, se noie au milieu des villes les plus abondantes parmi une foule compacte comme un banc de saumons pour évoquer la promiscuité.
Il effectue tous les métiers. Se glisse dans la peau et dans l’âme de chacun de ses futurs personnages. Dort dans des palais ou sous les ponts. Traverse la vie à cent à l’heure ou se laisser aller nonchalamment pendant des jours. Il vit toutes les expériences comme ces comédiens mettant en œuvre le principe de l’actor’s studio.
Un jour alpiniste, le lendemain simple ramasseur de poubelles. Le jour comptable à Wall Street, la nuit truand dans le Queens. Une semaine dans les plantations sud américaines, la suivante rude paysan du Caucase.
Il vit mille vies mais jamais la sienne; il partage le quotidien de milliers de gens mais ce ne sont pas ses amis; il traverse mille lieux mais ce n’est pas chez lui; il accomplit mille emplois mais son métier c’est écrivain.
Lui, parcourt le monde jusque dans ses recoins les moins connus, où pas une âme humaine ne s’aventure à part les ethnologues, seuls représentants de l’espèce humaine capables de se passionner pour une petite tribu du bout du monde dont tous ont oublié l’existence si tant est qu’ils ne l’aient jamais su.
Il pose son sac quelque part où les hommes vivent. Il engage la conversation. Il a ainsi apprit plus de quarante langues différentes, pour le reste il y a les gestes et les sourires.
Il ne demande qu’une chose à ses hôtes: lui raconter une histoire, une légende, un conte. C’est sa seule nourriture. Il a consigné des milliers d’anecdotes, de quoi remplir d’importants volumes qu’il ne publiera jamais. Tous ces récits, histoires vécues ou imaginées, traditionnelles ou récentes, merveilleuses ou réalistes, il les garde pour lui. Il est collectionneur d’histoires. Certaines sont aussi courtes qu’une onomatopée, d’autres plus longues que les Mille et Une Nuits. Il y en a de tristes à pleurer, il y en a de joyeuses, l’une a même provoqué un de ces fou rires qu’on ne peut maîtriser. Elles sont toutes méticuleusement rangées dans un coin de sa tête. Il se les remémore le soir pour aider à s’endormir. Nous ne les connaitrons jamais.
Le dernier de la série, tu le trouveras simplement adossé à un vieux chêne. Après un déjeuner frugal, il vient s’y reposer.
Son visage est détendu. On peut même y entrevoir un léger sourire, Mona Lisa contemporaine. Certains jours il porte un chapeau le protégeant d’un soleil atténué cependant par le feuillage de l’arbre. Un foulard noué autour du cou, une veste de toile légère qu’il plie méticuleusement à ses côtés les jours de forte chaleur.
Il ne manque aucun rendez-vous avec le chêne centenaire. Il aime son écorce rugueuse, les dizaines de bras étendus au dessus de sa tête comme pour le protéger d’un danger venu du ciel, sentant la puissance de sa sève puisée dans le sol fertile. Il sent tout ça. Et s’endort.
Lorsqu’il se réveille, il se souvient de tout. Le moindre détail de son rêve. Toutes les images oniriques sont présentes, vives et claires. Il se lève. Enfile sa veste. Rentre chez lui. S’assoit devant un grand cahier. Décapuchonne le Mont Blanc. Et il écrit.