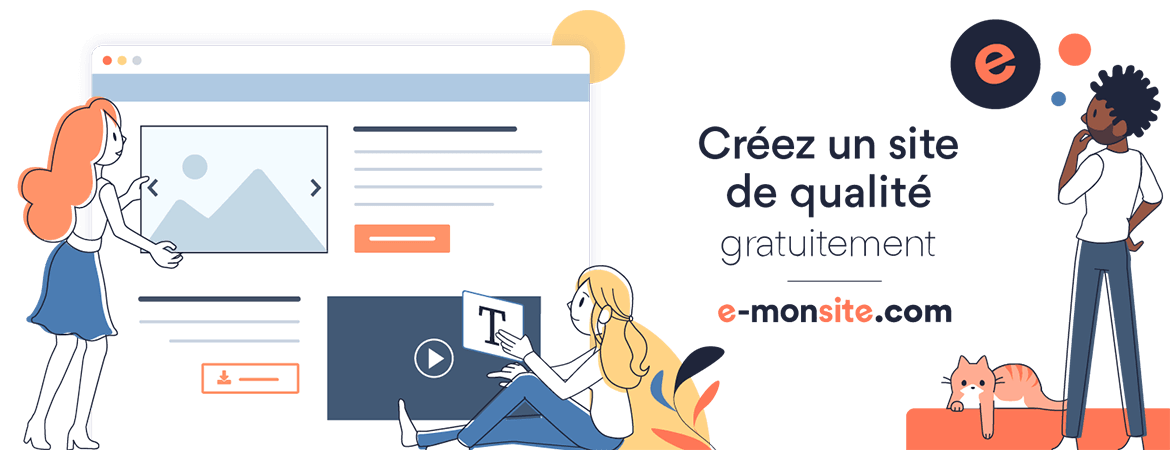Je Pense Donc J'écris 2024
29 décembre - la Meilleure Façon de Marcher
Qu'est-ce qu'une balade réussie ?
Avoir bien respiré, un peu transpiré, vu de belles choses, profité du paysage ? Oui, mais pas que.
Cela commence par savoir s'imprégner de la nature. L'humain est une espèce à part entière depuis au minimum deux millions d'années. Pendant tout ce temps, la seule façon de se déplacer, et par là, de vivre, était de se déplacer à pied. Deux millions d'années avec le même comportement et seulement à peine un siècle de sédentarisation, si l'on excepte une poignée d'aristocrates et autres privilégiés des hautes sphères utilisant le cheval pour couvrir de longues distances.
Ce retour à nos bases est salutaire à plus d'un titre. Toute notre organisation cellulaire est en effet conçue pour utiliser nos jambes – et cela vaut aussi pour l'emploi de nos mains. Notre évolution n'a pas (encore) intégré les transports en commun, l'utilisation de l'informatique et autres robots fidèlement dévoués.
Reconquérir ce pour quoi nous sommes bâtis. Cela peut se faire n'importe où, juste en bas de chez soi, au cœur de la ville. Mais il est un plaisir plus intense d'aller s'immerger là où la trace de l'homme est moins perceptible. Ce n'est pas si facile. Hormis quelques déserts hostiles, les grandes étendues boisées de Pologne ou du Canada, la banquise et le vaste océan, la simple balade du Dimanche ne vous permettra certainement pas de renouer avec la Nature originelle. Tout ce que vous croiserez sera, en grande partie, dû à l'intervention humaine – même ces grandes et belles forêts, là où, il n'y a pas trois siècles, n'étaient que champs et pâturages. Ces dépressions ne sont que les vestiges d'anciennes mines à ciel ouvert, ces terrasses des anciens potagers revenus à l'abandon, ces friches imposées par la reconquête de l'espace par des espèces opportunes – exactement notre démarche de récupération de notre environnement pendant ces quelques heures volées à une civilisation trop normée, trop prévisible.
Retrouver un espace vierge de toute intervention humaine pour mieux y percevoir ce que l'on est soi-même. Effacer le tableau afin de pouvoir y écrire ses propres mots.
Une balade n'est jamais pareille. Même si vous repassez au même endroit une heure plus tard, tout aura presque changé. Pour le remarquer, il faudra éveiller ses sens. C'est ici que le mot immersion va prendre tout son sens. Ne pas se contenter d'observer, mais d'abord écouter. Et pour cela, rien ne vaut de s'arrêter et fermer les yeux. Très vite le paysage sonore va envahir totalement votre être. Vous aller découvrir quantité de détails qui échappent à nos sens, trop perturbés par la seule vision – que l'homme moderne a un peu trop développé au détriment des autres. Cela commence par l'incessant bourdonnement des insectes jusqu'au murmure de la feuille qui tombe. Les effets sonores du vent, ceux de l'eau qui coule.
Mais cela ne se borne pas à l'oreille. Savoir toucher les choses, retrouver un rapport quasiment charnel dans l'étreinte d'un arbre, la caresse de mousses, l'empoignade de rochers. Sentir les cailloux glisser sous ses pieds, la texture du sol, jamais pareille pour peu qu'on abandonne le trop simple goudron – essayez au moins une fois de marcher pieds nus.
Les odeurs se révèlent un feu d'artifice olfactif. Là encore, il sera peut-être utile de fermer les yeux. Les émanations de la résine chauffée en plein été, les effluves du foin fraîchement coupé, les puissants relents de l'humus en décomposition accompagnés de notes de champignon à l'automne, les arômes poivrés ou musqués des plantes.
Enfin, ne pas laisser le goût en reste. Les baies et les fruits sont légion dès la fin du printemps, mais savez-vous que, parmi les six mille espèces de plantes européennes, plus de la moitié sont comestibles ? Mâchonner un brin d'herbe, mordiller un bout d'écorce, picorer les graines ou même suçoter un caillou.
Quand on marche, on fait la moitié du chemin, en cela qu'il faut aller vers les choses et ne pas se contenter de sortir son appareil photo.
Même si l'on se balade seul, on ne l'est jamais tout à fait. Tout autour de nous n'est que vivant : arbres, plantes, animaux et humains ! Contrairement à la pierre stérile des constructions humaines (même si celles-ci sont parfois admirables), la Nature vit, change, se modifie sans cesse.
Cette solitude, le temps d'une échappée naturelle, est une chance de pouvoir se retrouver soi-même. Faire le point, organiser ses pensées, analyser, imaginer, inventer. Quelqu'un a écrit que le continuel geste de la marche possède l'effet d'un métronome qui rythme notre pensée, ordonnant et classant mieux qu'un ordinateur nos réflexions.
Les rencontres, inévitables (à moins de partir loin ou se perdre dans quelque sentier abandonné), vont se révéler bénéfiques au-delà de toute imagination.
Chaque être humain est unique. Même si nous nous ressemblons tous, nos cerveaux sont différents – bien que la société mette toute son énergie à nous conditionner comme des troupeaux plus facilement orientables. La ville, les habitudes et les conventions annulent cette différence. On se conforme à l'esprit général, à commencer par ce verni qui permet de vivre ensemble : la politesse. Bien sûr, on ne redevient pas un homme des cavernes dès que l'on franchit les limites de l'urbanisation, mais les échanges sont plus intenses, plus vrais – si l'on dépasse les simples considérations météorologiques, prétexte obligé à de plus amples conversations.
Pourquoi remarque-t-on que les gens sont plus intéressants en vacances ou au détour d'un chemin qu'en centre ville ? Ils le sont tout autant dans leur vie quotidienne, mais pressés par leurs habitudes, emprisonnés dans leurs horaires et leurs soucis, stressés par cette vie moderne trop rapide, ils ne le montrent pas. Une belle rencontre est aussi l'affaire d'une meilleure écoute, plus attentive. Savoir s'oublier pour découvrir les trésors que l'autre a à nous offrir.
Faire ce pas de côté en allant retrouver les sentiers permet de se débarrasser de nos carapaces urbaines qui font de nous des automates. Des numéros à la place d'êtres humains.
22 décembre : Performance et esthétique du sport
Il existe une ambivalence au sein du sport.
D'une part, c'est un fabuleux moyen d'expression corporelle, spécialement dans nos sociétés sédentaires, où tout exercice physique a été banni de notre quotidien.
D'une manière générale, il véhicule également des valeurs de partage, d'entraide et de dépassement de soi. Ainsi, il entretient une santé physique et morale, particulièrement dans les sports collectifs. Une certaine idée d'intégration et d'émulation. C'est à la fois un formidable levier de réalisation pour les plus jeunes à un âge où l'on se cherche, où l'on ne comprend plus ce corps qui change trop vite à la puberté. Il permet également d'effacer certaines barrières sociales, de faciliter une intégration dans le groupe. Par moments il fait œuvre d'ascenseur social au même titre qu'un diplôme – on constate cela notamment sur les campus aux Etats Unis, où sport et études y sont intimement mêlés. C'est aussi une manière de garder un corps actif et ferme, passé un certain âge – de garder des relations, une fois sa vie professionnelle mise au rencart (retraite, chômage).
Le sport véhicule ces valeurs d'entraide, de communion vers un objectif commun.
Cependant, le sport d'affrontement (matchs) nourrit surtout la recherche de la victoire. Et cela implique forcément un vainqueur et un vaincu. On apprend plus de ses défaites, certes, mais il faut déjà posséder une force morale pour intégrer cette dimension. Du reste, cette volonté de dominer s'augmente souvent de relents chauvinistes, d'esprit de groupe, de communauté. Tous égaux certes, mais face à l'adversaire, jugé un brin moins égal.
Les sports individuels, où l'affrontement n'existe pas (gymnastique, athlétisme, natation) mettent aussi en jeu cette volonté de performance à tout prix. Cela s'est répandu dès lors que l'on a commencé à mesurer les prouesse dans le stade, allant de concert avec les avancées scientifiques du XIXème siècle. Le chronomètre pousse à l'établissement d'un surhomme Nietzschéen. On constate cette dérive dans le sport de compétition où tous les moyens sont bons pour parvenir à ses fins, au résultat suprême, y compris le dopage (médical, mais, plus sournoisement, dans la capacité matérielle, donc financière, de mettre tous les atouts de son côté – exemple : les équipes de football qui recrutent les meilleurs joueurs).
Cette dérive de la compétition est à l'image de nos sociétés capitalistes et libérales. On retrouve cette même ambivalence dans ses fondements : possibilité de réussite égale à tous et toutes à priori (les hommes naissent libres et égaux en droits) mais lutte sans merci pour la victoire, dans laquelle les plus faibles sont vite écartés. Ainsi, sous la grande idée de rassembler, de mutualiser au sein d'une équipe, sous le principe émulant de la performance, du dépassement de soi, on atteint très vite une sorte d'élitisme : les Dieux du stade.
Cette course aux rivalités s'additionne d'une surenchère de moyens financiers depuis l'introduction de sponsors dans le monde du sport. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si les banques sont majoritairement des soutiens du sport de haut niveau. A un certain stade (sans jeu de mots), le sport devient la plus offensive des entreprises en s'attribuant un vocabulaire guerrier qui ne trompe personne.
Cette volonté de s'identifier aux héros du stade permet au sport de compétition d'engranger des bénéfices inimaginables, à l'image de la société qui l'a supporté depuis bientôt 200 ans (l'invention du sacro-saint football, du moins l'ébauche de ses règles, date de 1848 en Angleterre) : tout le monde rêve de devenir un champion et/ou gagner beaucoup d'argent. La réussite comme carotte. Le libéralisme doit beaucoup à son plus fervent support.
Pourtant une autre voie est possible, envisageable. Il suffit de changer de paradigme. De rechercher, par exemple, le beau geste, une certaine idée de l'esthétisme dans les mouvements du sportif, au détriment de la sacro-sainte performance ultime. Cet esthétisme, souvent réservé aux femmes, peut et doit être une chance pour la beauté du sport. Ne plus chercher la victoire à tout prix, ni tenter de battre des records qui risque, bientôt, de n'être plus accessibles lorsqu'on en aura atteint les limites physiques, mais plutôt proposer la beauté de corps en action. Et garder le suspens du résultat lors de rencontres en égalisant les chances de chacun : il n'est pas normal qu'un club de football domine éhontément un championnat ou qu'une équipe cycliste écrase une épreuve. Rouler à 30 km/h plutôt qu' 50 ne modifie pas l'incertitude du résultat, proposer un match comme un ballet ne fait qu'ajouter à la fragilité du dénouement.
15 décembre - Une récompense bien méritée
L'humain est un hédoniste né. Son but est la rechercher du plaisir. Nous sommes tous biologiquement programmés pour jouir. Notre troisième besoin essentiel, la procréation, est essentiellement motivée par ce feu d'artifice des sens.
Tout effort mérite récompense. Nous ne consentons à la souffrance qu'en espérant un profit en retour. Mais cette récompense, de quelle nature est-elle ?
Ne dit-on pas que « tout travail mérite salaire ? »
Toutefois, une rémunération monnayée n'est pas la plus gratifiante. Il y a plus élevé. La satisfaction de s'accomplir dans ses actes, de se dépasser, de repousser nos limites et, au final, obtenir une reconnaissance collective. Recevoir les honneurs de ses pairs. Etre reconnu, respecté, admiré, glorifié peut-être ?
En inventant le travail collectif, l'entreprise, lors de la Révolution Industrielle, a rabaissé ce niveau primordial de récompense à un simple échange monnayé. Du temps et du savoir-faire, de l'implication, du don de soi, une certaine allégeance (le fameux « esprit » d'entreprise) contre une simple enveloppe, un chèque à la fin du mois. Cela est très réducteur. Cela renvoie l'ouvrier, l'employé à une marchandise qu'on loue, qu'on achète. Il n'existe plus en tant qu'humain, mais devient une machine. Il n'en faut pas davantage pour faire perdre toute motivation sincère, toute implication honnête dans son activité. Dès lors que l'on reçoit un salaire, on compte ses heures, on monnaye son labeur. On calcule. Au détriment de son emploi. Au détriment de son propre accomplissement.
C'est ce que l'on appelle l'effet de surjustification : être payé pour effectuer quelque chose que l'on aime tend à démotiver la personne. La motivation intrinsèque, donc sans autre but que se réaliser soi-même (ou peut-être encore donner du bien-être aux autres, comme par exemple lors des élans d'aide constatés lors de catastrophes) est remplacée par un échange monnayé – ce qui la rapproche d'un travail banal, imposé et peu impliquant. La récompense, à plus forte raison un salaire, déplace notre motivation : nous ne travaillons plus par amour de ce travail, mais pour les résultats qu'il peut nous faire obtenir.
L'idéal serait donc une société où chacun aurait une activité tournée vers les autres (cela ne change en rien le principe de nos sociétés actuelles : chacun oeuvrant pour son prochain) sans aucune contrepartie directe. Puisque tout le monde continuerait à travailler pour tous les autres, les choses deviendraient ainsi gratuites et la motivation pure resterait intacte.
Intelligence & méchanceté (8 dec)
Mais pourquoi donc l'humain est-il si teigneux ?
Il n'y a pas d'autre exemple dans la nature où une espèce s'entretue avec autant de conviction et d'acharnement. Aucun camp d'extermination, aucun génocide ailleurs que chez Homo Sapiens et même, lorsqu'une espèce en chasse une autre, c'est dans le seul et unique but de la dévorer pour se nourrir. Quant à se zigouiller au sein de la même espèce, s'il existe des combats pour une place dans la hiérarchie de la meute, ceux-ci stoppent à la première goutte de sang – ça ne va jamais très loin.
Jacques Monod donne une piste dans son célèbre « hasard et nécessité » paru en 1970 et pourtant encore d'actualité, malgré les avancées de la biologie qui peuvent rendre certains passages un peu obsolètes.
Il nous fait remarquer que l'adversaire, l'ennemi de l'humain n'est plus la nature, puisqu'il est parvenu à la dominer, la gérer, la soumettre à son bon vouloir. Privé d'un antagoniste majeur, il a dû reporter toute l'agressivité dont il est porteur dans ses gênes sur ses semblables. Triste constat et pourtant le seul qui pourrait expliquer que nous soyons encore, malgré l'extraordinaire avancée de la science, des idées, d'un certain idéal de vie, à nous exterminer pour des babioles.
Pourtant, il ne manque pas d'ennemis à l'être humain, comme à toutes les espèces, hormis celle de lutter pour sa survie face à son milieu.
La mort constitue un vrai challenge : la combattre par toutes les armes dont nous disposons pourrait être un idéal moins dévastateur que prendre un fusil ou lâcher une bombe sur son voisin. C'est le constat d'Amin Maalouf dans son roman « nos frères inattendus ». Mais il y a un autre challenge, à mon avis plus pertinent que la mort elle-même puisque, de toute manière et quoi qu'il arrive, elle fait partie de la vie, inéluctable. C'est combattre par tous les moyens le seul, le vrai, l'indécrottable ennemi de l'humain : la misère, et son alter-ego, la maladie.
Du reste, même avant de reporter toute notre agressivité contre nos semblables, il n'est pas certain que prendre la nature comme cible était bien futé. Si on y regarde attentivement, notre environnement n'est pas forcément hostile. Il serait même plutôt accueillant, nous dispensant nourriture et médicaments. Que sont quelques sporadiques catastrophes (sécheresse, incendies, inondations, tempêtes) très localisées en regard de toutes les richesses que nous a apporté et apporte encore la planète, malgré tout ce que nous lui faisons subir. Elle n'est pas rancunière, elle.
Mais creusons un peu cette idée de Monod qui consiste à prétendre que, lorsqu'une fois avoir dominé notre environnement, il nous faut un nouvel adversaire à notre taille et qu'il ne reste plus, à ce moment là, que nous mêmes. Les animaux les plus féroces ne sont-ils pas les plus évolués dans l'échelle de la soi-disant intelligence ? Les meutes, fonctionnant sur une hiérarchie bien définie (loups, gorilles) sont le fait d'animaux au cerveau déjà bien développé par rapport à ces sociétés d'insectes, par exemple, auxquelles il ne viendrait pas à l'idée de s'entre-tuer mais plutôt de collaborer vers un projet communautaire. Il en découle alors une loi fondamentale : plus un organisme est développé, plus son cerveau prend de l'ampleur, plus la part culturelle (l'éducation) prend d'importance par rapport à l'inné, plus cette espèce devient dangereuse pour les autres et pour elle-même en définitive.
Ainsi, ce serait notre intellect trop développé qui serait responsable de notre si terrible menace envers nous-mêmes. L'intelligence, plus exactement un hypertrophie du cerveau, irait de concert avec une cruauté démesurée. Plus on devient intelligent, plus on devient méchant.
Confort & bien-être (1er décembre)
Depuis que la technologie et son cortège de machines et robots nous simplifient la vie en nous offrant le sacro-saint confort tant rêvé, nous avons tendance à confondre ces deux notions pourtant bien différentes : le confort et le bien-être.
Si cette aisance quotidienne ne s'applique qu'aux choses, donc résolument matérielle, le bien-être demeure quelque chose de plus profond, de plus personnel. Un peu comme la nuance entre la joie et le bonheur.
Le confort engourdit, le bien-être apaise.
Le confort supprime la fatigue, le bien-être lui donne ses lettres de noblesse.
Le confort supprime les pensées, le bien-être permet leur expression.
A trop vouloir annuler le moindre effort (musculaire ou, pire, intellectuel), nous devenons des ectoplasmes, incapables de nous débrouiller sans une armée de gadgets autour de nous. Ces machines censées nous simplifier la vie nous rendent prisonniers de nouveaux comportements. La voiture, la télévision, le téléphone mobile sont des faux amis, des béquilles qui se transforment assez rapidement en déambulateurs. Lorsque le superflu devient indispensable, il convient de s'alarmer. Ici, je parle de l'inutile matériel, pas de ce superflu lié à l'art qui parle à l'âme et devient ainsi une nourriture aussi importante pour notre équilibre psychique que les aliments ne le sont pour notre intégrité physique.
En réalité, ce ne sont pas les machines qui sont en cause, mais cette utilisation débridée que nous en faisons. La voiture est un moyen de locomotion extraordinaire, à condition qu'elle reste à sa place. La télévision pourrait être un objet de divertissement, d'information et de pédagogie formidable, à condition de ne pas se laisser immerger par ses programmes, ne pas rester avachi devant ce que d'autres nous dictent dans le seul but de nous vendre des marchandises, d'autres gadgets inutiles.
Enfin le téléphone mobile ne devrait rester qu'un gadget, bien utile dans certaines circonstances, en rien une manie qui frise l'addiction.
Le bien-être ne peut survenir de ces aides purement matérielles. C'est un concept qui se construit, dont nous sommes les premiers acteurs et réalisateurs. La santé physique est en grande partie de notre responsabilité. Une hygiène de vie, tant au niveau de la nourriture avalée, du sommeil, de notre activité. Mais surtout, le bien-être est le résultat d'une certaine éthique, d'un sens que l'on donne ou pas à sa vie. Recevoir mais surtout offrir aux autres. Notre temps, nos convictions, notre écoute. Nous sentir utiles.
le besoin et l'envie (24 nov)
Nous sommes tous conscients que nos vies nous échappent, que nous ne maîtrisons plus notre quotidien, que nous sommes influençables et conditionnés d'une certaine façon.
Etre libre, c'est être seul.
Mais être libre, c'est aussi ne plus éprouver de désir, du moins, savoir le maîtriser.
Ce fut de tout temps la volonté des moines de s'affranchir de leurs envies les plus profondes, les plus enracinées. Se rendre maître de ses sens. Cela commence, bien évidemment, par le désir de l'autre. Pas uniquement sexuel. Nous sommes tous des animaux sociaux, nous avons besoin des autres pour vivre depuis que nous avons abandonné notre condition de chasseur-cueilleur et même alors, il n'était pas question de tout faire soi-même. Nous avons surtout besoin de relations, plus ou moins impliquées. Le sentiment amoureux en serait l'idéal, le plus complet, le plus abouti, le plus fort. Mais également, comme toute médaille possède son revers, le plus impliquant et donc le plus dévastateur, psychologiquement. Il existe une grande différence entre aimer et tomber amoureux. Déjà dans les termes : l'un est de forme active, l'autre passive. De surcroît, tomber indique bien que l'on est à terre, dominé par ses sens, totalement sous l'emprise, au mieux de nos sentiments, au pire du bon vouloir de l'autre. S'il affiche de mauvaises intentions, il y a même danger.
Le désir des sens est la recherche du plaisir. Intense, immédiat. Seule la jouissance va en amoindrir l'ardeur. Ainsi, tout comme la soif, pour l'étancher il faut l'assouvir. C'est raisonner un peu vite, car, au contraire, sa satisfaction risque bien d'en augmenter l'exaltation prochaine. Cela court également pour n'importe quelle chose à laquelle on tient : satisfaire ses envies peut nous détruire car, dès lors, nous ne sommes plus maîtres de nous mêmes. La consommation à outrance, le consumérisme exacerbé, nous pousse à nous reposer sur nos désirs.
Pire : on constate que les partis extrêmes ne jouent pas sur la raison, mais sur les sentiments. Leur programme s'adresse au cœur, parfois aux tripes, jamais au cerveau.
Opposer le cœur à l'esprit, la passion à la raison n'est que déplacer le problème. On ne résout rien en l'affrontant. Mieux vaut tenter un savant dosage. Il n'est, évidemment, pas question de devenir une pierre sans ressenti, se blinder le cœur et l'esprit pour préserver notre âme. Laissons cela aux ermites de tout poil. Nous devons nous impliquer, nous imbriquer dans la société des autres. Tout l'art de (bien) vivre est de trouver cet équilibre de funambule qui consiste à savoir gérer ses désirs. Mais, à ce moment là, le sont-ils encore?
17 novembre - La moitié du chemin
La force de la lecture sur tout autre divertissement, c'est que tout n'est pas acquis. Lire, c'est faire la moitié du chemin. L'auteur a fait sa part en inventant, le lecteur doit assumer l'autre part en traduisant, en interprétant selon son propre barème lié à son expérience, ses goûts, ses envies. Il est le réalisateur de son propre film, parfois très éloigné de ce que souhaitait l'auteur. Tant pis ou tant mieux. Cet effort est le prix à payer pour vraiment jouir de l'histoire. Se l'approprier. La réécrire. Rien n'est prémâché comme pour un film : il ne reste plus au spectateur que sa propre interprétation - et encore, on lui tient souvent la main.
La vie devrait toujours se dérouler de cette manière.
Pour se nourrir, par exemple : on peut aller au restaurant, acheter des plats surgelés tout prêts. Ou encore cuisiner soi-même. Mieux : cultiver son propre potager. Faire la moitié du chemin, voire un peu plus. Cette responsabilité induit davantage d'effort, demande plus de temps, mais permet de reprendre le contrôle de son existence. Une part de liberté.
Déguster un repas réalisé par ses soins n'est sûrement pas meilleur au goût qu'un menu du restaurant, mais il l'est bien davantage psychiquement.
Apprendre, c'est tout pareil.
Autrefois, le maître faisait tout le travail : il apportait, dans son cours magistral qui ne souffrait d'aucune remarque, le savoir à des petites têtes censées avoir tout à apprendre. Formidable machine à déresponsabiliser qui ne tenait uniquement par le système sociétal d'alors : école, puis service militaire où l'on nous considérait comme des « bleus », ne sachant rien faire, puis l'entreprise (bureau, usine), la plupart du temps familiale, voire paternaliste, dans laquelle on restait toute sa vie. Pas besoin de prendre de décision, on choisissait pour nous.
Au sein même de la famille, tout était codifié. Chacun avait son rôle de mère ou de père à suivre selon les pointillés. On éduquait en reproduisant simplement les exemples que nous avions eus dans notre enfance, entouré le plus souvent d'une fratrie importante.
Le libéralisme a tout balayé en moins de 50 ans et cela explique un peu le désarroi dans lequel certains se trouvent. Des gamins jetés au beau milieu de la cour, ne sachant plus faire leur fameuse « moitié de chemin ». Désorientés, égarés, perdus.
S'il a tout balayé, le libéralisme a quand même conservé cette manie de tout régenter au niveau même du travail : répéter des gestes prévus, ne pas réfléchir, devenir des automates, des machines qui conduisent des machines.
Pour en sortir, il faudrait renouer avec cette responsabilité dans le travail qui en fait un métier et non plus un simple boulot. Une activité, une vocation que l'on choisit, que l'on maîtrise, du moins pour une partie. La satisfaction du travail bien fait, d'avoir laissé quelque chose de soi dans sa réalisation, même si cela n'est pas si parfait. Faire la moitié du chemin permet de s'améliorer, de se dépasser. De donner du sens à sa vie. Plutôt que suivre bêtement les jalons posés par d'autres.
Un bon prof n'est pas celui qui sait tout, mais qui va inciter ses élèves à vouloir apprendre, à s'intéresser à d'autres choses que le foot pour les garçons et la danse pour les filles. L'envie d'apprendre, c'est essentiel. Cela vous accompagne toute votre vie. Une certaine curiosité. Une remise en question. Des doutes. Ne pas se croire invincible. Aller vers l'autre. Echanger. Donner sans espérer recevoir en retour, mais recevoir tout de même, finalement. Le moindre échange est bénéfique pour les deux parties, même si ce n'est qu'un bonjour et quelques considérations météorologiques.
10 novembre - Porosité
En physique quantique, une particule élémentaire peut changer de statut, de niveau d'énergie pour être précis, lorsqu'on la regarde simplement. En effet, observer quelque chose est un échange d'informations, donc d'énergie. Ce troublant constat se vérifie chaque jour dans nos propres relations inter-humaines.
Nous influençons et sommes influencés par les autres. Un seul regard peut changer votre vie.
L'environnement, le paysage, l'endroit où l'on vit, modifie en profondeur notre psyché sans que l'on ne s'en aperçoive. Nous somme poreux. C'est peut-être ça, le sixième sens.
La météo, l'effet des rayons solaires, la pluie, le froid, le chaud, le vent. Tout n'est qu'interactions sans fin. Nous sommes le résultat de la combinaison des gênes parentaux pour ce qui est de notre charpente, notre biologie intime. Nous sommes modelés par notre éducation, notre culture en ce qui concerne notre intellect. Nos choix, nos comportements sont influencés par ce qui nous a été appris, toutes les expériences de vie que nous avons menés – voulues ou subies.
Mais, par dessus tout, ces milliards d'interactions avec les objets et les gens nous changent à chaque seconde. Tout comme notre corps n'est plus tout à fait identique à ce qu'il était il y a une demi seconde, notre mental a aussi évolué le temps de lire cette ligne. Ces mots vous ont chamboulé, plus ou moins.
3 novembre - Conflit mondial
Ca y est ! L'Amérique en a reprit pour quatre ans supplémentaires. Comme si l'électeur de base refusait d'élire une femme à la Maison Blanche, colorée de surcroît (à la différence d'Hillary, déjà ratatinée par le même peroxydé il y a huit ans). Plus étonnant encore : une majorité d'électeurs censés ont voté pour Trump en pensant qu'il n'appliquerait pas son programme. Bref, ils ont (encore) mal voté : davantage contre que pour, comme s'ils étaient désabusés par la politique.
Alors, bien sûr, on s'interroge, on suppute, on se méfie, on craint pour l'avenir.
Premier constat : Donald entend bien reprendre la discussion avec Vladimir. Ben voyons : entre fous furieux, on se comprend. Donc, à priori et à priori seulement, pas l'ombre d'un troisième conflit mondial à l'horizon. Toutefois, il convient de rester prudent. Confier l'arme atomique, certainement la plus puissante au monde, entre les doigts d'un partisan de la Grandeur de son pays et de l'usage des armes à feu pour tout bon américain qui se respecte (entendons : blanc et catho) est un pari risqué.
Homo Sapiens est une teigne, ça on le sait depuis qu'il est parvenu à éradiquer toutes les autres espèces humaines et, accessoirement, bon nombre des autres au nom d'un sacro-saint développement de sa propre communauté.
A l'origine, taper sur son voisin relevait davantage du sport, une façon de se mesurer, de tester sa force, de faire jouer ses muscles. Une compétition qui faisait des dégâts, mais mesurés, étant donné la faiblesse des armes utilisées (poings, puis flèches, massues, armes blanches).
Puis ce fut une façon simple d'étendre son territoire, de le développer en vertu du premier principe que Homo Sapiens doit absolument croître et se multiplier. Les grandes invasions, les armées grecques puis romaines : tout cela relevait du même modèle de gagner quelques mètres carrés au prix de la vie humaine, si possible celle des mécréants, adorant d'autres Dieux, éructant un autre idiome et n'ayant pas la bonne couleur de peau.
A l'époque féodale, on retrouve le côté ludique des combats ancestraux. L'influence politique se jouait bien plus avantageusement dans les alliances, les mariages arrangés entre princes et princesses, rois et reines que dans un conflit ouvertement déclaré. Les seigneurs pratiquaient cette joute royale de lancer leurs soldats dans la mêlée, comme on entame une partie d'échecs. Les généraux, bien au chaud dans leur quartier général, décidaient d'une stratégie, appliquaient une tactique à laquelle les simples fantassins, sur le terrain, devaient aveuglément obéir. Ils déplaçaient des petites drapeaux sur une grande carte dépliée sur une vaste table et se congratulaient d'avancées décisives, de replis stratégiques. On parlait alors de grandeur militaire, du génie du combat et autres billevesées du même acabit.
Cette façon d'occire son voisin a perduré pendant quelques siècles pour venir aboutir au premier conflit mondial qu'on espérait être le dernier. On était allé au bout de la stupidité militaire : déclenchement du conflit sur un simple prétexte, guerre de position, acharnement pour quelques hectomètres gagnés puis perdus, puis regagnés... Zéro à zéro, balle au centre.
Avec la folie du nazisme, on a atteint une nouvelle étape. Cette fois, le conflit se doublait d'épuration ethnique. Mais ce n'était nullement la fin. Les soviétiques appliquèrent l'épuration politique dans les goulags, doublant le nombre de déportés. Puis les affrontements se radicalisèrent en guerres civiles (Europe centrale, Asie, Afrique, Amérique du Sud).
La violence remplace la parole quand celle-ci ne suffit plus, qu'elle devient inopérante, que l'on a l'impression de parler à un mur.
Sur le sol Français, en 75 ans, de 1870 à 1945 : trois guerres. Depuis 80 ans : plus rien.
Plus rien ? Pas si sûr. Les esprits retords auront vite fait de constater qu'une autre guerre, plus insidieuse, plus souterraine, est à l'oeuvre. La guerre économique. Le libéralisme est une compétition poussée à l'extrême. Si ses dégâts ne sont que collatéraux, ils sont bien réels. Sa force est de pouvoir s'adapter à n'importe quelle situation, la retourner à son avantage, même lorsqu'elle lui est apparemment défavorable.
C'est aussi un fabuleux garde-fou. Ainsi, le paradigme libéral ne peut s'encombrer d'un conflit armé... sauf s'il a lieu au loin et qu'il permet d'écouler des armes, marché fabuleux. Ce fameux marché ne fonctionne que grâce aux consommateurs. C'est à dire : nous. Une bonne guerre comme autrefois réduit, empêche la consommation. Ce n'est pas bon pour le libéralisme qui entretient un leurre : faire travailler les mêmes gens qui achètent. Ainsi il triomphe sur les deux tableaux : gagner de l'argent par le travail des masses et récupérer ses offrandes (salaires de misère) par une consommation effrénée.
Dès lors, le système ne supporte pas ce désordre que représente un conflit déclaré au sein même des pays prospères. L'exemple de l'Ukraine est atypique à ce point de vue. C'est un pays sensiblement identique à nos sociétés occidentales, le grenier de l'Europe et pas si loin que ça de nos confortables capitales. Rien que pour ça, restons vigilants.
Utilisons nos mains (27 octobre)
D'une façon générale, pour être libre et s'affranchir de cette mélancolie qui nous pourrit la vie, il est bon de reprendre le contrôle. Vous-êtes vous déjà demandé de combien de personnes votre vie dépend ?
On délègue sans arrêt, à longueur de journée. Cela a entraîné une affreuse spécialisation qui aboutit à devoir entreprendre de longues études et/ou des formations à l'en plus finir pour simplement changer une ampoule. Sans parler des stages de remise à niveau, égrenés tout au long de notre vie professionnelle.
Pour commencer, et afin d'économiser sur votre budget et manger mieux, plus sain et se mettre au vert : jardiner.
Ca n'a l'air de rien comme ça, mais dix mètres carrés de plates-bandes font un bien fou. D'abord, occuper ses mains. Répéter un même mouvement, lorsqu'il est salutaire et qu'il sert à quelque chose, lubère paradoxalement l'esprit : il n'en va pas autrement de la marche.
Autre façon d'éviter de devenir un robot : écrire au stylo plutôt qu'au clavier. La forme de chaque lettre est différente, alors qu'appuyer sur une touche est d'un ennui mortel.
Quelqu'un a dit « mieux vaut faire soi-même quelque chose de raté qu'acheter quelque chose de réussi ».
Gandhi incitait à fabriquer soi-même ses vêtements, afin d'échapper au diktat général qui nous assouvit. Ressortons nos vieilles quenouilles ! La satisfaction de produire quelque chose, d'être actif, offre un sentiment de plénitude : on se sent utile. Apporter notre savoir-faire aux autres est une jouissance que l'on ne peut éprouver quand quelqu'un nous aide – même si parfois nous en avons besoin. Oui : offrir est plus gratifiant que recevoir.
La liberté n'est pas synonyme de confort. Elle va de pair avec une responsabilité retrouvée et cela ne se fait pas sans mal. Mais quel soulagement de ne plus dépendre entièrement des autres.
Ni des machines. Il existe une différence fondamentale entre une machine, un vulgaire robot, qui se substitue à vos capacités et un outil qui en permet l'exécution. Rester maître de nos vies implique donc de savoir se servir d'outils et d'éviter les machines.
La société moderne est riche en béquilles qui, sous le prétexte louable de nous simplifier la vie, nous la rende impossible. Le plus édifiant exemple reste la voiture. Un outil, lorsqu'elle permet de transporter des personnes ou des objets sur de longues distances, mais une machine stupide dont nous sommes devenus bêtement les esclaves. Combien de temps perdu dans les embouteillages ? J'ai également remarqué que cette boite de ferraille bourrée désormais d'électronique (demain, d'intelligence artificielle?) nous rend cons et... méchants. Il n'a qu'à observer le comportement de gens, parfaitement civilisés en temps normal, qui se transforment en imbuvables mister Hyde dès qu'ils possèdent un volant entre les mains... à commencer par moi-même !
A force d'être entouré de machines, nous devenons nous-mêmes des robots. A commencer par le travail. Qu'il soit exécuté en atelier, en usine ou dans un bureau, la division du travail, inventée lors de la Révolution industrielle, permettant la spécialisation, offre par la même occasion une multitude de tâches répétitives et ennuyeuses.
Il existe deux façons de faire les choses : soit tout contrôler de A à Z, soit morceler chaque étape, la rendant insipide et privant ainsi l'exécutant d'une vision globale tout en effectuant les mêmes gestes à longueur de journée.
Exemple, celui du boulanger. Il peut fabriquer du pain de plusieurs manières. La façon industrielle se résume à déballer une pâte déjà préparée, parfois congelée, l'enfourner et, mieux encore, disposer les pains cuits dans un distributeur 24 heures sur 24. Il s'active, seul dans son coin sans aucune relation, à répéter inlassablement des gestes qui n'ont aucun sens. Maintenant, on peut imaginer un boulanger éclectique dans ses gestes et dans son appréciation de son métier. Il commence par sélectionner les meilleures graines de blé. Puis retourne un arpent de terre. Sème les graines. Attend la maturation des épis. Les moud pour en obtenir la farine. Pétrit puis façonne différents pains de forme, peut-être en consistance s'il a aussi planté du seigle ou d'autres céréales. Enfin le propose aux clients sur la place d'un marché ou, mieux, concocte des recettes de tartines dans un petit restaurant. Il aura été ainsi, tour à tour : grainetier, laboureur, paysan, meunier, boulanger et restaurateur. De quoi emplir une vie sans jamais faire la même chose.
Ceci est un exemple radical.
Nous pouvons toutefois, chaque jour, reprendre le contrôle. Moins déléguer. Bien entendu, il n'est pas question de vivre en ermite, en autarcie complète, coupé des autres, dans une solitude glacée. Nous avons besoin des autres et ils ont besoin de nous. Cela donne du sens à la vie qui, fondamentalement, n'est pourvue que d'un seul : se reproduire pour perpétuer l'espèce.
Voir les rois et les princes de faire habiller m'a toujours fait rire : Louis XIV m'apparaît alors comme un grabataire et Marie Antoinette une infirme.
Quels chichis ! Et pourtant nous n'en sommes pas si loin. Passer ses journées à un travail qui ne nous plaît pas afin de gagner l'argent que l'on donne à la nounou qui garde nos enfants, on frise le n'importe quoi. Parlant d'enfants, pourquoi les assommer d'activités en pagaille comme s'il était obligatoire de « faire » des choses. Laissez-les vivre ! Leur essence, c'est le jeu – que nous oublions une fois devenus adulte et c'est un tort. Mais, à la place de consoles abrutissantes et hors de prix, fabriquées dans des conditions limites au bout du monde et utilisant des matériaux rares et difficilement recyclables, pourquoi ne pas les laisser inventer leurs jeux, comme n'importe quel enfant l'a toujours fait. Une ficelle et un bout de tissu, une vieille boite ou un carton et l'imagination fait le reste : l'enfant (re)devient le patron de ses activités. Il en tire une satisfaction et un plaisir que nul robot made in Taïwan ne pourra jamais égaler. Nous aussi nous devons nous réapproprier notre quotidien, nos vies.
Tant que le monde continuera de ne plus s'impliquer dans sa vie quotidienne, de déléguer, réduisant une partie de ses habitants en quasi esclavage, tout ira de travers.
Une histoire de prêt (20 octobre)
Tom Hodgkinson est un journaliste anglais qui se définit lui-même comme un bourgeois-bohème.
Je ne peux que vous encourager à lire ses écrits, en particulier l'éloge de la liberté.
Au fil des chapitres, il pointe du doigt tout ce qui ne va pas dans notre monde qui, il faut bien le dire, marche parfois sur la tête.
Ses réflexions sur le travail semblent être le copier/coller des miennes et j'y reviendrai. Mais commençons par le nerf de la guerre : l'argent.
Coluche avait brocardé Freud en le paraphrasant, annonçant que le monde avait deux problèmes : le sexe et l'argent. « Comme tout le monde a un cul, j'vais m'occuper du fric ». Tout le monde est plié en deux.
Seulement voilà, si la sexualité explique la moitié des problèmes intimes et/ou relationnels, l'argent illustre quasiment tout ce qui foire dans le monde.
Tout part du développement des banques, lié au commerce à la fin du moyen-âge et annonçant la révolution industrielle, l'invention du travail, soit la division du labeur dans de vastes manufactures pour filer vers la marche inéluctable du grand capitalisme (l'asservissement de l'homme par l'homme).
Dès lors qu'un gaillard a eu l'idée de prêter de l'argent en demandant des intérêts, cela a mal tourné.
Avant, les prêts existaient. Seulement, cela restait à une échelle locale, humaine. Quelqu'un a besoin d'argent, un autre en a : il lui prête et se fait rembourser plus tard. Cela continue d'exister, Dieu merci, entre (bons) potes.
Le problème avec l'usure (cette façon de gagner de l'argent sur l'argent), c'est qu'on achète le temps. Un intérêt se paie sur une durée déterminée. Or, jusqu'à preuve du contraire, le temps n'est à personne, puisqu'il est à tout le monde.
Prenons un exemple.
Au cours de sa vie, un honnête travailleur, payé dignement sur son activité, amassera autour de 600 000 euros (un bon smic offre grosso modo 14 000 euros par an). Son niveau de vie, sans excès, s'il a des enfants et parvient à investir dans une modeste demeure, se payant quelques jours de vacances annuelles, une sortie au restaurant de temps en temps, une jolie petite berline et quelques sorties ciné, lui permettra tout juste d'avoir à peine un an de salaire de côté lorsque viendra la retraite tant désirée, soit moins de 20 000 euros sur son modeste livret d'épargne.
Maintenant, imaginons que le même travailleur touche le pactole de toute une vie de travail lors de son embauche. Un véritable contrat : 600 000 euros tout de suite, mais l'obligation de s'engager pour 42 ans de dur labeur au sein de l'entreprise si généreuse...
Sur les 600 000, le toujours honnête travailleur va en placer 500 000 dans une institution bancaire. Cela lui laisse un joli petit pactole pour débuter dans la vie : tout le monde n'en a pas autant.
Il va donc devenir, sans y penser réellement, un usurier, puisque son argent sera prêté à d'autres, moins chanceux. 500 000 euros, c'est une somme suffisamment rondelette pour espérer un rendement à 4% sans prendre de gros risques boursiers. Soit une rente de 20 000 euros annuels. 20 000 euros. Soit 6 000 de plus que s'il avait dû se contenter d'une paye mensuelle, distribuée au fil des ans. Ces 6000 euros de plus lui permettront d'obtenir quasiment 350 000 euros d'économie à l'orée de sa retraite... De quoi s'offrir un joli pavillon et un fabuleux voyage autour du monde. Ou, bénéficier de 50% de revenus en plus par mois. Ca change tout. Et, dans le cas d'une épargne constante, j'oublie simplement que les intérêts s'ajoutant au capital chaque année, ceux-ci ne feront qu'augmenter. Il faudra alors plutôt espérer 400 000 euros. Un sacré bas de laine qui ferait même office de retraite.
Ceci est un petit exemple, concernant de toutes petites sommes au regard des brassages délirants que se partagent les banques, les multinationales...
Cependant, ces 50% de bonus ont été gagné sur le dos de moins chanceux. Justement ceux qui triment toute une vie, cinq (parfois six) jours par semaine avec un gros mois de vacances (quand ça arrange l'entreprise), juste pour souffler un peu.
Tant que la seule façon de s'enrichir sera de faire travailler l'argent, tout ira de travers.
13 Octobre - Art majeur
On se souvient tous de cet échange à bâtons rompus, cette prise de bec entre Gainsbourg et Guy Béart au sujet de la définition de l'Art, en particulier les Arts majeurs. Béart assurant mordicus que la chanson était un véritable Art tandis que Gainsbourg affirmait, en les nommant, que les Arts majeurs avaient besoin d'une initiation. Des sept disciplines, la chanson n'en fait pas partie à proprement parler – se serait mettre sur le même plan un champion du top50 et une symphonie de Mozart ou la Neuvième de Beethoven.
En revanche, je soutiens que l'initiation est utile, nécessaire sinon indispensable à n'importe quel Art. Majeur ou mineur. Voire même au-delà de l'Art.
L'Art n'est pas réservé, comme il le fut et l'est encore trop souvent, à une élite, aux seuls connaisseurs, les fameux initiés. La beauté est à tout le monde. Elle doit se partager. Et tous les goûts sont dans la nature. Seulement, le goût peut se raffiner, s'affermir.
Vous pouvez écouter une symphonie sans connaître le solfège, sans savoir quels instruments y participent, sans avoir étudié l'Histoire de la musique, sans aucune notion technique. Seulement, vous resterez en surface. Cela ne veut pas dire que vous ne serez pas touchés, interpellés par la beauté de la composition, secoué par l'émotion – qui se place au-dessus ou à côté d'un simple abord cognitif. On ressent avec son cœur, pas avec sa tête.
Mais savoir décrypter ce que l'artiste a voulu offrir, cette partie de lui-même qu'il ne peut contenir en l'exibant au public, apporte une profondeur indispensable à bien comprendre l'oeuvre, à la fois avec son cœur et sa tête...
Lorsque j'ai vu pour la première fois Citizen Kane, j'ai trouvé ça assez commun. Je n'avais pas (encore) vu assez de films pour apprécier à sa juste valeur la fabuleuse maîtrise d'Orson Welles. Dans toute œuvre il y a la forme et le fond. Ce fond ne peut s'apprécier qu'avec un minimum de culture inhérente à cet art en particulier. Une expérience ou/et les clés qui permettent de mieux comprendre le travail de l'artiste. L'émotion, elle, reste telle – mais cette compréhension permet d'en décupler la force, la puissance. Ainsi les vraies grandes œuvres gagnent à être revues, relues, encore et encore.
On ne lit pas d'emblée Proust sans avoir jamais rien lu d'autre.
Cette expertise devrait - doit - s'appliquer à la vie courante, ne pas être réservée qu'à la contemplation des œuvres d'Art.
Si je bois un grand cru, j'y prendrai plaisir parce que j'aime ça, mais je serai bien incapable de faire la différence entre un grand Bordeaux et un petit côte du Rhône. Une certaine connaissance, une réelle expérience est souhaitée afin de mieux apprécier, donc de mieux jouir de la vie, de chaque instant, de mieux goûter les petits plaisirs de la vie. A tous les niveaux.
D'une manière générale, il est recommandable de bien connaître ce qui nous entoure. A commencer par savoir comment fonctionnent les objets dont on se sert, du moins en avoir quelques notions élémentaires. Cela permet de n'être pas ahuri et perdu lorsque ces machines tombent en panne, vous laissant les bras ballants et l'oeil éteint.
Sans être un sociologue patenté, savoir comment réagissent en général les gens permet de mieux se comporter avec eux, adoucit les relations humaines en réduisant la peur ou l'incompréhension – si l'on ne partage pas leur façon de vivre, leurs idées.
Lorsqu'on devient capable d'appliquer ces préceptes vertueux dans nos relations amoureuses, on aboutit pas très loin du bonheur.
Au final, mieux se connaître soi-même, ajoute à ce bien vivre que tout le monde recherche. Une introspection régulière offre l'avantage de savoir pourquoi on agit de la sorte, quels sont nos priorités, nos envies, nos peurs. Mieux les cerner pour mieux les maîtriser. Devenir le patron de ses émotions,
être bien dans sa peau participe à ce Graal souhaité : être heureux.
6 octobre - l'enfant roi
Il existe de nos jours un trésor bien plus précieux que tout l'or du monde ou les affolantes rivières de diamants qui font tourner les jolies têtes, blondes de préférence. Il pleure, il braille, mais tout le monde s'extasie.
La mort, pire le meurtre d'un enfant est inconcevable dans nos sociétés confortables.
On parle d'une façon récurrente des droits de l'enfant. C'est bien. Mais évoque-t-on ses devoirs, concept qui va de pair avec les droits ?
Attention, loin de moi l'idée même de faire du mal à un enfant (écouter Enrico Macias « malheur à celui... »)
Cependant il n'en a pas toujours été ainsi. C'est même tout récent.
Ouvrez n'importe quel livre publié avant la seconde guerre mondiale, plongez-vous dans l'Histoire et vous constaterez que la place de l'enfant n'était pas si enviable, il n'y a pas deux générations de cela.
On ne le considérait pas comme un petit d'homme, mais plutôt comme une larve qui devait se transformer pour donner, ayant atteint sa taille adulte, un véritable homme. Un têtard qu'on n'hésitait pas à rabrouer, à modeler, à martyriser parfois (lire Dickens, j'élève un peu la prétention de mes références).
Ce qui n'empêchait pas de le faire travailler dès l'âge de raison (autour de sept ans).
Il n'avait pas le droit à la parole, était battu sans que cela n'offusque personne. On ne l'éduquait pas, on l'élevait, pire : on le dressait.
La mort d'un bébé, d'un enfant en bas-âge était ressenti avec moins de peine que la disparition d'une vache ou d'un cheval. A cela une explication logique : avant sept ans, l'enfant coûtait de l'attention et de la nourriture, sans rien rapporter en échange. Il vivait aux crochets de ses parents. Il était un assisté, incapable de subvenir aux maigres ressources de la maisonnée.
D'un point de vue psychanalytique, il était obligé de se conformer à cette éducation rude. Il devait séduire ses parents pour être accepté.
Aujourd'hui, on assiste exactement à l'inverse : les parents séduisent leur enfant. Et cela commence avant sa naissance : le désir d'enfant. Peu ou pas de couples avant la généralisation de la contraception ne désiraient réellement un enfant. Il était là. On faisait avec, par culture ou habitude.
La contraception, en permettant la planification d'une famille – choisissant le nombre d'enfant et quand les mettre au monde – a complètement changé la donne. L'enfant est attendu, voulu, parfois rêvé. De fait, on lui accorde ce qu'on lui a toujours refusé : le statut d'un humain à part entière. Pouvant penser par lui-même, avoir des sentiments, ressentir la peine ou la joie. Les travaux de Françoise Dolto sont fondateurs. Et j'encourage tous, pas seulement les parents ou futurs parents, à lire ses livres.
Seulement, il peut arriver que de nouveaux problèmes surgissent. On n'éduque pas un enfant de la même façon qu'on le considère comme un objet ou comme un être humain avec un cerveau capable de fonctionner dès le premier jour et un cœur ressentant toute la palette d'émotions – peut-être même davantage qu'un adulte.
Cette position privilégiée, en quelque sorte d'un enfant-roi (car voulu, désiré, attendu) convoque de nouvelles responsabilités. C'est parfois plus dur à gérer à la fois pour l'enfant, écrasé parfois sous le trop plein d'amour – non, on n'est jamais « trop » aimé, mais peut-être l'est-on d'une mauvaise manière, inappropriée, et je ne parle pas de déviances plus graves – et aussi pour les parents qui, accordant une trop grande place à la prunelle de leurs yeux, ne savent pas/plus comment réagir face à des situations nouvelles, inédites.
En résumé, avant le baby boom, l'enfant devait tout à ses parents (et n'allez pas croire que l'aristocratie se situait au-dessus du peuple, par sa culture : bien au contraire, l'enfant était l'héritier d'un nom, d'une position sociale et ne devait qu'en remercier davantage ses parents ; s'il n'était pas battu comme un simple manant, il devait, très souvent, subir des violences psychologiques aussi atroces). Désormais, les parents se réalisent au travers de leur progéniture.
Il serait bon, il serait temps, de trouver un juste milieu. Cet équilibre qui, en toutes choses, est source d'excellence. Plus difficile à trouver, plus grande sera la satisfaction d'avoir réussi sa vie (entre autres).
29 septembre - Tout techno
Toutes les espèces sur Terre procèdent du même schéma : elles s'adaptent à leur environnement pour survivre. Elles mettent en place des stratégies, parfois complexes, pour perdurer l'espèce, quitte à de grands sacrifices et même jusqu'à modifier leur physiologie. L'évolution n'est rien d'autre que cela. Savoir s'adapter aux conditions extérieures.
Une seule espèce change de solution au problème : l'humain.
Lui, grâce à sa station debout libérant deux mains qui lui permettent de façonner des outils, puis la domestication du feu, formidable source d'énergie extra corporelle, a inversé le principe : il adapte son environnement à ses besoins.
Le point de départ de ce nouveau paradigme peut se situer il y a environ dix mille ans, lors de l'invention de l'agriculture. Pour la première fois, une espèce réussit à planifier l'avenir, en inventant au passage la propriété privée et son corollaire : le concept de richesse. Mais c'est avec l'industrialisation que tout s'accélère : désormais, il peut se jouer, non seulement des autres espèces, qu'il domine quand il ne les éradique pas, mais aussi des conditions climatiques dont il parvient à se protéger sans remettre en question son mode de vie, toujours plus déconnecté de la Nature, toujours plus confortable.
Ces deux notions, écologie versus technologie, on la retrouve actuellement, au cœur de la question qui devrait, qui doit se poser : vers quoi allons-nous ?
Et si, au final, le tout technologique était la suite inévitable, l'évolution ultime de notre espèce humaine ? A bien y réfléchir, tout peut se résoudre par le sur-naturel. Il suffit de s'en donner les moyens et d'y mettre le prix, jusqu'à se renier soi-même ainsi que notre condition animale.
Air conditionné pour contrer la hausse des températures, réflecteurs géants disposés dans le ciel pour réguler le réchauffement, fabrication chimique des médicaments, des aliments. Cités bunker, allant jusqu'aux anti-radiations. Mégapoles sous-marines, vaisseaux interplanétaires... afin d'aller ruiner de nouvelles planètes et appliquer ce que l'on ne sait que trop faire : découvrir, consommer, jeter.
A terme, hisser la virtualité à son plus haut niveau : sports virtuel devant un écran avec des capteurs d'effort, nature virtuelle : pouvoir gravir l'Everest tout en restant dans son salon, se baigner dans l'océan sans quitter sa salle de bain, donner la réplique aux plus grands acteurs, faire l'amour avec la personne de vos rêves... virtuellement !
Et pourquoi pas, parvenir à télécharger notre propre cerveau dans un programme informatique. Nous serions devenus alors des robots indestructibles dont le changement climatique importe peu. Des robots à l'intelligence artificielle. Immortels.
Ne riez pas. Nous en prenons gaiement le chemin...
22 septembre - mutliplication (rentrée des classes)
C'est la rentrée des classes.
Chaque fois, c'est pareil : je me demande si les programmes de l'éducation nationale ont fait des progrès. On en demande bien aux élèves, alors pourquoi pas ?
Prenons comme exemple la sacro-sainte table de multiplication qui a traumatisé tant de petites têtes blondes, à commencer par la mienne. Je me souviens qu'elles étaient récapitulées au dos de notre cahier de brouillon. Les moins de 30 ans n'ont pas connu ça. Un cahier en papier recyclé ou alors de bien mauvaise qualité, qui devait servir d'ébauches avant le recopiage « au propre ». Cette fonction était respectée pendant tout Septembre avant que l'objet ne se chiffonne, devienne le support de délires graphiques, de dessins plus ou moins licencieux, de terrain de jeux (morpion, bataille navale) quand il ne terminait pas sa vie à la poubelle bien avant la Toussaint.
Avant 1970, on répertoriait les 12 premiers nombres, déclinés jusqu'à la douzaine. Bref, de 1X1 jusqu'à 12X12. A apprendre par cœur. A l'époque, on ne connaissait pas d'autre méthode. De vrais perroquets ânonnant des phrases sans queue ni sens. Les dates de batailles de l'Histoire de France, les numéros des départements, le cours des fleuves, les règles grammaticales, les verbes irréguliers, le tableau périodique des éléments chimiques. Et cette bonne vieille table de multiplication. Une torture moderne, dès notre plus jeune âge. On n'imagine pas les répercussions psychologiques ultérieures.
Le système enseignant nous a donc bien bourré le crane. Pour rien. Car, nous allons le découvrir ensemble, nous avons appris par cœur des choses parfaitement inutiles, redondantes.
Par cœur. Cela veut dire qu'à la moindre panne, au plus petit accident neurologique, on perd tout. Tandis qu'apprendre par la réflexion, en usant de son intelligence et non plus uniquement de sa mémoire, assimilant par logique, permet de retrouver le chemin. Comme le Petit Poucet et son balisage minéral.
Nous allons réduire cette fameuse immonde table à 10 fois 10 chiffres. Selon la méthode archaïque, cela donne cent résultats à connaître par cœur. Je prétends sans mentir que toutes ces tables peuvent se résumer à 10 lignes à savoir d'une manière obligatoire. Tout le reste n'est que déduction, logique, évidence. En route !
Commençons par la table des zéros.
Hé oui : on nous a appris tant de choses inutiles et on a omis le plus important : le zéro. Je veux bien que ce soient les arabes, grands matheux, qui nous l'ont apporté : ce n'est pas une raison pour le rabaisser. D'autant que le zéro est primordial. Parlez-en à un banquier Suisse, lui aura vite compris son utilité, selon sa place dans la suite des chiffres, bien entendu. Le zéro permet, en outre, de remettre les pendules à l'heure. Voyons :
Nous nous apprêtions à fêter l'entrée dans le troisième millénaire en faisant le plein de bouteilles de champagne le 31 décembre 1999 quand, tout à coup et sans crier gare, voilà qu'un matheux tatillon annonce que le début du vingt et unième siècle, et par conséquent le départ du nouveau siècle, n'aura lieu que le premier Janvier... 2001 !
Toutes les festivités repoussées d'un an !
Et le pire c'est que le gugusse n'avait pas tort. Dans les faits.
Lorsque nous naissons, il nous faut attendre une année complète avant d'afficher le chiffre UN à notre pedigree. En ce qui concerne le calendrier, il en va tout autrement. Ne connaissant pas le zéro lorsque celui-ci fut mis en place (1582, où l'on a carrément zappé dix jours afin de se remettre à niveau avec le rythme des saisons), on a fait débuter notre ère à l'an UN. Donc, on passe de l'an MOINS un avant JC à plus un après lui-même. Bon, on ne va pas chipoter pour une paire d'année : il paraît qu'on s'est également planté sur sa naissance. JC serait né quatre ans avant lui-même ! Là encore, pour un type capable de ressusciter trois jours après trépas, voir le jour quatre ans avec sa naissance n'est qu'un point de détail. Bref, d'où l'importance du zéro.
Reprenons : la table des zéros. Zéro fois un égale zéro, zéro fois deux égale zéro et ainsi de suite. C'est ce qu'on appelle un chiffre absorbant. Quoiqu'on fasse, il l'emportera toujours. Pas de quoi s'effrayer pour cette première mise en bouche. On est tous d'accord.
Maintenant le UN. Une fois un égale un, deux fois un égale deux, etc... Bon, ça revient à savoir compter, rien de plus. Sauf pépin, dès deux ou trois ans, on y parvient à peu près.
Un gaillard qui avait de la jugeote a même constitué un spectacle où il énumérait TOUS les nombres. Il est monté sur scène et a commencé son marathon... C'est sans fin.
La table des deux. Deux fois un égale deux, deux fois deux égale quatre, deux fois trois... Stop ! Finalement, ça revient à compter de deux en deux, comme quand on dénombre un alignement de fruits, de planches, de n'importe quoi, pour aller plus vite. Là encore, sauf cas grave, à quatre ans tout le monde peut le faire. Au passage, je tenais à vous parler de l'infini. L'ensemble des nombres est infini. On trouvera TOUJOURS un nombre supérieur à n'importe lequel. Bien. Maintenant, l'ensemble des nombres pairs (cette fameuse table des deux) est également infinie. Pourtant, il semble évident qu'il y en a deux fois moins que l'ensemble des nombres. Cela revient à dire que la moitié de l'infini est encore l'infini...
Table des trois. Alors là, il va falloir bosser, les amis. On ne peut pas faire autrement. Il faut l'apprendre...
Enfin, pas en entier. Parce que, je ne sais pas si vous avez compris le principe, mais trois fois un, on l'a déjà rencontré : ça s'appelle une fois trois. Pareil pour trois fois deux. Reste Trois fois trois jusqu'à neuf fois trois. Sept lignes à apprendre. On ne va pas exploser un neurone pour ça, non ?
J'aime bien le trois. C'est mon chiffre préféré. Quand on le multiplie, c'est le seul (avec le sept – nous verrons ça) qui donne, à chaque fois une terminaison différente. 3X1 = 3 3X2 = 6 3X3 = 9 3x4 = 12 (soit 2) 3X5 donne 5, puis 8 puis 1 puis 4 puis 7 et enfin 0.
Table des quatre. Quatre fois un égale quatre, bon jusqu'à 4X4 on les a déjà croisé, n'est-ce pas ? Très vite, on comprend que quatre étant le double de deux, il suffit de compter de quatre en quatre, comme quand on est pressé pour dévaler les escaliers. Si on n'y arrive pas, simplement doubler la table des deux. Par exemple quatre fois sept, ce n'est que le double de deux fois sept – que l'on connaît déjà.
Cinq. Même principe. Avancer de cinq en cinq, en alternant les terminaisons (elles ne sont que deux, contrairement aux trois, vous n'avez le choix qu'entre zéro et cinq). Autre méthode. Multiplier par dix et diviser par deux. Justement tiens, la table des dix. Placée à la fin du tableau mais qu'on devrait commencer à lorgner avant le un. Le dix, c'est pas très compliqué : il suffit d'utiliser le zéro et le placer toujours à la fin du résultat. Un mix de la table des un et des zéros. Rien de plus.
Six. Tout comme le quatre est le double de deux, ce n'est que le double de trois. Quand on sait notre table des deux et celle, plus ardue (7 lignes à apprendre!) des trois, c'est une formalité.
Sept. Hou la la, ça devient compliqué, là !
Effectivement, le sept est récalcitrant. Ce n'est pas pour rien qu'il est le chiffre fétiche des tribus amérindiennes. Les sorciers avaient dû repérer son côté ésotérique. Mais, après tout, jusqu'à sept fois six, ce n'est que répétition. Reste les trois dernières lignes à ingurgiter sans réfléchir. A noter, qu'à l'image du trois, les terminaisons sont toujours différentes : 7, 4, 1, 8, 5, 2, 9, 6, 3 et 0.
Le trois et le sept auraient-ils une liaison ?
Huit, très jolie boucle, plus harmonieuse que celle, à angle droit (dont Victor Hugo dénonçait la rigueur), du quatre. 8 et 4 auraient-ils une relation amoureuse ?
9 ressemblant à un 6 renversé, seraient-ils jumeaux ? Pareil pour 2 et 5 qui semblent se regarder dans un miroir. Le 1 et le 7 sont tout droits, campés comme des i.
Le huit. Il n'a échappé à personne qu'il est le double de quatre, lui même deux fois deux. Une mise en abîme qui peut rebuter, mais croyez-moi, on parvient à s'y faire.
Neuf. Facile, puisque trois fois trois.
Du reste, le neuf, tout comme le trois se repèrent dans l'alphabet des nombres assez facilement, comme s'ils étaient équipés d'un GPS. Je peux vous dire d'emblée que 678 est divisible par trois, alors que 226 (le résultat) ne l'est pas. Comment un tel prodige ? Suis-je autiste ? Même pas. Le truc est d'additionner les différents chiffres qui composent le nombre. Si on tombe sur un multiple de trois (6+7+8 = 21), celui-ci est divisible. Enfin, on parle là, de nombres entiers. L'autre soir, j'étais au restau avec un pote et l'addition s'élevait à 63 euros. Pas divisible ? Devais-je payer pour lui ou lui pour moi ? J'ai tendu ma CB et on m'a débité 31,50. Lui , tout pareil. Nous aurions été trois convives, cela aurait posé un problème. 20, 3333... à l'infini, aucune banque ne saurait l'accepter. Mais les choses sont si bien faites que, si nous avions été trois, l'addition n'aurait pas été la même.
Le 9 se repère encore plus facilement dans ses déclinaisons. 18, 27, 36... si on additionne les deux chiffres, on tombe TOUJOURS sur le 9 d'origine.
Alors, les tables de multiplication, toujours aussi rébarbatives ?
A ce jeu là, on pourrait dépasser le dix.
Filons vers le 11. Onze fois un, etc jusqu'à 11X12 = 132, 11X13 = 143, 11X14 = 154
Rien ne vous interpelle ? Si. Pour le 12, on obtient 132, soit l'addition du 1 et du 2 mis au centre. Pareil pour le 13 : 1+3 (4) placé au centre (143)... Rigolo, non ?
15 Septembre - Tout le monde ment
Tout le monde ment.
C'est une évidence.
On a longtemps cherché la spécificité de l'humain, un trait unique qu'il ne partage avec aucun autre animal. L'intelligence, le rire, l'utilisation d'outils : quantité d'animaux répondent à cette définition.
Mais le langage ?
Justement oui, le langage articulé. C'est ce moyen extraordinaire de communication, si performant et si précis qui permet, dans un même élan, de tromper, de dissimuler, mais aussi de jouer sur le second degré et, par extension, créer l'humour sans lequel la vie serait si terne.
Aucun autre animal ne peut jouer sur ces faux-semblants. Cela change tout dans une société basée sur les échanges sociaux. Les fourmis communiquent par molécules odorantes, d'autres espèces par vibrations, par des mimiques, des comportements.
Le langage permet cette faille entre notre pensée et notre parole. Cela a des implications multiples et profondes.
La schizophrénie n'existe pas dans le monde animal, du moins elle ne s'y développe pas aussi radicalement. La mythomanie et quantité d'autres sentiments humains qui nous pourrissent la vie, à nous-mêmes et nos semblables, sont rares dans la nature.
Tout le monde ment.
Bien entendu, il existe une échelle dans la dissimulation. On ment d'abord pour se préserver, pour ne pas avoir à s'expliquer trop longuement. Le mensonge est un raccourci.
« Comment allez-vous ? » Dans 99% des cas, nous répondons « très bien, merci », sans entrer dans des détails qui, après tout, ne regardent que nous - au mieux nos proches.
On ment pour préserver l'autre.
Le médecin qui ne dit pas (toute) la vérité à son patient car il sait que cela sera contre-productif. En revanche, celui ou celle qui ment à son conjoint sur son adultère, en dépit de vouloir le protéger, ne fait qu'aggraver les choses.
La politesse, ce mensonge en habits du Dimanche, est nécessaire à la vie en communauté. Elle arrondi les angles. Attention toutefois à ne pas tomber dans la sournoiserie, la simulation, la fourberie. Les petits mensonges sont sans conséquence lorsqu'ils sont proférés sans la notion de hiérarchie. Mentir en se croyant supérieur, ou en voulant l'être, voilà le piège.
Une diplomatie, même empreinte d'hypocrisie, sera toujours préférable à un conflit ouvert.
On a tous envie, on a tous besoin de clarté, de transparence, de rechercher LA vérité. Depuis Descartes, nous voulons savoir. C'est entré dans nos gènes. Autrefois, les contes et légendes recevaient davantage de foi. On y croyait dur comme fer en accordant plus d'importance aux superstitions, aux dictons, à ce monde parallèle qui nous dépasse, nous dirige. Parfois celui des Dieux.
On parle alors d'obscurantisme. C'est révélateur. Cependant, si toute forme de mystification rassure quelque part, comme une ombre qui masquerait ce gouffre insondable et effrayant qu'est le monde réel, la vérité est une lumière aveuglante qui peut brûler les ailes.
Tout le monde n'est pas près à y faire face. On la redoute autant qu'on la désire.
L'avènement des sciences et des mathématiques ont fait faire un bond de géant à cette grande dame, impitoyable parfois. D'abord pour notre amour-propre, notre fierté, notre orgueil. Apprendre que la Terre n'est pas le centre de l'univers. Que nous ne sommes supérieurs en rien à n'importe quelle espèce. A savoir que, tous, nous sommes mortels, constitués des mêmes atomes et, surtout, remplaçables.
La vérité fait mal. Le mensonge est un puissant psychotrope, un médicament bien plus fort que la plus radicale morphine.
La vérité nous rend nos pleines responsabilités tandis que la dissimulation endort notre libre-arbitre.
Dure, pure, franche, éblouissante. La vérité, c'est la liberté.
8 Septembre - Réussir sa vie
Réussir sa vie ou réussir dans la vie, ce n'est pas la même chose.
Réussir dans la vie correspond à des standards dictés par la communauté, qui évoluent selon les époques ou les lieux : le plus fort, le plus intelligent, le plus connu, le plus riche, tandis que réussir sa vie est l'aboutissement de valeurs propres à chacun.
Si l'on confond souvent les deux, c'est que nos sociétés privilégient la réussite identifiable. Etre connu, réputé, gagner de l'argent sont facilement remarquables. L'épanouissement intérieur est moins ostentatoire. Et pourtant bien plus valorisant. Le regard de l'autre ne flatte que notre ego, rien de plus. Il permet de s'insérer plus facilement, pas d'être heureux. Cela aboutit à ce paradoxe mis en lumière par le vieil adage « l'argent ne fait pas le bonheur », plus largement la reconnaissance ne rend pas heureux. Cela attise autant la jalousie que l'envie. Les plus adulés sont souvent les plus seuls.
Et si l'on inversait ces valeurs ?
Quel est le but ultime de la vie, au-delà du plaisir égoïste de vouloir le meilleur pour soi ? Sans doute vouloir le meilleur pour les autres. Rayonner autour de soi, non pas en signant des chèques ou des autographes, mais en donnant de son temps, de sa personne, en partageant ses plaisirs, ses envies, ses goûts. En tendant la main.
Abraham Maslow, psychologue américain du vingtième siècle, a établi une pyramide qui recense les différents besoins humains, du plus basique au plus évolué. Pour les animaux, rien de plus simple : leur unique but dans leur parfois courte vie est de perpétuer l'espèce. Ils ne sont que des maillons d'une chaîne, comme nos cellules qui ne pensent pas par elles-mêmes et collaborent dans un projet qui les dépasse, sauf exception des cellules cancéreuses qui, elles, font un peu n'importe quoi dont on peut constater le douloureux résultat. Seuls les mammifères les plus évolués ont développé une conscience d'eux-mêmes et c'est cette conscience qui tend à donner un sens à sa vie.
Mais revenons à Maslow et son échelle des besoins. Au premier stade, les besoins physiologiques. En un mot, s'ils ne sont pas satisfaits, on meurt. Boire, manger et dormir. On 'a pas besoin d'autre chose pour faire tourner la machine. Et l'on pourrait même penser que cela rend bêtement heureux. Pas d'autre souci que d'aller chercher sa pitance : dans un monde qui regorge de fruits, de plantes comestibles, éventuellement de gibier, c'est tout bénéfice.
Second degré : le besoin de sécurité. Chez les bisounours, tout irait bien dans le meilleur des mondes, sauf que sur Terre, on risque sa peau à tout bout de champ. Sans parler des guerres et des conflits de voisinage, un simple virus, une bactérie, un banal et bête accident domestique, une prise de risque inconsidérée et paf : nous voilà diminués, besoin d'être soigné, réparé, consolidé.
Troisième niveau : le besoin d'appartenance et d'amour. Quand on a le ventre rempli et que l'on peut dormir sur nos deux oreilles, forcément on aspire à autre chose. De plus élevé, qui nourrit notre âme, notre cœur. A ce stade, ce n'est pas encore de la reconnaissance, juste une relation plus rapprochée avec les autres. Nous avons besoin des autres... comme ils ont besoin de nous. Savoir ça permet de se donner du cœur à l'ouvrage, de mieux se considérer, d'exister sans être simplement un tube que l'on nourrit.
Quatrième étage : le besoin d'estime de soi. Une reconnaissance sociale. C'est précisément à ce niveau qu'entre en jeu le concept de réussir sa vie. Les motivations varient d'une personne à l'autre, les moyens mis en œuvre pour parvenir à devenir quelqu'un (de bien, si possible) sont différents. Ici le regard des autres est primordial, les relations humaines fonctionnent à plein régime. Et les codes sociétaux deviennent la règle. Savoir s'intégrer, trouver sa place en interagissant avec les autres. Cela demande du doigté, une certaine aisance, du charisme, du talent. Mais cela peut aussi être accompli par séduction, mensonge, tromperie, harcèlement, influence, manipulation.
Enfin le cinquième et ultime étage : l'accomplissement. Laisser une trace de son passage sur Terre. Cela dépasse la reconnaissance de ses pairs et cela s'inscrit dans le temps. C'est un peu la différence entre la joie et le bonheur. Lorsqu'on atteint cette dimension, c'est sûr : on a réussi sa vie. Mais cela peut encore une fois prendre différents chemins. Un artiste qui laissera une œuvre, un scientifique qui aura fait avancer la recherche, un homme politique qui aura changé le monde (Gandhi et Hitler sont placés sur le même niveau d'après cette définition – on parle d'accomplissement personnel, pas de bienfait pour l'humanité : cela serait peut-être le sixième niveau ?)
Mais tout un chacun peut accéder à ce but suprême. Devenir parent et réussir non plus sa vie, mais donner toutes les chances à ses enfants de réussir, à leur tour, la leur.
1° septembre - Handisport
Les jeux paralympiques sont riches d'enseignement. Ici, je ne reviens pas sur des valeurs d'empathie, d'inclusion, de tolérance, de respect de la différence et autres grands sentiments qui font de nous des humains. Quand les athlètes ne peuvent s'adapter aux sports, ce sont les sports qui doivent s'adapter aux champions.
Ainsi le cécifoot, version non-voyant du football traditionnel, est pratiqué dans un silence absolu – ce qui nous change bienheureusement du délire vocal des supporters endiablés – puisque le ballon est muni de grelots afin de révéler sa présence aux joueurs. Ainsi les matchs gardent tout leur piment. Sans cet artifice, tout se résumerait à une belle partie de cache-cache, plus proche des joutes d'Intervilles que d'un vrai sport.
En revanche, le foot couché, bref le goal foot, me paraît hors de propos. Les pratiquants sont couchés devant une cage de buts et doivent stopper un ballon lancé à la main. Une sorte de bowling dont les quilles, humaines, seraient déjà par terre.
Une question me turlupine, à la vue des courses d'athléthisme (200, 400 mètres). Autant les nageurs évoluent seuls dans le bassin – à leur place, les yeux bandés, j'aurais tôt fait de quitter mon couloir et traverser en long et en travers la piscine – dans le stade ils courent en binôme : un valide les accompagne. Ce qui sous entend qu'il est aussi rapide qu'eux. Engage-t-on de vrais champions olympiques ?
Oubliez tout ce que vous savez sur le rugby. En fauteuil, le sport ressemble davantage à une partie d'auto-tamponeuses : ce sont les fauteuils qui morflent et, à la place du soigneur qui vient panser les bobos des participants au jeu à 15, ce sont des mécanos, transfuges du cyclisme, qui viennent réparer les chaises.
Cependant, il y a une chose plus sérieuse : des compétitions de badminton avec des athlètes nains. Ah bon ? Je ne savais pas que la petite taille était un handicap. A part le basket (et encore, tout dépend non pas de la taille mais de la détente lors du saut), je ne vois pas pourquoi un nain ne pourrait pas concurrencer des champions de taille « normale ».
A ce moment, les roux sont handicapés, les porteurs de lunettes, les chauves, les barbus, les noirs, les femmes, les homosexuels...
25 Août - la tête et les mains
Un athlète handicapé confiait lors des récents jeux olympiques que son cerveau avait dû commander à son corps, pour se reconstruire.
D'une manière générale, le cerveau doit toujours commander à notre corps, valide ou non. La recherche du geste parfait, du mouvement idéal, n'est pas l'apanage des seuls champions. Aspirer à l'excellence dans la dextérité d'un métier manuel, qui sera toujours supérieur à une pure activité cérébrale, puisque alliant les deux : travailler de ses mains tout en pensant son geste, sans ces automatismes inventés dans les grandes manufactures, ateliers démesurés où la division du travail a imposé un geste qui n'est plus qu'un simple réflexe ; trouver l'harmonie, pas seulement en musique ou en danse, ajuster le tempo idéal comme si notre vie était une symphonie. Faire de sa vie une danse, une gymnastique parfaite afin d'épanouir son esprit au travers de son corps.
Car il ne faut pas oublier que le processus fonctionne dans les deux sens : nos muscles obéissent à notre volonté, du moins le faudrait-il dans l'absolu, mais nos sensations influent grandement sur notre psychisme. Nous sommes des éponges s'abreuvant de notre environnement. Les paysages, les objets, mais avant tout les autres humains. Nos relations amicales, amoureuses ou tout simplement des rencontres fortuites ou habituelles interagissent avec notre esprit, nous faisant nous sentir utiles, en un mot : exister. Nous avons besoin des autres, ne serait-ce que pour savoir que l'on est vivant. Ils sont les miroirs indispensables qui prouvent que nous sommes bien réels.
Le plaisir naît en toutes choses : un sourire échangé, un succulent repas, un paysage admirable, sentir ses muscles répondre à la moindre sollicitation, s'enivrer du bonheur d'instants uniques, se sentir nécessaire sans pour autant indispensable. On prétend que faire l'amour régulièrement aide à notre santé mentale, psychique et corporelle. Tout ça n'est que chimie. Cette chimie du corps, des molécules qui transitent par nos cellules, une biologie basique indispensable à notre bien être. Le sentiment naît de cette chimie. Nous échafaudons des idées, des pensées issues de sensations purement physiologiques. Ne jamais sous estimer le pouvoir corporel tout en restant maître de celui-ci.
L'amour, la passion, l'ambition sont des drogues aussi puissantes que les plus forts psychotropes : il ne faut ni les fuir à l'image de moines bouddhistes se réfugiant dans un isolement physique et moral, ni s'y vautrer jusqu'à ne plus pouvoir rien maîtriser. Cet équilibre est notre raison de vivre.
18 Aout - Multitudes
- Le plus important dans la vie, c'est de savoir dire Bonjour. Si vous dites bien Bonjour, vous avez fait la moitié du chemin. Dites-moi Bonjour, par exemple.
- B'jour.
- Non, là, vous ne me dites pas Bonjour. J'ai l'impression que vous me dites au revoir. Imaginez maintenant que je sois allongé sur un lit d'hôpital. Dites-moi Bonjour.
- Bon-jour.
- C'est mieux. Là, j'ai l'impression que vous êtes prêt à faire des choses pour moi : mon cas vous intéresse plus que le mien. Ce qui intéresse les gens, c'est que l'on parle d'eux. Tenez, encore une chose : imaginez que je sois une belle blonde avec des gros seins ; dites-moi Bonjour.
- Bonjooour !
- C'est encore mieux. Mon cul vous passionne davantage que votre bite.
Cette parodie de la célèbre scène écrite par Claude Lelouch entre Belmondo et Anconina résume bien le problème majeur de nos sociétés individualisées. Chacun l'a déjà expérimenté, à un moment donné ou un autre de sa vie : vous ne dites pas dix mots à vos voisins que vous croisez chaque jour, tandis que si vous les rencontrez au bout du monde, vous allez passer la soirée avec eux « pour parler du pays » dans d'importantes effusions.
Dans le film Crocodile Dundee, un chasseur d'alligators australien, un vrai bouseux, propulsé contre son gré en plein New York, s'échine à saluer n'importe quel quidam qu'il rencontre. Personne ne lui répond. Normal. Il est impossible de dire bonjour à des centaines, des milliers de personnes en si peu de temps, à moins d'être un politique en campagne électorale.
La multitude offre également bien d'autres inconvénients, plus grave que le simple manque de civilité. Quelqu'un est allongé par terre en pleine campagne ou sur une route déserte : vous vous inquiétez. C'est normal. Vous croisez un humain gisant sur le trottoir parmi la foule : vous n'y faites même pas attention.
Vous arpentez une rue jonchées de papiers gras et bouteilles vides : vous n'avez aucun scrupule à y jeter un emballage usagé.
Il y a pire : la censure journalistique qui empêchait l'information de transparaître n'a plus lieu d'être. Noyé sous des flots d'informations, il est impossible d'en faire le tri, à moins d'y passer tout son temps libre.
La moindre demande chez Google provoque instantanément des milliers, des millions de réponse. Avez-vous seulement fait glisser la souris jusqu'en bas de la première page ?
Trop de choix tue le libre arbitre. Mais attention, la frontière est mince entre la diversité, quelle qu'elle soit, indispensable et salutaire rempart contre tout monopole, offrant l'opportunité d'échapper à la globalisation courante et le flot informe de produits se ressemblant souvent. Exemple : toutes les carrosseries de voitures se ressemblent, cependant allez chercher un modèle dépourvu de climatisation, d'un système Gps ou en trois portes. Sous le prétexte de plaire au plus grand nombre, le choix ne s'applique uniquement par la multiplicité de modèles qui se ressemblent.
Multiples mais pas différents.
Il serait peut-être temps de se focaliser sur les différences et moins sur les clones.
21 juillet - le futile et l'indispensable
La grand messe a commencé. Comme tous les quatre ans, les olympiades font s'arrêter le monde. Même les chefs d'état viennent en procession, inaugurer l'autel du sacro-saint sport.
Pourquoi tant d'enthousiasme, d'euphorie ? Car, finalement, à quoi bon, le sport ?
Ca ne sert à rien – nous sommes tous d'accord sur ce point essentiel.
Tout comme l'Art.
Voilà une pratique futile au plus haut degré.
Mais, justement. Cette futilité désespérante est diaboliquement précieuse.
Regardez un bébé. Fixez son regard. Il voit le monde comme s'il le découvrait – et c'est exactement réalité. Il voit tout pour la première fois et c'est merveilleux à ses yeux. Il ressent tout à la puissance dix. Chaque nouvelle découverte devient sensationnelle.
Pourquoi alors, à un moment, perdons-nous ce pouvoir de nous émerveiller ? Pourquoi devenons-nous blasés en vieillissant ?
Justement, parce que nous grandissons. On se focalise sur l'utile, par souci de sécurité. L'instinct de survie, en quelque sorte.
Tout ce qui ne nous n'est pas utile, vital, est relégué au second plan. Les problèmes auxquels nous sommes confrontés prennent le dessus. Nous devons les résoudre en priorité : il en va de notre survie. Plus le temps d'admirer un coucher de soleil, de profiter des milliers de petites choses qui nous ravissaient quand nous vivions dans l'insouciance de notre prime jeunesse.
Le sport et l'art. Deux disciplines dont on peut aisément se passer, qui ne nous sont pas totalement indispensables. Comment expliquer alors que, même et surtout dans les conditions les plus désespérantes et atroces, l'homme a besoin de ces futilités.
J'ai appris que, au cœur des camps de concentrations nazis, des milliers de pages de partitions musicales avaient été composées, retrouvées. Pourquoi ce besoin superficiel dans de telles conditions de survie ?
Peut-être parce que, justement, l'art et le sport sont indispensables à notre si gros cerveau que même le repos et la nourriture basiques ne suffisent plus à l'alimenter.Il nous faut un composant, un carburant plus puissant.
14 juillet - Choisir
Récemment, je me baladais sur l'un des magnifiques sentiers de randonnée que propose notre beau pays, quand je me retrouve devant un panneau d'interdiction, augmenté d'une barrière voulue infranchissable. Renseignement pris, j'apprends que cette partie est condamnée suite à la mort par accident d'une personne il y a une paire d'années.
Partant de ce constat, quasiment tous les quartiers des grandes métropoles devraient donc être interdits : ils ont été, à un moment ou un autre, le lieu de règlements de comptes, d'une altercation qui a mal tournée, ou d'un banal accident.
Je ne parle pas des routes – quasiment dix mille victimes annuelles dans les années 70 et encore beaucoup trop actuellement.
Plus aucun coin où poser les pieds.
Nous avons un rapport à la mort particulièrement pervers. On ne veut pas l'affronter, ni en parler franchement (voir le débat sur l'euthanasie), mais elle nous fascine quand même.
Du reste, si le randonneur s'était simplement cassé une jambe ou bien, pire, déambulait dorénavant dans un fauteuil roulant, le sentier serait-il encore praticable ?
Pourquoi un accident à un instant donné doit condamner tout les autres à faire demi-tour ?
Cela est aussi stupide que de punir un groupe entier pour la faute d'un seul élément.
Il aurait été plus judicieux de chercher à comprendre pourquoi cet accident fatal a eu lieu. Quelle erreur a-t-elle été commise ? Car, à part un éboulement de terrain, la responsabilité du marcheur est seule engagée.
Voilà le mot : responsabilité. Qui va de pair avec cette fameuse idée de liberté qui nous tient tant à cœur.
Apprendre à se connaître, d'abord. Savoir où se situent nos limites, comment réagit notre corps, notre métabolisme. L'entraîner, l'améliorer, l'affiner. Travailler sur le mental, la pugnacité, la volonté, le dépassement de soi.
Ensuite, étudier le terrain : quelle est la nature du sol, existe-t-il des risques objectifs, dans quel sens évolue la météo, comment vont réagir les autres participants ?
Toutes ces informations vont délimiter cette zone de sécurité, propre à chacun. Car, oui, nous sommes tous différents, donc inégaux devant le danger. Certains sont mieux préparés que d'autres.
Le plus grand courage en balade dans la nature consiste à être capable de faire demi-tour. Ne pas essayer d'aller au-delà de cette précieuse zone de sécurité. Mais surtout, ne pas trop compter sur les conseils et les appréciations des autres. C'est utile, mais ne constitue pas l'assurance d'une réussite, du moins un gage de sécurité.
Chaque personne possède sa propre échelle de difficultés, elle varie sensiblement d'une à l'autre. Confronter ce que l'on sait de soi et du terrain à l'expérience pratique. Y aller voir plutôt que suivre bêtement et aveuglément un topo, le plus précis et précieux soit-il.
Devant un passage réputé difficile et, plus globalement, à n'importe quel détours du chemin, savoir se projeter en comparant ce que l'on sait de nos capacités et du terrain rencontré.
Là, je parle essentiellement de marche dans le milieu naturel. En réalité, cette responsabilité est applicable dans TOUTES les situations de la vie. Savoir se faire confiance, évaluer les conditions, se projeter dans les scenari possible.
Et, en dernier lieu, choisir.
7 juillet - bien voter
Suite au séisme électoral des Européennes début Juin, nous revoici appelés à donner notre avis dans le but, un peu obscur je l'avoue, de renouveler notre parlement.
Comment en est-on arrivé là ?
La démocratie par représentation, donc l'institution du vote, est peut-être la plus belle, la plus grande idée humaine en matière de politique (= la gestion de la chose publique).
Une personne, un bulletin. L'égalité parfaite. Dans l'isoloir, le pouvoir du pauvre est élevé au niveau du riche, celui de l'illettré égale celui de l'universitaire, le marginal a droit au chapitre comme le notable. Il n'y a plus de hiérarchie. Tous différents, tous égaux.
Seulement, notre société actuelle privilégie la ressemblance et l'inégalité, alors que ce devrait être l'inverse : tous uniques, mais tous jouissant des mêmes droits, pas uniquement sur le papier mais en pratique. On s'y approche, mais ce n'est pas franchement ça.
La majorité des électeurs ne savent pas voter. Du moins, ils votent pour de mauvaises raisons.
Quelqu'un voudra voir son pouvoir d'achat augmenter, un autre moins de taxes et de règlements dans sa profession, un troisième de meilleures infrastructures routières, davantage d'arbres, plus de crèches, des hôpitaux plus proches, des classes moins surchargées...
Une large majorité ne vote que pour elle-même, dans l'illusion de petits avantages quotidiens. Penser qu'en glissant son bulletin dans l'urne, votre patron va vous augmenter, que votre femme ne vous fera plus la gueule, que vos enfants lèveront enfin le nez de leur smartphone, que votre voisin cessera ses interminables soirées jusqu'à l'aube... Cela est bien naïf, spécialement dans une société libérale où le pouvoir strictement politique se dilue dans la grande machine économique.
Mais le pire reste tout de même cette propension à voter « contre ». Empêcher celui-ci ou celle-là d'accéder au pouvoir. Même dérive que vouloir détruire au lieu de bâtir.
Le système électoral fonctionne un peu comme l'économie : nos représentants ne sont, en somme, que des commerciaux, vantant un seul produit : eux-mêmes. La professionnalisation de la chose politique oblige les hommes et femmes politiques à toujours plus d'avidité pour décrocher un poste et surtout s'y maintenir : ils ne savent faire que ça.
Qui dit commerce, dit forcément conditionnement, influence. Pour vendre un produit, on vous le présente sous sa meilleure forme, occultant certains détails déplaisants, vantant ses qualités au delà de toute mesure. Personne n'est à l'abri de cette maligne influence, relayée et augmentée par les médias. La bonne couleur du logo, une tronche qui inspire confiance, le slogan qui fait mouche, tout cela prend une importance démesurée. On nous vend les idées comme on le ferait d'un pot de yaourt ou de la lessive. A ce point, c'est grave. Des idées, il ne reste que peau de chagrin. Jetez un œil sur les programmes : ce ne sont que des titres. Pour en savoir davantage, il faut creuser : lire la presse, décortiquer les interviews, aller sur les sites des partis... Et encore, il sera difficile d'éviter les grandiloquences et les superlatifs. Tout ça au nom de la rentabilité : les gens n'ont pas du temps à consacrer à éplucher les programmes dans leur totalité, leur subtilités, leurs méandres. Il faut que cela soit pré-digéré. Facile. Rapide.
Alors, comment bien voter en son âme et conscience ?
C'est pourtant tout simple.
D'abord mettre de côté ses intérêts personnels. On n'élit pas nos représentants pour améliorer notre vie personnelle, mais celle de l'ensemble des concitoyens.
Ensuite, connaître le rôle exact, le pouvoir réel (la marge de manœuvre) de la fonction à laquelle on vous demande d'élire un homme ou une femme. Le rôle, le pouvoir, les obligations, les droits et les devoirs d'un maire ne sont pas ceux d'un député, différents d'un conseiller départemental ou d'un représentant à Bruxelles. Bien savoir quelle sera la fonction de notre représentant est donc primordial.
Je peux avoir un ami avec lequel je ne partage pas les idées politiques, mais en qui j'ai confiance. Il se présente à la mairie de ma commune. Je connais ses valeurs : celles sur lesquelles nous ne sommes pas d'accord ne seront peut-être pas du ressort du maire (changer un texte de loi, par exemple) – cela ne me dérangera pas qu'il ne partage pas mes idées sur ce point. En revanche, je sais qu'il aura à cœur de se battre pour d'autres projets qui me tiennent à cœur.
Cela est déjà plus difficile dans une grande ville, où l'individualité se noie dans une équipe plus étoffée pour bien gérer l'agglomération entière. Sans parler de l'éloignement : on ne connaît pas personnellement nos dirigeants politiques – c'est impossible. Là se situe la limite de la démocratie par représentation, à la différence d'une démocratie directe.
En résumé, connaître parfaitement les limites de la fonction ET les candidats qui s'y présentent (leur personnalité, leur programme, mais aussi leur équipe, leur façon de travailler, leur volonté, leur ambition).
Ensuite, choisir celui ou celle qui représentera le mieux nos idées, notre façon de voir évoluer le monde – pas simplement un choix égoïste.
Tout cela demande du temps, de l'investissement. Se préparer à une élection demande de l'énergie, un vrai travail de recherche journalistique ou universitaire. Tout le monde n'est pas prêt à s'y engager. Pourtant c'est à cette condition que l'on pourra voter en son âme et conscience, à faire le choix le plus judicieux. Et, accessoirement, ne pas être, plus tard, déçu par son vote – ce qui va immanquablement arriver cette fois encore (mais il sera trop tard). On tombe alors dans un autre biais : après la professionnalisation du politique, celle de l'électeur. Sans verser dans cette extrême, pourquoi ne pas instaurer un permis de voter.
Il ne viendrait à personne l'idée de lâcher sur les routes meurtrières des chauffards sans aucune formation. Pourquoi ne pas l'appliquer à ce qui demeure tout de même une chose essentiellement à notre système : la représentation démocratique.
Antidémocratique ? Absolument pas, votre honneur.
Je ne demande pas un examen sibyllin et amphigourique, juste quelques notions à connaître afin de ne pas octroyer un droit sans devoir. Du reste, cela ne changerait pas grand chose à la situation actuelle puisque quasiment un français sur deux ne se rend pas aux urnes. L'obligation du vote n'est sûrement pas la solution, cela ne ferait qu'agraver les choses. Avec ce sésame, on réduirait simplement les mauvaises habitudes de l'isoloir. Le Français aime à donner son avis, même quand il n'y connaît rien. En période de championnat de football, nous sommes soixante millions d'entraîneurs potentiels. Un scrutin, c'est un peu pareil : mieux vaut avoir quelques notions des enjeux pour glisser ce bulletin si important dans l'urne. C'est à cette condition qu'on sauvera la démocratie.
30 juin - Gigantisme
Avez-vous remarqué que les voitures deviennent de plus en plus grosses ? Une hypertrophie et une obésité qui concerne tous les modèles, pas seulement les immondes 4x4. La Mini n'a plus de minuscule que le nom. La petite 500 de Fiat devrait s'appeler maintenant la 5000. Et que dire de la Polo, aux faux airs d'une Golf ?
Ce qui est étrange, c'est que tout cela se passe en pleine crise énergétique. On ne parle que d'économies d'énergie, de baisser son chauffage, de mettre en veille nos appareils, de réduire ses déplacements aériens. Là où on devrait montrer l'exemple en concevant des modèles alliant un plus grand espace intérieur à une modestie de formes, où l'on devrait réduire drastiquement le poids et jouer sur le coefficient de pénétration dans l'air, on se retrouve avec des mastodontes aux calandres imposantes comme de véritables camions. Certains 4x4 affichent plus de trois tonnes sur la balance : bientôt il faudra un permis poids lourds pour s'installer au volant de ces excroissances contre-nature.
Si tout cela ne s'appliquait qu'à l'industrie automobile, ce ne serait pas si grave. Le problème, c'est que ce gigantisme s'est glissé un peu partout dans nos sociétés, dans nos vies. Pas que capitalistes : aux pires heures du Stalinisme, l'Urss faisait preuve d'une même démesure – la question énergétique n'était alors pas à l'ordre du jour.
Nous allons vers toujours plus de grandiloquence. Carrefour ouvre le premier hypermarché en 1963, dépassant la superficie des premiers supermarchés qui s'étaient substitués aux épiceries de quartier dès la fin de la guerre (Leclerc transforme son épicerie en libre-service à Landerneau en 1949).
Depuis la superficie de ces véritables métropoles de la consommation n'a cessé de boursoufler. Les premières conséquences sont géographiques : tout comme les usines démesurées qui avaient supplanté les petits ateliers, de tels géants ont besoin de place (surface de vente, parkings à perte de vue, et possibilité aux 38 tonnes de venir les ravitailler). Ils sont immanquablement rejeté à l'extérieur des bourgs, en périphérie des villes, obligeant ainsi l'utilisation de la sacro-sainte voiture. Cette répartition géographique (un endroit où dormir, un où travailler, un où consommer, un pour se distraire) condamne à des transports inutiles.
Il fut un temps où un cinéma était un endroit proposant une seule salle avec un grand écran. Cette époque est définitivement abandonnée avec la fermeture du Gaumont Palace au début des années 70. Depuis les complexes ont remplacé les cinémas de quartier. Encore du gigantisme, encore de la concentration. Grandeur qui va de pair avec moins de convivialité. Une seule salle offre une sorte de communion : des gens différents réunis devant une même œuvre. Mieux : un marché, offrant la diversité de producteurs, permet un brassage, un mélange de population qu'interdit les allées rectilignes d'un hypermarché.
Ces inflations vont de pair avec une globalisation de la société.
Il n'est qu'à voir les constructions de multinationales. Par le biais des rachats, on assiste à un regroupement : le nombre d'enseignes diminue, et même si leurs noms sont encore différents, leur financement est commun. Au moins la chaîne de grande distribution Carrefour a l'honnêteté de nommer ses magasins par le même patronyme. Globalement, on ne compte que 6 grands groupes régissant 16 000 magasins (5 fois plus de supermarchés que d'hypers).
Cette centralisation s'applique à tous les secteurs, pas seulement la grande distribution. A commencer par notre fameuse industrie automobile (groupes Volkswagen, Renault, General Motors, Ford) et s'immisce aussi dans les médias, la presse, la télé, l'industrie des loisirs. Ceci est plus grave car il s'agit là plus seulement de gros sous mais d'une ligne éditoriale ; bref de ce qui nous conditionne à penser. La pensée unique nous guette.
Ces mégapoles asphyxiantes car surpeuplées et surpolluées, où l'humain est écrasé, particulièrement s'il ne possède pas le sésame contre la misère qu'est l'argent, provoquant la seule réponse possible : la violence et la délinquance. Nous avançons vers un futur uniforme et, au final, dépourvu de choix et d'humanité.
23 juin - Quel talent !
A quoi tient le talent, d'où vient le génie ?
Pourquoi certains d'entre nous sont promis à une carrière exceptionnelle et d'autres pas. Biologiquement parlant, il n'existe que d'infimes différences qui ne peuvent expliquer ce grand écart.
Il faut donc se tourner du côté du cerveau, ce grand manitou qui régit nos vies.
Certaines études ont montré que le don inné serait un joli leurre. On ne naît pas doué, on le devient. Ainsi, dans un groupe hétérogène, ceux qui sont déjà doué pour quelque chose auront plus de facilité à développer des aptitudes pour un nouveau domaine.
Là, je pense au comédien Vigo Mortensen, révélé dans le Seigneur des Anneaux. Lisez sa page Wikipedia, vous allez être éberlués : acteur, réalisateur, scénariste, producteur, musicien, photographe, peintre, poète.
Ce CV impressionnant n'est pourtant pas si rare. De nombreux artistes excellent dans plusieurs domaines, en restant dans le milieu artistique. Mais pas que. Le métier d'acteur et de producteur n'ont pas grand chose à voir entre eux. Les animateurs télés qui possèdent leur sociétés allient l'artistique à l'économie pure et simple. Un peu comme si une certaine sensibilité pouvait, devait se réaliser coût que coûte, peu importe le support.
Apparemment, c'est moins le cas dans le sport, même si on constate que certains athlètes ont changé de discipline au début ou à la fin de leur carrière. Trop de spécialisation serait donc néfaste.
Les fameuses études menées sur les personnes douées montrent qu'il s'agit davantage d'un certain état d'esprit, lié à la répétition, au travail, à une certaine volonté et une motivation qui poussent un individu à davantage s'impliquer, à donner de lui-même, y consacrer son temps et son énergie.
Seulement, je parle là, du vrai talent. Même si Mozart jouait dix ou douze heures par jour, il dépasse ses collègues parce qu'il avait quelque chose en plus.
Ce quelque chose qui fait toute la différence, en particulier dans le domaine sportif, ne peut s'apprendre. Nous sommes tous uniques, donc différents. Cette infime singularité fait toute la différence parmi les élus.
On le voit : l'entraînement, une hygiène de vie rigoureuse resserre les écarts de niveau entre athlètes. En athlétisme, natation, cyclisme, tous se situent dans une poignée de secondes, au coude à coude. Là se situe le résultat d'un travail et d'un entraînement méthodiques. Mais, un Usain Bolt, un Merckx, un Phelps remportent les médailles parce qu'ils ont un métabolisme différent. Et ceci, seule la génétique peut l'expliquer.
Marc Batard est un alpiniste hors normes, capable de grimper l'Everest en solo sans oxygène en un temps record. Capable d'endurer des heures et des heures de marche, de supporter des températures inhumaines, de résister aux éléments comme personne. Pourtant Marc possède une silhouette si frêle qu'on craint que le moindre coup de vent ne l'emporte.
Laissons le sport de côté, puisqu'il met avant tout la physiologie de l'individu. Davantage de muscles sera toujours un plus – qui explique la différence de résultats entre les hommes et les femmes.
Pour tous les autres domaines, en particulier l'artistique et le culturel, une certaine propension à l'entraînement permet à tout un chacun d'accéder à une excellence. Ce n'est pas tant un trait génétique qui va se révéler qu'une aptitude, une motivation qui pousse ceux qui en bénéficient à se surpasser.
Cependant, Picasso, Einstein, Hugo ou Beethoven sortent du lot même de l'élite car leur patrimoine génétique fait la différence – en ne jouant que sur trois fois rien.
Cependant cette volonté d'excellence, de dépassement de soi n'est pas réservée à une élite. Tout le monde, à son plus ou moins modeste niveau, peut et doit tendre à donner le meilleur de soi-même. Ne serait-ce que pour les autres, mais avant tout pour s'épanouir dans la fierté de s'élever, physiquement, intellectuellement et surtout, moralement.
Mais ce n'est pas tout. Nombre d'exemples d'écrivains mésestimés, de peintres maudits ou de génies ignorés de leur vivant le prouvent : on a beau être un génie, il faut entrer en résonance avec son époque.
Rien n'est plus vrai dans le domaine artistique. Combien d'artistes ont eu une gloire posthume ?
Etre talentueux, soit, mais d'abord le faire savoir et, surtout, rencontrer son public.
Eiffel ou le Corbusier sont passés à la postérité car ils étaient de leur époque.
Les dirigeants économiques et les politiques encore plus : leurs propos doivent rencontrer des oreilles réceptives. En un mot : une certaine chance est à l'oeuvre. Ceci ne s'applique pas au sport – on peut être très moche, ne pas savoir parler, ne pas être charismatique et remporter des tournois. Toutes les autres disciplines, dépendant fortement du facteur humain, il est inconcevable de réussir si on n'est pas de son époque, si cette relation entre le producteur et le consommateur n'est pas bien établie. C'est sans doute ce que l'on appelle le charisme.
16 juin - De l'avenir des espèces
L'Homme évolue-t-il encore ?
Cette question, je me la suis posé dès que j'ai entendu parler des théories Darwiniennes. Bref résumé du second gros pavé dans la mare de notre ignorance : après la démonstration de l'héliocentrisme et l'âge de l'Univers. Non, tout ne tourne pas autour de nous et le monde a plus que cinq mille ans.
Les neutrinos, ces particules émises par le soleil, traversent l'espace, les planètes elles-mêmes sont incapables de les stopper. Ce bombardement incessant a une conséquence majeure : lors de la duplication de notre ADN, il arrive parfois que des erreurs soient commises. Une mutation. Du reste, le principe de la reproduction sexuée offre, par elle-même, un nouvel être, différent de ses parents – contrairement à un simple clone issu d'une division cellulaire élémentaire.
Cette multiplication des possibilités porte le nom de dérive génétique : il n'y a pas deux humains rigoureusement semblables sur la planète, y compris les jumeaux les plus proches.
Ces mutations peuvent devenir des avantages dans certaines situations. Avoir une plus épaisse couche de graisse pourra, dans les conditions d'un climat plus froid, être un avantage. Ainsi, l'adaptation à son milieu, permet l'évolution. Certains traits spécifiques se généralisent parce qu'ils sont mieux adaptés. Les survivants seuls pourront se reproduire et, à leur tour, transmettre ces changements génétiques à leur descendance. Si une population spécifique se trouve séparée de la population mère, on assistera, à terme, à la création d'une nouvelle espèce, distincte de celle dont elle est issue.
Or il se trouve que ces deux piliers de la théorie de Darwin ne peuvent s'appliquer à l'Humain actuel.
En effet, les échanges de population interdisent la création de toute nouvelle espèce – et cela depuis des dizaines de milliers d'années et le fait que nous adaptons notre environnement à nos envies et nos besoins inverse le processus. A priori, toutes les différences génétiques ont leur chance dans un monde ou, Dieu merci, il n'est pas question que certaines imperfections soient handicapantes. De plus, la réduction du nombre d'enfants d'une seule famille et l 'élimination de la mortalité infantile vont dans le même sens : l'évolution biologique est inopérante.
Du point de vue Darwinien, l'Humain ne peut ainsi plus évoluer. Une caractéristique donnée ne pourra, seule, s'imposer, dominer.
En revanche, le processus de duplication à erreurs continue son chemin. Mais ces mutations n'auront pas plus d'influence sur l'ensemble de la population.
Sauf que nos comportements et nos caractères ne proviennent pas uniquement de nos gènes. La plupart des études sociologiques mettent en avant l'importance cruciale de l'éducation dans une société basée sur les rapports humains.
Là se trouve la seule et unique possibilité d'évolution de l'Homme.
Il n'est de voir les gamins pianoter sur leur smartphone : des attitudes, des gestes nouveaux dont seraient bien incapables d'imiter nos ancêtres... à commencer par moi-même !
Scientifiquement, je doute que ces nouvelles aptitudes cognitives ou gestuelles puissent s'inscrire dans notre patrimoine génétique. Si les enfants reproduisent souvent le schéma parental, effectuant le même métier pu navigant dans les mêmes sphères, c'est avant tout culturel : la génétique n'est pour rien dans une forme de répétition, de mimétisme. On ne connaît mieux le milieu dans lequel on grandit.
Nous avons toute une batterie de gènes qui peuvent coder pour certains comportements. Ainsi, plier sa langue en deux n'est pas donné à tout le monde, accepter de synthétiser le lactose (pouvoir boire du lait sans le vomir immédiatement) non plus. En revanche, les gestes inhérents à nos vies modernes (taper sur un clavier, conduire une voiture...) ne vont pas automatiquement se transmettre par le biais du codage génétique. Ils sont simplement répétés dès le plus jeune âge par mimétisme.
Ainsi la population humaine continue d'évoluer, s'adaptant à un environnement qu'elle a elle-même façonné. Il ne s'agit plus de s'adapter à des changements (climatiques, par exemple, pour rester dans l'actualité), mais de simplement pouvoir se conformer aux techniques, aux us et coutumes qui accompagnent l'évolution de la société – créée par l'homme. Un serpent qui se mord la queue, en quelque sorte.
Ainsi l'idée répandue au XIXème qui voulait que l'Homme n'évolue plus parce qu'il était l'espèce élue, qu'il était l'aboutissement de toutes les espèces menant à lui, toute fausse qu'elle fut, parvient au même résultat : l'Homme n'évolue plus, parce que, biologiquement, cela n'a plus aucun sens.
Evolution n'est pas forcément synonyme de progrès. Encore faut-il s'entendre sur la notion et la définition de progrès. Devenir plus intelligent ? Accéder au bonheur ? Complexifier ? Là encore, rien n'est certain. Selon les plus hautes sommités (je pense au regretté Jay Gould, par exemple), l'évolution naturelle ne s'est pas faite d'une façon linéaire. Elle a connu des périodes d'intense accélération et puis des millénaires de stagnation. Il doit en être de même pour nous. Cependant, certaines études montrent que, par le brassage des populations, le meilleur niveau de santé et de nutrition (même si le sucre et la graisse sont des ennemis de notre santé, ils sont indispensables à notre cerveau, gros consommateur d'énergie), notre patrimoine génétique semblerait connaître une évolution allant s'accélérant depuis quelques siècles. Une évolution débridée, non adaptative puisque, je le répète, tout un chacun possède, à priori, les mêmes chances de survie dans un monde plus confortable. Alors, comment expliquer la réduction de notre boite crânienne depuis l'homme des cavernes ? Peut-être justement par ce maillage humain permettant la spécialisation. Nous dépendons chacun de nous de tous les autres. Rares sont ceux qui peuvent vivre en ne comptant que sur eux-mêmes. La clé du succès de notre espèce réside peut-être dans cette particularité : s'associer, mutualiser, déléguer, former des réseaux multiples. La prochaine étape : y inclure l'intelligence artificielle ?
9 juin - Bonne note
Il est de nouveau question que la France perde un galon dans la notation internationale. Du triple A, nous sommes passés à AA+ et maintenant nous risquons de régresser à AA-.
Noter les pays ! Quelle singulière idée. J'imagine déjà les quelques 190 chefs d'état dans une classe élémentaire ou un amphi, serrant les fesses à l'annonce des résultats.
Pourtant rien d'étonnant dans ce système de notation exagérée.
Ca commence bien sûr à l'école. Quand j'usais mes fonds de pantalon sur les bancs de la communale, il était question de supprimer à la fois les devoirs à la maison, source accrue d'inégalité, et ce système affligeant des notes (zéro à vingt). Encore heureux que je n'ai connu pire : le classement, pratique qui a sévi jusque dans les années cinquante. Rien de tel pour développer cette propension à dominer, écraser l'autre, source de rancoeurs, de vengeances, de mépris.
Un temps les chiffres furent remplacés par des lettres. Comme on le voit dans le cas des notations internationales, ce n'est que changer simplement d'échelle. Je ne vois pas ce qu'un D a de moins traumatisant qu'un deux sur vingt.
Il est, du reste, révélateur que ce chiffrage ne s'applique qu'à l'économie et, plus précisément, à la finance. On ne classe mieux des chiffres que par des lettres. Il serait peut-être plus judicieux d'évaluer le niveau des pays selon d'autres critères : alphabétisation, accès à la culture, liberté d'opinion, système de santé, salubrité publique, indice de bonheur...
Résultat : 50 ans plus tard, les notes et les examens existent toujours à l'école. Et ce n'est pas près de changer. On me rétorquera qu'il faut bien évaluer les élèves, ne serait-ce que pour savoir si les connaissances sont bien entrées dans leurs petites têtes. Mais pourquoi, dans quel but? Mes parents m'ont toujours répété que ce que j'apprenais (ou pas), ce n'était que pour moi, pas pour eux.
Parfois, j'ai l'impression qu'on éduque une armée de petits soldats, bien formatés, bien conditionnés pour s'insérer dans la vie, comme les rouages indispensables au bon fonctionnement de celle-ci.
La reine des fourmis pond des œufs de soldates, d'ouvrières, de bâtisseuses en fonction des besoins de la fourmilière. Et si nous faisions pareil, en fin de compte ?
La société moderne adore jauger, apprécier, mesurer. Vous ne pouvez pas échapper aux fameuses enquêtes de satisfaction. Vous achetez une voiture : on vous demande comment avez-vous été accueilli. Vous êtes pris en charge par n'importe quelle société de service, y compris les administrations (même France Travail propose un formulaire de satisfaction), vous devez vous résoudre à attribuer une note.
Le pire est que cela retombe forcément sur la personne, bien humaine elle, avec qui vous avez eu à faire. Non seulement, c'est presque obligatoire : ne pas répondre équivaut à une mauvaise note pour l'employé, mais vous êtes obligé d'attribuer la meilleure note. Un B ou quatre étoiles au lieu du maximum cinq revient à un camouflet.
Sur internet, c'est devenu la règle. Partout et pour n'importe quoi, les fameuses étoiles sanctionnant la satisfaction des clients. Nous sommes tous, à un moment donné ou à un autre, notés, jaugés, mesurés dans tout ce que nous faisons.
Rien d'étonnant que les pays eux-mêmes soient soumis à pareille humiliation.
2 juin - Personnage publique
Dans la première scène du film « De Gaulle », relatant l'exil de la famille du célèbre grand homme en Juin 1940, on y voit Charles et Yvonne partageant un moment intime.
Je ne sais pas comment ont réagi les admirateurs du Général. On a du mal à imaginer certains individus dans la banalité du quotidien, à plus forte raison les personnages historiques dans leur plus intime intimité.
Jules César devait bien avoir des flatulences, Napoléon déféquer comme un simple soldat, Einstein se brosser les dents.
Les plus hautes fonctions semblent déteindre sur leurs occupants. On imagine mal le Président de la République, même si celui-ci, plus jeune, est moins imposant qu'un De Gaulle ou un Mitterrand, partager le quotidien banal d'une vie de famille. Si voir Chaplin faire sauter sur ses genoux ses enfants ou petits enfants est parfaitement concevable, les images en couleur d'Hitler pouponnant de jeunes enfants sont choquantes.
Tout personnage publique convoque toute une série de comportements dans notre imaginaire. Ce n'est plus l'homme ou la femme qui agit, mais sa représentation.
Rien de plus flagrant lors de l'âge d'or d'Hollywood : ces stars inaccessibles que l'on fabriquait sur mesure en les coupant d'une réalité trop ordinaire, trop commune. Les hommes n'étaient plus des acteurs, mais devenaient des héros, des dieux. Les femmes semblaient sortir de légendes, ne plus appartenir au monde réel. Ils vivaient dans un autre monde, sur une autre planète. Qui pourrait imaginer Greta Garbo passant la serpillière ou Rudolph Valentino faisant les courses. Le cinéma vendait du rêve. Depuis la Nouvelle Vague, il est descendu de son piédestal.
Tous ces caprices de stars n'entrent-ils pas dans la composition d'un personnage extraordinaire? La grandiloquence, la prétention, l'exagération sont forcément de mise. Ceux qui se trouvent sous le feu des projecteurs et dans l'objectif des caméras en jouent.
Claude François alla même jusqu'à cacher son second fils pour préserver son image d'éternel séducteur : un enfant, c'est un accident, deux ça sent la petite vie de famille pépère. Ce n'était pas acceptable pour un chanteur dont le public était majoritairement féminin.
Dans le même registre, les chanteurs Dave ou encore Patrick Juvet ont longtemps caché leur homosexualité ; on les présentait même comme des chanteurs à midinette. De vrais séducteurs hétérosexuels.
Bien sûr la vie d'un grand acteur, d'un chef d'état, d'un patron du CAC40 ou encore d'un sportif en vue est forcément régentée par certaines obligations. Eux ne vivent pas la vie de tout le monde. Ils ne peuvent simplement pas le faire. Mais je reste persuadé qu'en dehors de leurs obligations de représentation, ils aspirent à une vie plus simple – tout comme certains gens humbles et modestes rêvent de vivre dans les plus grands palaces, de ne se déplacer qu'en limousine ou en jet, avoir une armée de domestiques à leur service.
La fonction se substitue souvent au caractère fondamental de la personne. Non seulement, on le voit tel ce qu'il représente, prisme déformant, mais elle modifie aussi en profondeur le comportement de celui ou celle qui l'exerce. Au final, tous finissent par se ressembler. Comme si, en exécutant les mêmes gestes, en vivant les mêmes vies, à côtoyer ses semblables, l'humain endossait les habits, le profil particulier à une profession. Une certaine façon de penser, de réagir face aux événements, conditionné par l'expérience d'un métier.
Tous les flics, tous les politiques, tous les chefs d'entreprise, tous les maçons, tous les astronautes, parce qu'ils partagent les mêmes milieux, les mêmes conditions d'existence, parce qu'ils doivent régler les mêmes problèmes, ont les mêmes joies, utilisent les mêmes objets et machines, jouent avec les mêmes concepts, finissent par modeler leur cerveau sur le même canevas.
Ainsi, il est particulièrement difficile de faire évoluer les choses au sein même d'une corporation. Cette inertie tient au fait qu'avant d'atteindre un niveau de responsabilité donné, on passe beaucoup de temps dans le même bain. Rien n'est plus vrai en politique.
Imaginons un jeune homme ou une jeune femme porteur de nouvelles idées, sans concession, pur comme de l'eau de roche, radical.
Pour se faire élire dans une modeste commune, il devra déjà composer avec des alliés ne partageant pas entièrement ses vues. Ou bien disparaître de l'échiquier. Et ainsi de suite : députation, portefeuille dans un ministère, puis ministre. Quand il se présente aux plus hautes fonctions, il aura forcément mis de l'eau dans son vin, composé et négocié, parfois à tel point qu'il ne restera que peu de la fougue et de l'innocence originelles.
Il voulait changer le monde ; c'est le monde qui a finit par le changer.
Aux urnes, citoyens ! (26 mai)
Comme à chaque nouveau rendez-vous électoral, je me pose quelques questions sur le bon sens et l'entendement humain. Cela sent la bêtise faite humaine, autant de la part des candidats, trop sûrs d'eux, n'hésitant pas à promettre la lune pour quelques voix, et surtout rabaisser son voisin, rejeter la faute sur les autres pour s'auréoler d'une virginité de communiante, à la veille d'obtenir un précieux fauteuil d'hémicycle que des journalistes, pas bien plus futés, à la recherche, eux, du bon mot, de la petite phrase qui sera reprise par la presse, montée en épingle, gage d'un meilleure audience. Les premiers cherchent une parcelle de pouvoir, les seconds une reconnaissance. Les deux, résolument dans la stupide séduction de ceux qui veulent s'approprier l'amour de son prochain sans rien donner en échange.
Je ne sais pas si c'est le fait de devenir vieux, mais cette fois j'avoue que je ne comprends pas tout.
Souvent, j'entends le prétexte de ceux qui s'abstiennent : aucun candidat ne trouve grâce à leurs yeux. Cette fois au moins, aucune excuse recevable. Il y a pas moins de 38 listes proposées !
Je n'ai pas prit le temps de vérifier, mais je suppose que l'on atteint ici un record, année olympique oblige.
38 listes, ça donne aux petits villages de la campagne (ces étendues non urbanisées et non cette foire d'empoigne médiatique qui fait passer le plus acharné des camelots ou vendeurs de voitures d'occasion pour de tendres jouvenceaux) un air de tir à la foire foraine : 38 panneaux pour l'affiche réglementaire. Certaines communes ont dû bricoler, dans l'urgence, des substituts en contreplaqué, certains utilisant des bâches. C'est joli à voir. Pas commun. De l'art électoral en quelque sorte.
38 listes pour une élection qui est le dernier des soucis des français. En cela, ils ont tort, une fois de plus. Un député européen aura plus d'influence sur notre quotidien qu'un député national : la plupart des décisions concernant nos vies se prenant à Bruxelles. Le français moyen a si peu la fibre européenne qu'on trouve même, parmi la multitude des candidats en lice, une liste anti-européenne. Un peu comme un végan qui postulerait comme apprenti boucher.
Je me suis pris au jeu. 38 listes, 81 candidats sur chacune, cela équivaut à une gentille petite ville de plus de trois mille âmes. Soit largement plus que d'électeurs, tout comme on a l'habitude d'assurer, en plaisantant toutefois, qu'il y a plus de romanciers que de lecteurs.
38 listes, cela veut dire aussi beaucoup de déçus au soir du dépouillement. Au vu des premiers sondages, seules 7 ou 8 listes dépasseraient la barre de rattrapage financier des 5%.
Avec l'une d'entre elles, crédité d'un tiers des bulletins. Pas la plus glorieuse, ni la plus élégante, la plus subtile ou même la plus intelligente. Un tiers des intentions de vote, ça me fait penser au journal l'Equipe. Des dizaines et des dizaines de sports et la moitié des pages, au minimum, consacrées au seul Dieu Football.
Là réside le paradoxe : tout le monde se plaint du manque de diversité dans le monde politique (tous pourris!) et pourtant, sur ces 38 listes, une bonne trentaine ne dépassera pas les 1%.
19 Mai - Incompréhensible
J'ai étudié, j'ai lu, j'ai vécu. Et pourtant il existe encore des choses que je ne m'explique pas. J'ai beau chercher, je ne trouve pas.
Petit florilège des comportements humains restés incompréhensibles à mon entendement.
Depuis ce nouveau siècle, on parle de plus en plus des violences à caractère sexuel et c'est une bonne chose. On ne compte plus les scandales comme si c'était une chose commune. Or, comment peut-on trouver du plaisir à n'en pas donner ?
L'acte d'amour est la communion ultime où, comme au tennis, il faut être deux pour se renvoyer la balle. Prendre de force ou contre le gré du partenaire, c'est taper dans la balle pour la voir s'éloigner à tout jamais. Mon plaisir est plus qu'à moitié de faire plaisir. A Noël, la joie est autant d'offrir que de recevoir. Comment peut-on jouir si l'autre souffre ? Spécialement dans ces instants les plus tendres où les corps s'entremêlent et, autant que possible, les esprits aussi. Ceux et celles (nettement moins nombreuses) qui trouvent du plaisir sans échange véritable doivent être bien malheureux. Et bien seuls.
Réminiscence d'un passé immergé dans la nature, nous avons besoin d'animaux domestiques près de nous. Là encore, je croise parfois des propriétaires de chiens (ça fonctionne moins avec les chats) qui n'arrêtent pas de gueuler sur leur compagnon. Ils ronchonnent sans arrêt. Pourquoi avoir un chien, alors, si c'est pour s'y passer les nerfs ? Peut-être, justement, pour cette seule (mauvaise) raison.
Perchée au sommet de la colline, cette famille a fait bâtir une superbe villa pour profiter de la vue incomparable qu'on ne peut s'offrir en demeurant en plein centre ville. Et tout ça pour l'entourer d'une palissade de deux mètres cinquante !
Autre comportement particulièrement incompréhensible dans ces temps de chasse aux émissions de co² : utiliser sa voiture, généralement un gros 4x4 bien polluant, pour simplement aller chercher le pain. Et surtout, se plaindre ensuite du prix du carburant.
Tout aussi grave : cette propension, lors des rendez-vous électoraux, à voter contre. En principe, le but du jeu est de choisir un représentant en fonction du projet qu'il propose, sur son programme, ses idées, de sa volonté de faire quelque chose pour la cité, la région, le pays. Pour quelle raison voter si c'est pour empêcher l'autre ? A ce petit jeu, on risque simplement de faire élire le pire de tous.
Je fais des efforts pour parvenir à me mettre à la place des autres et leurs comportements visiblement obscurs, mais il y a une chose que je ne comprendrai jamais : cette propension à perdre sa vie à la gagner. A courir après quelque chose d'inaccessible, comme chercher à traverser l'arc-en-ciel ou toucher l'horizon. Gâcher son temps pour un éventuel avenir meilleur... qui ne viendra jamais. Une antique réminiscence du concept tout religieux qui offre une vie meilleure, un paradis, après la mort. C'est bien pratique pour se résoudre à la médiocrité de sa vie actuelle.
12 Mai - Un peu de fantaisie
Depuis que la science s'est mis en tête de vouloir découvrir la vérité sur absolument tout, la part de notre imaginaire ne cesse de reculer. Pragmatisme et cartésien sont devenus les maîtres mots du monde moderne, avec leur corollaire : efficacité et rendement.
Nous cherchons depuis l'aube des temps à affiner notre appréhension de notre environnement, proche ou lointain, minuscule ou gigantesque. Nous y parvenons, pas à pas. En nous trompant souvent, en nous approchant irrésistiblement de LA vérité. Mais peut-on seulement la toucher ?
C'est bien. C'est très bien. De tout rationaliser, d'avoir une explication à tout. Mieux se connaître pour mieux se comprendre.
Pourtant j'en viens à regretter parfois cette innocence, cette croyance que l'on substitue à la connaissance. La physique quantique a remplacé les démons et les lutins. Est-ce une si bonne chose ?
Le règne de la publicité et l'avalanche d'informations sans fin, la psychologie et les sciences humaines ont remplacé la religion et le surnaturel.
L'empirisme et le concret finissent par réduire notre imagination. Tout doit être précis, réel, rentable. Rien n'est laissé au hasard, pire : rien à l'imaginaire. Même les enfants ne peuvent plus rêver, ne savent plus. Il faut se résoudre à la réalité, si banale et affligeante soit-elle. Et ne jamais s'écarter d'un chemin si bien balisé qu'aucune alternative n'est désormais possible.
Cependant, l'art sans imagination est à la vie ce qu'un vulgaire papier peint est à une toile de maître, un moule à tarte à un buste grec. Même dans la vie de tous les jours, un peu de fantaisie permet de grandes avancées. A commencer par soi-même. S'évader dans son propre monde, c'est reprendre le contrôle sur sa vie. Se reconstruire, à l'abri des vicissitudes du monde social. Si nous sommes des animaux grégaires, nous avons aussi besoin d'un jardin secret, une certaine folie pour épanouir notre trop grand cerveau. Nos connexions neuronales dépassent largement nos besoins quotidiens. Sans imagination, sans rêve, sans création notre ordinateur central se grippe, se rouille. Il s'encroûte dans la banalité quotidienne.
Il est bon, il est même capital de faire tourner la machine afin qu'elle garde toutes ses capacités. Privilégier les envies aux besoins. Donner une chance à l'irrationnel, l'extravagant, voire l'absurde. Oser être différent. Vivre en marge. Et surtout garder un regard décalé sur le monde. Le voir tel qu'il pourrait être et non seulement tel qu'il est.
5 mai - Reprendre le contrôle
Si ça continue comme ça, bientôt nous aurons l'intelligence d'un poulpe.
Je viens d'acquérir une nouvelle voiture. Plus besoin d'allumer les phares : un capteur les active dès que la luminosité est trop faible. Les essuie-glaces s'enclenchent à la première goutte sur le pare-brise. Inutile de se tordre le cou lors des marche-arrière : la caméra de recul permet d'avoir des yeux dans le dos. Il y a même un bouton, que j'ai d'abord confondu avec le plafonnier, appuyant dessus par mégarde : je suis tombé sur l'assistance ! Impossible de le désactiver : il est automatiquement composé lors d'un accident...
Ca avait commencé il y a quelque temps avec l'ouverture automatique et centralisée des portes (qui m'a permis de me retrouver un beau soir d'Août, en caleçon t-shirt, enfermé dehors en pleine nature Pyrénéenne), les vitres et rétroviseurs électriques, la direction assistée.
Assisté, c'est bien le mot.
Depuis l'invention du rasoir électrique, nous sommes considérés comme des êtres souffrant de pathologies incurables. En voulant nous simplifier la vie au nom d'un certain confort, on nous la complique ouvertement.
Scène à la boulangerie :
« - Une tourte de campagne s'il vous plait.
Vous désirez que je vous la tranche ?
Non, merci. Je tiens encore à décider de leur épaisseur moi-même. »
Cette propension à nous venir en aide n'est malheureusement pas dénué de tout intérêt. La boulangère sait très bien qu'elle facturera la découpe de son pain, les constructeurs automobiles peuvent gonfler leur prix et, accessoirement, en font un argument de vente. Car nous sommes demandeurs de ces gadgets censés nous faciliter la vie.
Plus personne n'utilise de faux ; même pour dix mètres carrés de pelouse, il nous faut une tondeuse. Bruit et mauvaises odeurs d'échappement garantis.
Nous n'avons apparemment plus la force (ou la volonté?) d'ouvrir nos volets et nos portails nous mêmes : ils sont électrifiés. Je ne parle même pas des patinettes et vélo à assistance électrique.
Assistance. Le terrible et cruel mot. Car, ce confort se paie au prix cher : nous perdons le contrôle sur notre vie, sur notre corps. Pire : nous perdons le sens de nos responsabilités.
L'effort, la souffrance (dans une certaine mesure s'entend) sont tout aussi profitables que la douleur. Sans nos nerfs sensitifs qui nous préviennent qu'il y a blessure ou dysfonctionnement quelque part, nous pourrions aller au devant de graves ennuis. Cela s'appelle ICD, l'insensibilité congénitale à la douleur.
D'une manière générale, toute la technologie vise à nous faire lâcher prise avec notre environnement et notre corps.
Dorénavant, on parle d'intelligence artificielle. Les machines prendraient-elles le dessus ? Bonjour Terminator.
Il n'y a rien qui ne me mette davantage hors de moi que ce traitement de texte qui écrit un autre mot que celui que je tape sur mon clavier. C'est pour cette raison que je n'envoie pas de SMS. Si j'ai envie de faire une faute d'orthographe volontairement, c'est mon problème après tout.
Autre biais : le dictionnaire des synonymes intégré au logiciel. Très pratique. Seulement terriblement débilitant. Taper sur une touche plutôt que prendre une minute pour trouver le bon mot dans sa mémoire, c'est certes facile mais cela nous rapproche chaque jour un peu plus du légume. On s'étonne ensuite de nos déficiences intellectuelles. Le cerveau est un muscle : il doit s'entraîner régulièrement, ne pas se laisser déborder par les assistances de tout poil, au risque de se gangrener.
Car toutes ces garanties prolongées, ces assurances pour le moindre de nos gestes ne sont que les moindres maux d'une société en perte de repères humains. Le réel problème vise à notre pensée. Dès que l'on se met à penser à notre place, il y a danger. Regardez un peu les chaînes infos : elles ne procèdent pas autrement que les spots de publicités. Nous conditionner. Au secours, George Orwell !
Pourtant il existe des petits gestes simples qui peuvent nous rendre l'autonomie que nous avons perdue.
Commencer par des réactions toutes simples : ne pas prendre votre voiture pour aller chercher le pain – un ou deux kilomètres à pied ou en vélo (à assistance musculaire : c'est tout plat jusqu'au centre ville) n'ont jamais tué personne. Jeter les marque-page dans vos lectures : vous pouvez quand même vous souvenir d'un nombre (le numéro de la page en cours) d'une séance de lecture à l'autre.
Amusez-vous à réapprendre par cœur les trois ou quatre numéros de téléphone les plus utilisés, même s'ils sont enregistrés dans le répertoire.
Retrouvez le geste élégant du maniement de la faux, au pire il existe des tondeuses mécaniques, silencieuses et non polluantes.
Essayez lorsque cela est possible de retrouver le geste précis et s'apparentant au dessin lors de l'écriture : chaque lettre manuscrite de l'alphabet demande une dextérité différente, au contraire du clavier où est résumé le même geste basique du doigt qui tape.
Prenez le temps de lire un article en entier et non plus vous contentez des titres, forcément réducteurs et souvent empreints de sensationnalisme (= la publicité du journaliste). Reprenez le contrôle de votre corps, de votre volonté, de vos désirs. De votre vie.
28 Avril - Savoir Vivre
Il existe deux façons d'aborder la vie, ses joies et ses vicissitudes.
On peut éviter les embûches en gardant une certaine distance par rapport aux choses et aux êtres. Ne jamais réellement s'impliquer totalement dans ce que l'on fait et, surtout, dans ce que l'on ressent. Ne pas aller au fond des choses, rester en surface. Ne pas plonger dans la passion destructrice et énergivore. On atteint au plus haut degré cette philosophie dans les couvents et monastères, en particulier chez les moines bouddhistes adeptes du jaïnisme (éviter d'ouvrir la bouche de peur d'avaler un insecte et regarder où l'on met les pieds pour ne pas en écraser un seul). Ces hommes et ces femmes qui ont décidé de se retirer du monde, de vivre en dehors, en marge. S'accomplir dans et par la méditation et la prière. Eviter de trop interagir avec son milieu. Et ne pas parler. Refuser ce qui est le socle de notre espèce, le langage. Rester autonome en toutes circonstances. Cela rend plus fort, davantage maître de soi. On doit parvenir à se diriger soi-même.
Notre volonté actuelle de limiter notre empreinte carbone ne procède pas d'autre chose : faire preuve de discrétion, d'humilité, de modestie dans nos comportements énergétiques. Rester dans les limites. Cantonner nos ambitions pour ne pas nuire aux autres. Vivre une vie non pas de privations, mais sans excès.
Mais quel ennui !
L'autre option est de profiter et faire profiter du moindre moment. Se lancer sans filet dans les joies et les plaisirs de l'existence. Brûler sa vie pour en faire un chef d'oeuvre. Et surtout ne pas hésiter à entrer en relation avec les autres. Vivre ses passions au grand jour, ne se priver de rien qui puisse apporter du bonheur immédiat. La vie est trop courte pour n'en gâcher ne serait-ce qu'une minute. Entre hédonisme et épicurisme, savoir savourer chaque instant. Utiliser au maximum tous nos sens. Ne jamais se retenir, se brider. Foncer dans chacune de nos entreprises, quitte à s'y brûler les ailes et rebondir sans jamais s'arrêter. Nous aurons toute la mort pour nous reposer (Georges Moustaki). Prendre des risques, mais au moins avoir la sensation d'avoir vécu. Avoir été acteur et non seulement spectateur de sa vie.
Bien sûr cela a un coût. A trop vouloir donner, on prend beaucoup aussi. L'environnement, qu'il soit naturel ou social, peut-il supporter une telle exubérance ? A vivre comme une pile électrique, on risque de s'y brûler les ailes mais aussi provoquer des dommages collatéraux. Tous nos excès, s'ils font le bonheur autour de nous, peuvent aussi être durs à supporter. Souvenez-vous du personnage incarné par Yves Montand dans les films de Claude Sautet : toujours en représentation, peut-être un brin superficiel, mais finalement bien seul.
Une fois encore, ces deux extrêmes ne sont pas souhaitables. Tout l'art de vivre consiste à trouver le juste équilibre entre les deux.
Savoir profiter de ce qu'offre la vie : les gens, les lieux, les circonstances, tout en restant maître de soi sans jamais se laisser dépasser par les événements ou les sensations, ces petites drogues, douces ou dures, qui rythment notre vie.
Nous avons tous une drogue, une passion dans nos vies. Parfois plusieurs. Elles sont chimiques, sportives, liées à l'ambition, à la réussite, à l'argent, au sexe. Le challenge est de savoir les savourer en gardant l'emprise.
21 Avril - Toute Première Fois
Plus on avance dans la vie, plus le temps passe vite.
Chacun a déjà remarqué cette évidence.
Il semblerait que deux faits expliquent ce phénomène.
D'une part, notre appréciation du temps.
Le temps n'est pas linéaire dans notre rapport à lui. Ainsi une journée d'hôpital semblera toujours plus longue qu'une semaine de vacances dans un endroit de rêve. D'autre part, à cinq ans, une année représente vingt pour cent de toute notre vie. C'est beaucoup. A cinquante ans, ce n'est déjà plus que deux pour cent.
Mais ce qui détermine réellement notre fausse évaluation du temps, c'est bien la façon dont nous utilisons ce temps.
Contrairement à ce que l'on peut penser à priori, ce n'est pas la répétition, l'habitude, la routine qui allonge les journées. Cela les rend certes ennuyeuses mais n'a aucune influence sur leur durée ressentie. Des journées qui se ressemblent en viennent à se confondre.
Pour exemple, quand nous partons en vacances, changeant nos habitudes, découvrant de nouvelles têtes, de nouveaux paysages, bousculant notre emploi du temps. Il semble que les journées s'allongent démesurément. En revanche, lorsqu'il est temps de rentrer pour reprendre sa vie habituelle, le temps s'accélère comme pour donner des regrets de quitter ce petit paradis. Il n'y a aucune intention là dedans.
En changeant notre mode de vie, nous changeons notre rapport au temps dans les premiers jours. L'inédit, la nouveauté marquent davantage nos sensations. On vit plus. Toutefois, ce nouvel emploi du temps en vient à se répéter lui-même au bout de quelques jours : nous substituons une nouvelle routine à l'ancienne. Le temps se raccourcit alors.
Pourquoi le temps semble s'allonger lorsqu'on emploie ses journées différemment ? Tout simplement parce que nous éprouvons une chose qui arrive quasiment chaque jour dans notre enfance : nous vivons des premières fois.
Il est plus facile de se souvenir d'un jour précis lorsqu'il s'est passé quelque chose d'unique. Chacun se souvient précisément ce qu'il faisait le 11 septembre 2001 vers 16h. En revanche, il sera quasiment impossible de préciser un détail de n'importe quel jour du mois passé. Tout le monde se souvient de son mariage, de la mort d'un être proche, d'avoir remporté une compétition, avoir visité tel grand musée ou parcouru les ruelles d'une cité légendaire.
Ces premières fois tendent forcément à diminuer au fil des ans. Nous ne faisons que répéter inlassablement toujours les mêmes gestes, prononcer les mêmes paroles, croiser les mêmes personnes, réagir de la même façon. Ainsi, un « bonjour » en vient à ne plus être qu'une formule de politesse que l'on profère par réflexe sans y penser réellement. Quand vous saluez votre voisin, vos collègues, désirez vous réellement ce que vous leur souhaitez ?
Afin de ralentir ce rapport au temps et, peut-être, y trouver la clé du bonheur, il serait bon de multiplier ces premières fois. Pas facile.
Lorsqu'on commence le vélo, l'équitation ou à nager, il y a une émotion particulière que l'on ne retrouvera plus par la suite. Cela fonctionne de la même manière, malheureusement, dans les relations amoureuses. On finit par s'habituer, par ne plus faire attention. Exactement comme le « bonjour » prononcé sans y penser chaque matin.
En couple, avez-vous un côté du lit bien à vous ? Une place assignée à table ? Le matin, enfilez-vous toujours vos chaussettes en commençant par le même pied ?
Toutes ces habitudes forment un ensemble de gestes qui effacent forcément les Premières Fois. Car, il est bien entendu impossible d'effectuer les gestes habituels de la vie quotidienne d'une manière inédite à chaque fois. Mais commencer par détruire les mauvaises habitudes : chambouler de temps en temps notre quotidien, lui donner du contraste à défau d'imprévu. Un restaurant improvisé, changer d'adresse pour ses courses, réaménager son intérieur de temps en temps. Moins facile : parvenir à changer de boulot (ou en dénicher un qui élimine la routine), séduire à nouveau son compagnon ou sa compagne, aborder des inconnus dans la rue sous n'importe quel prétexte. Attention toutefois à ne pas tomber dans l'excès inverse : en multipliant les nouvelles expériences, on risque de mettre en place de nouvelles habitudes.
En résumé, pour vivre pleinement, il convient de vivre chaque journée comme si c'était la première. S'étonner de tout, être curieux, profiter au maximum de n'importe quelle situation. Ressentir plus profondément les moindres détails ; à commencer par savoir les remarquer. Une forme de nuage bizarre, la démarche chaloupée de cet homme sur le trottoir d'en face, un chien qui semble perdu, le reflet du soleil dans la vitrine offrant un mini arc-en-ciel...
Et surtout : en faire profiter les autres. Ne pas hésiter à rendre service, toujours sourire, même dans les situations les plus cocasses. Un sourire donné ne risque que d'en récolter un en retour. C'est agréable, à défaut de ralentir le temps.
Mais il faudrait aussi, dans le même temps, vivre chaque journée comme si c'était la dernière. Que feriez-vous si vous vous saviez condamné ? En appliquant cette théorie toute simple, vous vous apercevrez que vous réagiriez différemment, que vous apporteriez davantage de vous dans ce que vous faites. S'impliquer davantage. Que vous « bonjours » seront plus lourd de sens. Votre regard sur les choses et les gens sera plus profond, plus intense, plus généreux. Votre vie gagnera en contrastes, en profondeur. Au final, il se peut que vous multipliez ces merveilleuses Premières Fois salutaires.
C'est peut-être le début du bonheur.
14 Avril - l'Echelle des salaires
Pour qui travaillez-vous ?
Pour votre patron, votre entreprise, votre société, votre hiérarchie ? Perdu. Même si ça en a les apparences à première vue. A première vue seulement. Une simple réflexion suffit pour battre en brèche cette assertion.
Alors pour vous-mêmes, pour rapporter un chèque à la fin du mois. Pas encore ça, même si, intrinsèquement, cela va de soi : si l'on s'obstine à passer le quart de son temps dans un lieu imposé à faire des choses exigées, c'est bien pour se permettre de vivre le reste du temps. Douloureux dilemme : subir le tiers de sa vie pour profiter d'un second tiers – le troisième étant réservé au sommeil.
Alors, pour qui ?
Les autres, tout simplement.
Chacun œuvre à faciliter, parfois améliorer la vie des autres (un ensemble que l'on appelle la société). Santé, enseignement, services, transports sans oublier ceux et celles qui nous nourrissent ou fabriquent ces quantités astronomiques d'objets dont nous raffolons.
Partant de cette définition, il est aisé de repérer les métiers qui n'en sont pas vraiment : les professions nuisibles. Celles qui n'apportent rien à la communauté. Pire : qui lui sont néfastes. Ainsi tout le secteur de la publicité, du conditionnement, du marketing. Qui soutiennent le Grand Tout qui entend bien nous marchandiser au mieux.
Autres secteurs : la banque et plus précisément la finance, l'armée et la police dans certaines façons de faire.
Finalement, n'importe quel métier peut être considéré comme nuisible selon la façon dont il est effectué.
Un paysan bio, petite structure, ayant l'amour de son métier et la volonté de bien faire son travail est non seulement utile, mais indispensable. En revanche, un responsable d'entreprise agricole, gérant rien moins qu'un bataillon de tracteurs, pulvérisant herbicides et pesticides à tout va, concentrant des milliers de têtes de bétail dans des locaux relevant davantage du camp de concentration que d'un label de qualité quelconque, ne fait plus le même métier. Il produit. En l'occurrence de la merde dixit feu Jean Pierre Coffe. Il n'est plus utile, c'est un empoisonneur.
Dans un métier, il y a deux facettes. D'abord, comme on vient de le voir succinctement, cette faculté à rendre service à son prochain – un professeur, un médecin, un pompier, voire même un laveur de carreaux ou un ramasseur de poubelles, sont indispensables au bon fonctionnement de l'ensemble. Il n'y a pas débat là-dessus. Encore faut-il qu'ils puissent exercer leur profession dans de bonnes conditions, à la fois pour la communauté – les problèmes que rencontre notre système de santé est révélateur : moins de personnel pour davantage de patients, ça ne peut que réduire leur bien-être, à la fois au personnel médical et au malade. Ainsi doit se combiner une action utile, voire indispensable pour le bien de la société mais aussi un cadre d'activité correct, si possible épanouissant pour celui qui y bosse.
Là, le bas blesse depuis quelques décennies. Les conditions de travail ne font que se dégrader d'année en année.
Marc Veyrat est un chef trois étoiles. Il a réouvert son restaurant au cœur de sa Savoie natale, dans un cadre enchanteur et démocratise sa carte : de 400 euros le menu, il passe à 130. On applaudit à tout rompre de cette initiative moins élitiste. Comment fait-il ? Il ne change rien aux ingrédients de son menu, mais réduit de 50 à 14 le personnel pour une salle de 40 couverts.
Vous allez me dire que 50 personnes pour en servir 40 c'est un peu exagéré. Certes. Mais ceci est un exemple parlant. Car, s'il veut baisser encore le prix de son assiette, il pourra demander à 5 ou 6 personnes de bosser (en conditions d'esclavage) pour satisfaire (mal) 40 clients.
Jusque là, nous n'avons pas parlé salaires.
Mon père affirmait toujours qu'il comprenait la différence de rémunération selon divers critères mais, qu'une fois à la retraite, chacun ayant à priori les mêmes besoins, tout le monde devrait toucher la même solde.
Je vais plus loin en ne comprenant pas pourquoi cette différence de salaire existe. Pas même ces ahurissants rapports de 1 à 20 qui soufflait cette réplique à Claude Lelouch dans un de ses films :
Charles, combien je vous paye en tant que chauffeur particulier ?
Un peu plus de mille euros mensuels, monsieur le Président Directeur général.
Ah, tout de même... En bref, vous gagnez quasiment autant que moi, alors.
Monsieur le Président plaisante, je suppose.
Non, je voulais dire : TOUS mes employés gagnent ensemble presque autant que moi.
En fonction de quoi, sur quels critères détermine-t-on qu'une fonction doit être plus rémunératrice qu'une autre ?
Par expérience, je sais que c'est ou tout l'un ou tout l'autre. Plus le travail est intéressant, mieux il est payé et plus on y est considéré, respecté.
Au contraire, le salaire devrait permettre de réduire les inégalités de traitement dans le labeur. Pour en atténuer la pénibilité, les contraintes d'horaires (un cheminot « roulant » gagnait davantage qu'un chef de gare, sédentaire), les dégradations physiques liées aux risques sanitaires. Pour permettre, si besoin est, à une personne exposée à des produits chimiques, à des gestes répétitifs (source de pathologies ultérieures), à des risques sur leur vie (policiers, pompiers) de travailler moins ou moins longtemps.
Mais, l'on constate, au contraire, que plus on grimpe dans l'échelle sociale et plus le métier devient intéressant, plus gros sera le chèque. Jusqu'à cette aberration que les seuls actionnaires, ceux qui ne se salissent pas et ne font rien d'autre que faire travailler leur argent à leur place sont les grands gagnants de cette loterie truquée.
Alors, pourquoi ces écarts de salaire si important ?
On me parle de responsabilité. En quoi un haut cadre est davantage responsable qu'un simple tourneur ? Il chapeaute plus de personnes, prend les décisions à leur place, mais si le tourneur rate sa pièce, c'est aussi grave. Juste moins impliqué dans le budget de l'entreprise (il ne s'agira que de quelques pièces). Alors on en vient à cette échelle très parlante dans un système libéral : plus on rapporte de richesse à l'entreprise, plus on est rémunéré. Ca se tient.
Faites le test : ne vous demandez pas combien vous coûtez à votre entreprise mais plutôt combien vous lui rapportez. J'aime assez cette utopique idée de salaire, en divisant ce chiffre (ce que nous rapportons à notre société privée – ou à la collectivité, plus difficile à chiffrer, il est vrai) en quatre parts égales : 25% de salaire pur, 25% d'impôts (comprenant toutes les taxes, tva et prélèvements sociaux inclus), 25% investis dans l'entreprise et 25% accordés à l'employé pour un investissement à l'aune de son choix. On peut difficilement faire plus libéral, n'est-ce pas ? Ce système bénéficie à chacun... sauf aux actionnaires (ceux qui ne mettent pas la main à la pâte) auxquels on aurait tout simplement substitué ceux qui oeuvrent pour le bien de la communauté. L'entreprise appartenant in fine à ceux qui la font tourner.
Pour résumer, celui qui rapporte le plus d'argent à l'entreprise serait celui qui gagne le plus. C'est bien. Seulement comment déterminer QUI rapporte le plus ? Celui qui donne des ordres, imagine un concept, dirige une équipe ou, plus simplement, celui qui se contente de fabriquer au mieux, celui qui suit les ordres donnés, et pourquoi pas celui qui vide les poubelles sans lequel se serait vite le chaos total.
Je suis partisan acharné du bien être dans son travail, à commencer donc par supprimer ce terme, issu d'un instrument de torture au moyen-âge (et dont le sens premier est conservé quand on prétend que le bois travaille – qu'il se déforme).
Un métier, oui. Un travail, non.
Une activité nécessitant un savoir, un savoir-faire, la recherche du bon geste, du beau geste, l'amour du labeur bien fait et dans de bonnes conditions. Un emploi dont on est fier, dans lequel on peut s'épanouir, se dépasser et surtout, pouvoir le transmettre à son tour une fois qu'on le maîtrise.
Ainsi, la valeur (et non plus le prix) du salaire irait de pair avec le métier exercé. Le fameux chèque de fin de mois ne serait qu'une rectification des difficultés (corvées) rencontrées. Une indemnisation face à la fatigue, la salissure, l'exposition, la dangerosité.
A terme, la grande idée serait d'abolir le principe de l'argent. Mais ceci est un autre débat.
7 AVril - l'image
La conscience de soi-même peut être simplement démontrée par le test du miroir. Seule une dizaine d'espèces animales sont capables de se reconnaître dans leur reflet. L'homme, lui, a érigé cette image en une ombre qui ne le quitte plus désormais. Qui est, peut-être même, le fondement de sa différentiation.
Cela commence par le rêve. Certes, nous ne sommes pas les seuls à rêver, quantité d'animaux le font. Mais en ont-ils conscience ? Du moment où l'humain comprend qu'il peut se dédoubler, sortir de son enveloppe corporelle pour évoluer dans d'autres sphères, être lui-même, du moins une représentation de lui, pendant son sommeil, il peut imaginer que la mort n'est plus cette fin biologique. Qu'il y a autre chose. Après. Ailleurs.
Dès lors, sapiens va enterrer ses morts, leur vouer un culte. S'il a compris (et admis) que le corps devient inerte et se décompose, il ne peut se résoudre à penser que cette conscience que l'on peut nommer âme soit définitivement hors d'usage.
Ainsi naissent les religions, les mythologies, les contes et les légendes. Se raconter, se projeter, se dédoubler.
Le langage ne procède pas d'autre chose. Et l'art. Pouvoir représenter par le dessin, l'image ou l'écriture, la vie bien réelle, en faire une copie, qu'il peut, à volonté, transformer, sublimer.
Cette image de l'objet n'est plus tout à fait l'objet lui-même. C'est sa représentation sans l'espace et, surtout, dans le temps. L'humain vient d'inventer l'immortalité des représentations. Une image définitive. L'art, l'écriture vont dépasser les siècles. L'humain devient immortel.
Cette manie provient de la dimension extraordinaire de son cerveau (dont on n'utilise peut-être qu'à peine dix pour cent). Ainsi, l'émotion et les sentiments permettant l'invention de l'Art, sont également déclencheurs d'intentions nettement moins pacifiques. Son (trop) gros cerveau nous sert à la fois à répandre le bien mais aussi (et surtout) à distiller, à diffuser le mal. Amour et haine sont les deux faces de ces connexions neuronales.
D'autre part, en s'élevant au-dessus de lui-même, il se détache de sa nature foncièrement terrestre. Sa programmation génétique laisse de plus en plus de place à l'apprentissage, à la culture.
Il croit qu'il n'appartient plus à son milieu, qu'il peut le régenter, tout comme il maîtrise les images du monde qui l'entoure. Ainsi naît la culture, cet ensemble d'enseignements qu'il se transmet par la parole, plutôt que son état naturel qu'il hérite par ses gênes.
Pour se délivrer des contraintes naturelles, il va penser à la dominer, à s'ériger au-dessus des éléments, du monde, de la nature. Il n'en faut pas plus pour qu'il se substitue à elle. Il va dompter toutes les autres espèces, y compris la sienne.
Ces images mentales le poussent jusqu'à trafiquer ses paroles en mensonges, faux-semblants et dissimulation, afin de jouer avec cette représentation langagière qui fera naître une conscience plus aiguë, plus fine, mais aussi plus dangereuse pour les autres et lui-même. Les névroses, psychoses ne relèvent de rien d'autre que cette emprise de la représentation, du symbolique.
Cette distanciation permet de jolis résultats. Sans elle, pas d'art, pas d'humour.
Depuis plus d'un siècle, les écrans ont envahi notre vie quotidienne. La société du spectacle écrivait Guy Debord. Plus que jamais nous devons vivre avec nos semblables et leur représentation – qui ne correspondent pas toujours entre elles. A tel point que la vérité ne passe-t-elle pas par sa représentation ? La meilleure preuve n'en est-elle pas son image ?
Plus grave : la virtualité serait une nouvelle dérive à cette envie de dédoublement. Pour en arriver, à terme, à n'être plus que notre propre représentation.
A lire : la paradigme perdu d'Edgar Morin.
31 mars – fusion & fission
Il existe deux façons d'utiliser l'énergie atomique. La fission nucléaire, celle que l'homme maîtrise plus ou moins et qui consiste à casser des atomes pour en dégager de l'énergie. En revanche, la fusion nucléaire, celle que les étoiles pratiquent en leur coeur, produit non seulement une énergie bien supérieure, mais ne rejette pas de déchets radioactifs. Du reste, il est toujours préférable de créer que de détruire.
Il en est de même dans les rapports entre individus et espèces.
La collaboration élève en construisant quelque chose de supérieur sans engendrer de déchets encombrants : pollution, gâchis, inégalités.
La compétition n'est qu'énergie perdue, un chaos qu'il faut ensuite réparer, reconstruire. Double peine. Tandis que la coopération est synonyme de progrès : la somme d'une association est souvent supérieure à l'addition des deux termes de départ. Comme au cœur des étoiles où les réactions chimiques produisent des atomes plus lourds, plus complexes. Le carbone, cette « poussière d'étoiles », base de toute notre Nature, provient de là.
L'entropie générée par une trop forte hiérarchie où la compétition règne en maîtresse renvoie au chaos originel. Toute concurrence débridée est stérile, tout antagonisme ne peut offrir que désolation et pertes.
La Nature l'a bien compris. L'évolution aussi, alors que Darwin n'avait pas prit le recul nécessaire pour englober dans sa théorie le si important rôle de l'association et la solidarité inter et intra espèces. C'est en se donnant la main et non un coup de poing que l'on survit. Les exemples sont infinis, du rôle de communicants que les champignons jouent entre les arbres, jusqu'aux différents cycles qui font du neuf avec de l'ancien.
La nature entière est d'une résilience incroyable tout simplement parce qu'elle s'unit pour s'adapter aux circonstances. C'est également la force du libéralisme dans les sociétés humaines.
Tous les grands empires, trop hiérarchisés, trop rigides, ne se remettant jamais en question, ignorant le doute, se sont effondrés une fois devenus trop grands, trop lourds pour leurs fondations immuables. La force du système actuel c'est qu'il se régénère au fur et à mesure qu'il rencontre des incidents de parcours. Bien sûr, il est basé sur une compétition, une concurrence à toute épreuve – car l'humain porte cela dans ses gênes : c'est la raison pour laquelle il a put dominer à la fois les autres espèces animales, éradiquer ses espèces sœurs et régenter le monde lui-même. Mais cette apparente force est trop gourmande en énergie perdue, en pollutions diverses, en gâchis immenses. Nous avançons, poussés par nos chromosomes de tueurs mais en cassant beaucoup trop de choses autour de nous, à commencer par notre propre espèce. Une collaboration ne pourrait être que profitable à une telle débauche d'énergie.
En lisant le Paradigme Perdu d'Edgar Morin, on comprend pourquoi on en est arrivé là. Il pointe du doigt les ébauches des sociétés humaines, mises en place avant homo sapiens.
Notre station debout qui, en libérant nos mains, permet aussi au cerveau de se développer.
L'invention de la chasse qui va faire de primates arboricoles végétariens de redoutables prédateurs de savane. Toujours pour alimenter ce cerveau hors normes, si gourmand en énergie. Dès lors, tout est dit : le mâle, plus fort et résistant, ira à la chasse avec un instinct de vainqueur, de compétiteur. Il se tiendra debout. En revanche, la femelle, trop occupée à élever des juvéniles dont l'éducation va devoir s'allonger, deviendra, par la force des choses, plus casanière. Elle sera courbée sur son enfant.
Debout, courbée. Nous avons là les fondements de l'inégalité la plus ancrée dans les gênes humains.
Avec la sédentarisation naîtra le concept de propriété et de nouvelles inégalités.
L'esprit de compétition, obligatoire en quelque sorte lorsqu'il s'agit de chasser, se répandra à tous les niveaux de la société.
Il serait peut-être temps, à l'heure où l'on commence à peine à revenir sur le bipolarité sexuelle de l'espèce, de se poser la question, plus globale, de ce choix entre une compétition stérile et une coopération salutaire.
24 Mars - Le Jeu de l'Acteur
C'est la cinquième fois que je vois le film de Jean Becker « Dialogue Avec Mon Jardinier ». Comme on me faisait remarquer l'inutilité de revoir ainsi des films, je soutiens, au contraire, tout l'intérêt de revoir une œuvre, tout comme on aime à bisser ce que l'on aime.
« Dialogue » est le plus beau film jamais réalisé sur l'amitié. Deux personnes qui n'ont rien en commun et qui, s'ils devaient se rencontrer, s'ignoreraient cordialement, vont se lier de ces liens autant invisibles que puissants. L'un engage l'autre comme jardinier, se retrouvant après avoir été, cinquante ans plus tôt, camarades d'école. Pour nouer une amitié, il faut un atome crochu, une accointance, un rapprochement, fut-il infime. Ensuite, aucune science ne peut expliquer pourquoi on peut en arriver à donner sa vie pour quelqu'un qui ne nous ressemble pas.
Quelqu'un a dit (est-ce Oscar Wilde?) qu'un ami est une personne dont on connaît tous les défauts et qu'on aime quand même.
Tout le film repose donc sur ce duo d'acteurs au sommet de leur art : Jean Pierre Darroussin et Daniel Auteuil.
A la première vue, on se laisse emporter par le film, d'une manière générale. On ne s'embarrasse pas des détails. A la seconde, tout comme on chemine sur un sentier connu, on repère des détails, des précisions qui nous avaient échappé au premier abord. La musique ne procède pas autrement. La peinture aussi. On va du général au particulier, à chaque nouvelle écoute ou vue. Même constat dans n'importe quelle relation amoureuse – ou amitié. On apprend à connaître.
Fort de cinq visions, j'ai appris à connaître ce film. Cette fois, je me suis concentré sur le travail de l'acteur. Et j'ai remarqué que Jean Pierre Da rroussin était un poil au dessus de Daniel Auteuil.
Il ne joue plus, il est.
Quelle plus bel hommage peut-on rendre à ces caméléons dont le métier est de se glisser dans la peau des autres, d'incarner des destins qui ne sont pas les leurs ? Ce n'était plus Darroussin que je voyais, mais un retraité des chemins de fer qui passait son temps à jardiner.
Il existe deux types d'acteurs. Ceux qui jouent la comédie et redeviennent eux-mêmes dès que le clap de fin retentit. Ceux-ci appliquent le plus généralement une technique de jeu, qui s 'apprend dans divers cours de comédie. Et puis ceux qui s'impliquent davantage, ce que l'on a appelé l'Actor's Studio.
Il existe des petits trucs pour entrer dans la peau d'un personnage. Le costume et le maquillage sont connus de l'antiquité. Elle permet de travestir le comédien de manière à ne plus pouvoir le reconnaître et, en même temps, elle lui permet à lui, d'être un autre. Comme s'il suffisait de changer de vêtements pour changer de peau, comme si l'habit faisait le moine.
Bien sûr, le talent ne s'apprend pas. On naît acteur ou pas. Simplement certaines personnalités sont tellement imposantes qu'il est difficile d'en sortir. Un Raimu, un Gabin, un De Funès n'ont jamais fait autre chose que du Raimu, du Gabin et les grimaces et gesticulations du trublion préféré des Français. On ne leur demandait que ça, du reste.
Pourtant, cela n'empêche pas Coluche de jouer Tchao Pantin – à ce moment là, il ne « fait » plus du Coluche, il est réellement l'ancien flic devenu le pompiste vengeur. Bourvil n'est plus Bourvil dans le Cercle Rouge de Melville. Et même Belmondo ne capitalise plus sur le personnage qu'il s'est lui-même fabriqué, quand il joue Sam Lion, un patron qui a décidé de tout lâcher dans Itinéraire d'un Enfant Gâté.
Tout ces comédiens jouent la comédie. Ils mettent une partie importante d'eux-mêmes dans leurs personnages – parfois ce sont leurs personnages qui se fondent dans leur immense personnalité.
A l'inverse, d'autres se fondent dans leur rôles. Dewaere, De Niro, Hoffman. C'est plus périlleux car cela engage leur personnalité profonde. Quand le clap de fin retentit, ils continuent encore à demeurer dans leur personnage. Il leur est plus facile de devenir caméléon, de s'oublier dans la peau d'un autre. On les reconnaît plus difficilement à la première scène, habitués qu'ils sont à se métamorphoser. Extérieurement mais aussi au plus profond de leur âme.
Je n'ai jamais bien compris comment on pouvait dire d'un acteur qu'il était bon ou mauvais dans tel ou tel film. Comment savoir ? Un film, c'est un tout. Difficile de faire la part des choses. Tout comme parvenir à dissocier l'âme et l'esprit du corps.
En revoyant « Dialogue » et m'apercevant du travail incroyable que Darroussin parvient à faire pour n'être plus lui-même, tandis qu'Auteuil semble plus distant, je me suis rendu compte que c'étaient leurs personnages qui déteignaient sur leur performance.
Darroussin est un prolo qui ne cherche pas midi à quatorze heures. Il joue franc car il est fait d'une pièce. Sans trop d'ambiguïté. Je ne dis pas qu'il est con. Les cons n'appartiennent pas à une catégorie sociale en particulier. Auteuil, artiste peintre, a grandi et évolue dans une autre sphère sociale ou l'on intellectualise davantage, où l'on interprète plus volontiers. A plusieurs reprises, il a l'air de vouloir se disputer avec son ami car ils ne voient pas les choses de la même façon. Cependant, il y a dans son regard comme un renoncement : à quoi bon s'engueuler pour ça, cela n'en vaut pas la peine. Et il abdique.
Au final, à l'écran, cela donne un jardinier bien enraciné dans son quotidien, non qu'il n'est pas capable de réflexion, mais cela ne l'intéresse pas de cogiter tant et plus pour en arriver au même résultat. Ses désirs, ses envies sont moins aériens. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si l'un travaille la terre, les racines, le concret et l'autre se projette sur une toile « je ne peins pas ce qui est, je peins ce que je vois ».
Ainsi, Auteuil n'est pas moins doué que Darroussin dans son jeu d'acteur, il joue un personnage qui possède une ambiguïté, une retenue, peut-être n'est-il pas si sincère ? Finalement si, mais pas de la même façon. S'il intellectualise davantage, il n'en reste pas moins qu'il considère son jardinier comme son ami. Il aura peut-être davantage analysé la situation, mais c'est du pareil au même. Cette relation qui échappe à l'entendement. Comment deux personnes que tout oppose peuvent-elles en venir à s'aimer ? On a tous connus ça dans nos familles. On tient à quelqu'un et pourtant il nous serait impossible de dire pourquoi.
17 Mars - La ronde des mots
On le dit et on le répète : ce qui fait l'essence de l'homme c'est sa capacité à former un langage articulé.
Cependant ce n'est certes pas le meilleur moyen de communiquer. Il faut que ce langage soit universel (alors qu'un chien chinois comprendra un chien anglais, cela nous demandera des trésors de perspicacité), il demande un apprentissage et, surtout, il permet de ne pas tout dire, de cacher les choses, en un mot : de mentir – ce qu'une communication olfactive est incapable de faire.
Mais d'où vient ce langage ? Comment est-on passé de simples grognements de primates, avec force grimaces et expressions faciales, à des mots ? Comment se sont construites les phrases ? Toujours plus de complexité, à l'image même de l'évolution humaine.
Pourquoi l'humain en est-il arrivé à s'exprimer de manière toujours plus complexe, précise, maniaque.
Dans quel but ? Mieux se comprendre ou mieux se cacher ?
On peut très bien parler sans le support de l'écrit – quasiment toutes les tribus primaires le font. Qui a eu l'idée, la première fois, d'écrire ce qu'il entendait ?
Et dans quel but ?
Il semble difficile d'imaginer qu'un Shakespeare ou un Homère du temps de Lascaux ait eu besoin des mots pour passer à la postérité. Dessiner des bisons et des mammouths sur les parois d'une grotte est une chose, écrire en est une autre. Les récits de chasse, le soir à la veillée, ont dû se transformer en contes et légendes pour égayer les longues soirées hivernales et assurer la cohésion du groupe.
Je suppose que c'est encore l'économie et la loi du marché qui ont précipité l'homme dans l'écriture.
Dès lors que l'on commerce, on a besoin de traces écrites – ne serait-ce qu'un alignement de bâtons pour signifier l'importance d'une cargaison. A partir du moment où l'on diffère un paiement, on est forcé de préciser spécifiquement de quoi il retourne.
Dès que l'on se projette dans l'avenir ou dans l'espace, nous avons besoin d'écriture. Les paroles sont du vent, l'écriture du roc.
Cette écriture s'apparente, au début, à de simples cryptogrammes, idéogrammes censés symbolisé le mot juste.
D'après de sérieuses recherches et études, il apparaît que toutes les langues du monde, à deux ou trois exceptions près, du moins leur écriture, dérivent d'un premier alphabet, le Phénicien.
Ainsi, la lettre A, Alpeh, pour dire bœuf.
Qu'a donc le bœuf de si important ?
A cette époque des origines de nos civilisations, il faut bien comprendre qu'il symbolise la force, notre première source d'énergie. Le charbon ou le pétrole de l'époque. Il est donc normal de le placer en tête des phonèmes qui allaient constituer notre alphabet.
Pour ma part, j'aurais placé le S en tête. Lui symbolise le soleil (au départ, je croyais que c'était le O - l'oeil). Sans soleil, pas de vie. Sans eau (O?), non plus du reste.
Chaque langue a son propre alphabet, il évolue globalement entre 22 (le phénicien) et 29 lettres (le Khmer comporte 74 lettres!). Et leur place change aussi. Ainsi l'histoire du Z, Zêta en grec, qui occupait la septième position dans l'alphabet phénicien et la sixième dans l'alphabet grec, juste après Alpha, Bêta, Gamma (correspondant non pas à notre C mais à notre G), Delta, Epsilon. Les romains l'ont déclassé et rejeté après le X et Y, derniers ajouts en date. Du reste, Z est une lettre maudite, vaguement rebelle, puisque interdite dans les dictatures.
Notez au passage que l'alphabet français comporte 26 lettres de base, auxquelles il faut ajouter cinq diacritiques (les voyelles munies d'un accent et la cédille du C) et les deux ligatures oe et ae rencontrées dans cœur et ex-aequo.
Car la force de l'écriture à lettres, c'est de décomposer en petits signes, comme des molécules ou des atomes que l'on peut assembler à l'envi pour former des concepts plus précis : les mots.
Les hiéroglyphes égyptiens ou les idéogrammes de l'extrême orient sont déjà des concepts. Ils ne peuvent se ranger, par exemple. Vous ne trouverez jamais un dictionnaire de hiéroglyphes ni un agencement littéral des écritures par pictogrammes. C'est impossible. Du moins, pas exhaustivement ; les idéogrammes sont ordonnés par type, par catégorie, par concept. Les seuls dictionnaires chinois sont des transcription en alphabet occidental de ces idéogrammes.
Toutefois, ce système de lettres formant des mots a un énorme défaut : il ne peut être utilisé qu'entre personnes parlant la même langue.
Il existe un fameux t-shirt proposant une quarantaine de petits dessins sur le devant. En couplant les vignettes, on parvient à se faire à peu près comprendre partout dans le monde.
Mieux : le langage des signes, vraiment universel (encore que... il paraît qu'il change d'un pays à l'autre).
Cette vaste tour de Babel qu'est le monde, outre qu'elle offre de nombreux emplois aux traducteurs, n'est pas sans poser des problèmes d'interprétation. A commencer par les textes anciens, souvent à double sens.
Il a un autre défaut majeur. A l'instar de notre vue prédominante qui a éclipsé au fur et à mesure tous nos autres sens, le langage a réduit presque à néant tous les autres signes de communication : l'odeur, les expressions jusqu'aux plus infimes, les gestes, et même nos intonations. Il faut être mis dans une situation de non compréhension – à l'occasion d'un voyage à l'étranger, par exemple – pour parvenir à se réapproprier maladroitement toutes ces possibilités de savoir ce que pense l'autre.
L 'idéal serait, évidemment, de parvenir à une communication télépathique, sans nul besoin de mots ni de paroles. Est-ce bien sûr ? Cela supprimerait définitivement le mensonge, mais aussi le second degré et l'humour en général.
10 Mars - Vers un monde meilleur
Les guerres finissent toujours bien en général.
La folie mégalomaniaque de Napoléon a été réduite à néant dans la morne plaine de Waterloo ; la barbarie de 1914 s'est soldé par une paix certes toute relative mais suivie des années folles ; la monstruosité nazie a prit fin, posant les jalons du monde nouveau ; le système soviétique s'est effondré, colosse aux pieds d'argile ; tous les génocides et les tueries en tout genre finissent par cicatriser.
Un pré brûlé ne donne-t-il pas ses plus belles fleurs ?
Le pouvoir de résilience de tout ce qui vit est impressionnant. L'univers même semble s'organiser autour des lois gravitationnelles. Cela contredit le principe d'entropie qui veut que tout ordre se transforme, tôt ou tard, en un chaos total. En fait, pas tant que ça.
Les régimes autoritaires, empires, monarchies, dictatures reposent sur un ordre, qu'il soit militaire, policier, bureaucratique, seigneurial ou paternaliste. Les démocraties, en revanche, tendent au désordre, de part la multitude des opinions affichées. L'anarchie serait le but ultime de l'entropie humaine. Mais cela suppose un altruisme et un sens des responsabilités dont nous ne sommes pas capables pour le moment.
Malgré les dérives et les erreurs, globalement le monde tend vers le bien. De là à y voir une volonté suprême, il n'y a qu'un pas. Pourtant, si un tel Dieu existe, pourquoi n'aurait-il pas d'emblée tout bien organisé ?
La Nature, la vie en général n'a qu'un but, un seul objectif : la vie elle-même. Se reproduire, se dupliquer. Atteindre l'éternité par générations interposées. Et se complexifier de plus en plus tout en recherchant l'équilibre. En réalité, cet équilibre s'établit en dépit de chaque espèce et parfois contre elles. Le dessein d'une espèce est de se répandre par tous les moyens (croissez et multipliez vous). Elle n'est stoppée que par la concurrence des autres systèmes de vie ou bien par sa propre modestie, une fois qu'elle a compris qu'à trop vouloir dominer on finit par tout perdre. De là, naît la coopération. Ainsi les grands prédateurs se reproduisent moins et plus tard que les espèces basiques (la stratégie K contre la stratégie R). Ces deux principes s'opposent en fonction de leur position dans les chaînes alimentaires, de leur influence sur leur milieu. Le système K mise tout sur l'éducation d'une descendance réduite tandis que le dogme R engendre une progéniture considérable, très vite autonome. Dans le premier cas, la population est majoritairement adulte, stable, bénéficiant de conditions optimales et prévisibles. Dans le second, on rencontre un pullulement des jeunes, des conditions changeantes, aucune prévision à moyen terme.
Les civilisations humaines n'échappent pas à ce processus : on tend à un équilibre précaire. En schématisant un brin, on peut arguer que les sociétés nord-occidentales s'appuient sur une stratégie K tandis que l'Afrique et les pays en voie de développement seraient régis par une stratégie R. D'où la richesse au nord et la précarité au sud. Pour modifier cela, il faut changer non pas les comportements (qui ne sont que le résultat d'un environnement) mais bien les conditions de vie.
Il n'y a rien de moral là dedans, juste une de ces lois non écrites qui régissent le vivant. La recherche d'un équilibre instable dans un chaos qui va en s'accroissant.
3 Mars - De la personnalité
Je suis toujours interloqué d'apprendre qu'on puisse cerner la personnalité, le caractère, les aptitudes, les envies d'une personne sans la connaître vraiment. Savoir qui est qui au premier coup d'oeil. Il y a plusieurs indicateurs qui permettraient de tout savoir (ou presque) d'un parfait inconnu dès la première rencontre. Ces techniques intéressent beaucoup les recruteurs en tout genre – qui n'ont pas du temps à perdre à sonder en profondeur le profil idéal pour un poste donné.
Petit inventaire de ces procédés.
Commençons par peut-être le plus ancien de tous : l'astrologie. A une époque pas si lointaine, on la considérait même comme ayant sa place au sein de la prestigieuse académie des sciences.
Bon, je conçois assez bien qu'étant constitués à 80% d'eau, notre corps soit soumis à l'attraction de la Lune comme peuvent l'être les océans. Mais, étant donné que la Lune tourne sans arrêt autour de la Terre, pourquoi se focaliser sur les seules nuits de pleine Lune ? Qu'elle soit visible ou pas, elle agit de la même façon.
Quoi qu'il en soit, l'influence gravitationnelle ou magnétique aura des incidences sur notre corps, nos fluides, notre sang, notre peau... mais sur notre personnalité, c'est moins sûr.
Quant à penser à une influence des astres lors d'une conjonction particulière au moment de notre venue au monde (le changement de milieu le plus radical de notre vie) sur notre personnalité, il y a un pas, un gouffre. Cela reviendrait à dire que toutes les personnes nées dans un rayon de cinquante kilomètres et à la même heure partageraient les mêmes grandes lignes de caractère.
Douteux.
Passons ensuite au groupes sanguins. Oui, vous avez bien entendu : notre personnalité pourrait se lire dans nos veines. Ce n'est pas si ahurissant que ça, finalement. Notre sang nous réchauffe, il transporte l'oxygène dans nos muscles, évacue les déchets. Il est primordial. De là à penser qu'il puisse avoir une influence sur notre psychisme, pourquoi pas ? Il n'y a pas si longtemps, on croyait mordicus que nos fluides régissaient notre comportement : bileux, colérique, amorphe, joyeux, triste,etc. Des humeurs, pas la personnalité ni le caractère.
Plus tendancieux : les lignes de la main. Bien sûr, on remarquera d'emblée une différence entre des paluches de maçon et celles d'un pianiste. Cela démontre-t-il que tous les travailleurs du bâtiment sont du même moule psychologique et que les cols blancs partagent le même caractère ? Là encore, ces indicateurs reflètent davantage un milieu socio-culturel.
Je n'ose évoquer les délires de ceux qui sont persuadés de savoir à qui ils ont affaire rien qu'en serrant la main ou dès le premier « bonjour » échangé.
Et pourquoi pas la morphologie ? Tel visage correspondrait à tel type... Hmm. Bien qu'Aristote affirme que le visage est le miroir de l'âme, je frémis d'avance au portrait du dangereux juif affiché partout par la Gestapo. Sans parler des dérives nauséabondes liées à la couleur de la peau, des cheveux, de la grandeur du nez, des oreilles. Du reste, il me semble que c'est prendre le problème à rebrousse-poil : qu'un caractère puisse se lire sur un physique parce qu'il l'a façonné au long des années, c'est probable. Ainsi, ces petites rides au coin des yeux ne sont-elles pas le témoin du côté rieur de l'individu. Ce dos voûté, parfois cassé en deux, dénote une vie de labeur pénible, courbé dans un champ ou écrasé sous le fardeau. Toutefois l'activité ou le travail parlent-ils de notre caractère profond ?
Certains avancent que notre personnalité se lit dans notre écriture. C'est déjà plus subtil que de déchiffrer les rides de nos paumes, la grosseur de nos doigts et leurs proportions, l'épaisseur de notre nez, la hauteur de notre front ou la forme de notre visage. Puisque nos mains sont nos premiers outils et que nous les utilisons sans cesse, il est fort probable que cette finesse ultime dans le geste de tracer des lettres trahisse notre caractère profond, notre volonté. L'écriture n'étant qu'un code, il est facile d'y retrouver quelques évidences, d'autant que les spécialistes vous affirmeront qu'on ne peut masquer son écriture bien longtemps. C'est une empreinte. Oui, tiens : nos empreintes, elles sont uniques, nous appartiennent en propre, elles sont donc imparables : elles nous dévoilent entièrement. Seulement cette unicité joue contre la catégorisation que recherchent ceux qui entendent former des groupes de personnalités. Et puis qu'est-ce qu'une peau en particulier ira influencer notre moi profond ?
Quand on parle de numérologie, on atteint au ridicule. Additionner les lettres de nos noms, prénoms ou nos dates de naissance. Une foire aux abrutis. En revanche, porter un prénom et un nom peut, à la rigueur, avoir une influence sur notre comportement, notre réaction au monde. Les pseudonymes, les diminutifs, les surnoms et les sobriquets jouent un rôle non négligeable. Le langage n'est pas anodin, il est notre essence même en tant qu'humains. Peut-être notre façon de parler renseignerait-elle davantage sur notre tempérament. Le choix du vocabulaire, l'ordre des mots, les tournures de phrases.
Remplacer le nom par un matricule est un procédé bien connu à l'armée ou en prison pour annihiler la personnalité d'un individu et en former une masse compacte et plus facile à diriger. Là encore, ce n'est dévoiler qu'une partie de l'iceberg qu'est notre personnalité propre. Tous les Jacques ou tous les Michel ne partagent pas le même profil.
J'irai même jusqu'à penser que notre ADN se recèle pas tout. Des études ont été menées sur de purs jumeaux séparés dès leur naissance. C'est assez troublant car ils partagent un même comportement face à des situations toutes différentes. Un tronc commun mais qui peut être largement influencé par le milieu, l'environnement, l'expérience vécue au jour le jour.
Et puis, se résoudre à penser que tout est écrit d'avance annule ce fameux libre-arbitre qui fait de nous des hommes libres. Cela accorde à la providence beaucoup trop d'importance. L'humain est une des rares espèces à pouvoir influencer son avenir. Pour le meilleur... ou pour le pire.
25 Février - de la diversité
Un épais ouvrage de Gérard Boutet (la France en Héritage) recense les nombreux métiers oubliés sur une période assez récente, somme toute. Du milieu du XIXème jusqu'à la fin de la seconde guerre mondiale. Cent ans d'artisanat, d'une tradition paysanne que la mécanisation allait envoyer aux oubliettes en quelques décennies à peine.
Pourtant l'industrialisation avait déjà commencé. La première révolution industrielle en Angleterre date du XVIIème. Elle se généralise au XIXème mais nombre de petits métiers perdurent encore jusqu'entre les deux guerres.
Cette diversité impensable s'accompagne pourtant d'un autre globalisme.
Prenons l'exemple de la chaise.
Il y a deux façons de la fabriquer.
Soit dans nos usines démesurées où le travail est morcelé en différentes chaînes de montage. Chaque employé, chaque ouvrier accomplit une petite portion de l'objet final. Il devra répéter à longueur de journée le même geste, découper, poncer, ajuster, coller, vernir. Il ne verra jamais le résultat de son labeur. Et celui là même qui voit l'objet fini n'en sera en rien responsable : lui se contentera d'emballer.
L'autre solution est de fabriquer cette même chaise quasiment de A à Z. Il ne peut y avoir d'ennui à cette tâche, puisqu'il y aura mille gestes à maîtriser pour parvenir à tout faire. Cette même différence que l'on retrouve entre les mille gestes précis qu'il faut maîtriser pour écrire et le basique tapage à deux doigts sur un clavier. Du reste, même si le dessin est le même, chaque chaise sera différente de la précédente, elle pourra l'être du moins. L'artisan demandera peut-être à un tapissier d'en confectionner le dossier, à un autre spécialiste d'y ajouter du rotin, du cuir, à un peintre de la décorer, à un ébéniste de la sculpter. Non seulement, l'artisan sera fier de ce qu'il a fabriqué, étant le seul responsable du travail fini, mais encore cela renforcera cet amour du travail bien fait, un dépassement de soi dans le labeur, une émulation possible dans le cas d'un travail commun en atelier.
Le rapport à l'ouvrage est radicalement différent : dans un cas, on travaille (occupation non désirée et passablement ennuyeuse – du reste, étymologiquement provenant d'un instrument de torture qui déformait si bien les corps, ainsi parle-t-on encore de « bois qui travaille »), dans l'autre on exerce un métier en mettant un savoir-faire au service du futur propriétaire de l'objet, qui n'est plus qu'un simple client tiroir-caisse. Il est même probable ou possible de faire du sur-mesure : la relation producteur/consommateur en devient renforcée. Les liens sociaux se resserrent.
Tout cela est très bien, mais ne va-t-on pas m'opposer le coût de revient d'un tel modèle ?
Avant de lister des comptes d'apothicaire, il faut bien comprendre que notre système actuel de production de masse souffre d'un mal incurable : le gaspillage.
Pour ne parler que de la nourriture, il est avéré que l'on jette quelques kilos de nourriture non utilisée sans parler des pertes de stockage (grands magasins) ni même du gâchis lors des chaînes de production : une usine à yaourts, lorsqu'elle change de parfum, laisse tourner la chaîne, produisant quelques milliers de pots mi-fraise mi-abricot, tous voués aux bennes.
On parvient quelquefois à une perte estimée à 40 ou 50%. Une production qui répondrait directement à la demande évite cette perte, source de pollution de surcroît.
Le fait même de répondre à une demande supprime les milliards d'euros dévolus à la publicité (entrant dans le prix de revient du produit bien entendu) qui sont une gêne de tous les instants, pollution visuelle et auditive.
Cette simple réponse à la demande n'exclut cependant pas les innovations.
Prenons l'exemple d'un maraîcher qui, au fil du temps, s'est acquis une belle clientèle lui faisant confiance de par la qualité de ses produits. Rien ne l'empêche de proposer une nouvelle variété de tomates, un nouveau légume, une ancienne variété de carottes à la manière d'un conseiller dans une librairie qui suggérera un livre au client dont il finit par estimer les goûts.
Cette proximité, chacun la recherche, chacun l'estime.
Cela permet, en outre, de revenir à l'autosuffisance, à stabiliser l'emploi et réduire les coûts énergétiques des transports.
Si fabriquer en petites quantités donne du sens aux emplois ainsi procurés, cela augmente le prix des choses confectionnées. Du reste, ce faible coût des chaînes de montage démesurées était et reste encore l'argument principal démocratique du capitalisme : c'est à ce prix (justement) que la majorité peut bénéficier d'un confort autrefois réservé à l'aristocratie, à une infime partie du monde. En oubliant au passage que cette méga production n'enrichit réellement qu'une poignée d'actionnaires qui peuvent, eux, se permettre de faire travailler leur argent à leur place.
A ce niveau, un effort (qui n'en est pas vraiment un) doit être demandé au consommateur, celui de faire durer les objets. Cela est d'autant plus facile que la qualité du fait-main et du sur-mesure remplace des objets produits à la chaîne et dont l'obsolescence n'a qu'un but : vendre encore et encore.
Pourquoi acheter une nouvelle paire de chaussures quand les siennes ne sont pas usées ? Pourquoi les changer quand une simple réparation suffit ? Bien entendu, je ne serai pas l'ayatollah qui oblige tout un chacun à user ses semelles jusqu'à la corde – vieux relent d'une époque soviétique heureusement révolue. Je conçois que l'on puisse avoir comme passion la mode et vouloir changer de garde-robe plus souvent qu'il n'est obligatoire. Mais, comme toute passion, cela a un prix.
Concernant la nourriture, même constat : il est avéré que des plats relevés, épicés, mieux préparés, à base de bons produits aboutissent à parvenir à satiété plus rapidement et en avalant de moindre quantités. Mangeons moins, mangeons mieux. A commencer par la viande.
Jean Claude Vandamme, karatéka de pacotille et philosophe moderne, l'avait bien saisi : pourquoi cultiver des aliments pour nourrir du bétail pour nourrir l'homme ? Ne serait-il pas plus simple (et efficace) de cultiver directement pour l'homme ?
Pareil pour le rapport au monde du travail. L'engouement pour le milieu associatif, pour le bénévolat : donner un sens à sa vie, une idée du partage, se réaliser soi-même, etc. Pourquoi donc travailler à une tâche qui nous répugne afin de gagner l'argent suffisant pour enfin pouvoir s'épanouir... bénévolement ? Pourquoi ne pas directement s'activer dans ce qui nous intéresse.
Ce qui demeure la pierre angulaire de cette volonté de revenir à de petites structures est cette diversité dont on vante si bien les mérites lorsqu'elle est biologique. Ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, gage de pérennité et de ce mot tellement à la mode : durabilité.
Remplacer ces douze multinationales produisant des millions d'objets tous identiques par quelques millions de micro entreprises ne produisant qu'une poignée d'objets différents. Cela pourrait même amener la population à penser différemment du voisin. Et cette diversité là est la plus importante de toutes.
18 Février - s'impliquer
Je viens de voir Shoah. Le film interview-marathon de Claude Lanzmann sur cette noire période de notre histoire récente.
Cette éradication clinique et systématique du peuple juif et, accessoirement, de tout autre opposant au régime Nazi et tsiganes, bohémiens, en gros tout ce qui ne correspondait pas à un idéal aryen (auquel, Hitler lui-même ne satisfaisait pas : petit, malingre, pas vraiment une gueule de jeune premier) est tout simplement incompréhensible.
Là, on bute devant l'inconcevable.
Comment parvenir à comprendre le cheminement de pensée qui aboutit à une telle froideur dans l'exécution la plus sordide de toutes, parfaitement inhumaine.
C'est justement pour cette raison que ce système a si bien fonctionné.
Jonathan Littell le décrit très précisément dans « les Bienveillantes » : l'épuration ethnique vue par un officier SS. De l'intérieur.
Les nazis ont simplement construit et administré les camps de la mort comme de vulgaires usines avec leur rendement demandé, leur hiérarchie impitoyable (allez chercher les responsabilités après ça) et leurs objectifs.
Tout comme Krupp fabriquait des ustensiles, Dachau et Auschwitz fabriquaient de la mort.
Pour effacer toute trace du génocide, sans doute non pas pour cacher une honte mais plutôt pour nier l'existence même du peuple juif (si celui-ci n'existe pas, alors le crime de guerre est absout), on demanda aux prisonniers valides de déterrer les corps des gazés pour les brûler (quand les fours n'étaient pas encore opérationels). Je vous laisse imaginer les hauts-le-coeur éprouvés par ces hommes (qui n'étaient plus que des ombres, Jean Ferrat) quand ils devaient charrier leurs propres connaissances, des membres de leur famille (en Pologne pendant le rude hiver, les corps ne se décomposaient pas beaucoup : certains ont reconnu dans cet étrange ballet leurs proches). Lorsqu'ils demandèrent des pelles et pioches, les officiers leur ont répondu qu'ils devaient s'acquitter de cette déplorable besogne à mains nues, histoire de s'habituer et de bien comprendre que ce n'étaient là, non plus des hommes ou des cadavres d'hommes. Moins que des animaux. Du rien. De la merde.
En transformant l'élimination radicale en simple rendement d'usine ; en faisant passer un homme pour un simple objet, un renégat de l'humanité, on parvenait à justifier l'horreur absolue. Pas la comprendre. Juste la légitimer.
Les officiers nazis chargés de cette épuration, du moins la plupart, n'avaient rien contre les juifs, j'en suis persuadé. Ils faisaient leur « boulot ».
C'est ce glissement qui est insupportable, impardonnable.
Bien sûr, il y eut des génocides ailleurs et à d'autres époques. VietNam, Rwanda, Roumanie, Corée. On tuait sous le coup de la furie, de l'exaltation, du fanatisme, de la violence, d'un endoctrinement absolu. Un état où le cerveau a abdiqué et s'est rangé à des idées générales, le plus souvent fausses. C'est ce même endoctrinement qui servait le régime nazi auprès des foules, cette même intoxication des masses qui justifia le goulag, cette même propagande qui soutint le régime Chinois ou n'importe quel autre dictature.
Cependant, dans le cas des nazis, et pour l'unique fois au monde, nous avons une rationalisation immonde qui vient se coller aux humeurs détestables.
Il n'échappe à personne que la mort d'un proche nous remue davantage que celle de mille inconnus dans un tremblement de terre au bout du monde. C'est tout à fait normal. Rien de plus humain. L'émotion joue au maximum dès lors que l'on connaît quelqu'un. C'est un peu de nous mêmes, une extension de notre propre corps (tout comme un bébé croit que sa maman est un de ses membres).
Je peux concevoir qu'un raciste au dernier degré puisse être pote avec un arabe ou un noir, si celui-ci fait partie de son quotidien. Qu'il connaît ses qualités. Le xénophobe vous répondra que ça n'a rien à voir, que Mohamed c'est Mohamed ou que Boubacar c'est Boubacar mais que, en règle générale, il ne peut supporter les Arabes ou les noirs.
N'est-il pas paradoxal que l'extrême droite fasse ses plus mauvais scores électoraux au cœur des villes où le brassage des population est à son maximum et remplisse les urnes en rase campagne ?
Cet intérêt, voire cet attachement que l'on a pour les personnes de notre entourage, pourquoi ne pas l'éprouver pour n'importe quel humain ? C'est ce que j'appelle le vrai Amour. Quelques religieux peuvent le ressentir, il me semble. Mais, tout comme la peur naît de l'inconnu, l'indifférence se répand par ignorance.
Le personnel de santé sait très bien de quoi je parle.
Ne pas s'impliquer outre mesure avec les patients pour ne pas devenir une éponge et y perdre sa propre personnalité, son intégrité égoïste, celle qui nous permet de vivre. De nous protéger de l'extérieur. Une seconde maison en quelque sorte.
Si l'on devait s'impliquer à chaque malheur qui survient dans le monde, guerre, famines, meurtres, pollution, déforestation, violences conjugales, rejet de l'autre, brutalités en tous genres, on ne pourrait plus dormir.
L'exercice de trapéziste du personnel de santé est justement de parvenir à s'impliquer suffisamment pour que la santé psychique du patient soutienne son rétablissement physique sans pour autant y faire entrer trop d'émotion. Dans les cas d'hospitalisation courtes, pour une simple opération, ce risque est faible. Comment s'attacher à une trentaine, une quarantaine de personnes sur une période de moins d'une semaine. C'est déjà plus difficile lors de séjours plus longs, particulièrement en cancérologie – justement ces pathologies qui demandent une santé psychologique optimale.
Enfin, il y a un métier qui met en jeu la propre personnalité à cent pour cent. Acteur, comédien. Eux vivent plusieurs vies à la fois. Comment éviter de se noyer dans d'autres mondes, superficiels mais pourtant bien réels lorsqu'on les enregistre. Une certaine schizophrénie conforte le talent, l'accompagne. A ce petit jeu de vivre plus fort, plus intensément, on risque de s'y brûler les ailes.
11 février - Sauver la planète
Sauvons la planète !
Tel est devenu le leitmotiv à la mode, spécialement chez les enfants, comme pouvaient l'être les fameux slogans de mai 68 : sous les pavés, la plage ; interdit d'interdire...
Sauf que la planète n'a nullement besoin d'être sauvée. Elle affiche 4 milliards d'années et demi (4,543 pour les tatillons) et il lui en reste quasiment autant à tourner sur elle-même (ralentissant son rythme au fil des siècles) tout en courant autour du soleil qui devrait gonfler démesurément dans approximativement 5,5 milliards d'années. On ne va pas chipoter. A ce moment là, on aura beau faire, il sera impossible de sauver la planète.
Notre planète n'a été qu'un vulgaire caillou pendant presque un milliard d'années. Un peu malmené du reste, notamment par une météorite qui lui arracha suffisamment de matière pour créer la Lune (non, notre satellite n'est pas « sorti de la cuisse de Jupiter »). Jusque là, il n'y avait pas grand chose à « sauver » puisque la première cellule vivante apparaît il y a 3,8 milliards d'années. La vie va être longue au démarrage : avant de proposer quelque chose de moins basique qu'une cellule procaryote (sans noyau), il faudra attendre encore un milliard d'années pour qu'apparaissent les eucaryotes (cellules à noyau), les ancêtres de tout le vivant qui nous entoure. Nous sommes parvenus à 2 milliards d'années et avant que des organismes plus évolués commencent à nager dans les océans, puis colonisent les terres immergées, il se passera encore quelque temps. On peut dire qu'il y a vraiment diversité (et beauté par la même occasion) depuis un demi milliard d'années. Et là, c'est une véritable explosion.
La vie n'a pas de sens, pas d'objectif, pas d'intention autre que de vivre, justement, en colonisant la plus petite parcelle disponible (on recense des espèces dans les fonds marins les plus inhospitaliers) et en se complexifiant de plus en plus. Et les cinq extinctions massives qui ont émaillé notre Histoire n'ont absolument pas réussi à tout dézinguer, même celle du Cambrien, plutôt radicale : 90% des espèces rayées de la surface.
Cette formidable résilience, notre Terre l'a déjà éprouvée et je ne vois pas ce qui pourrait, en interne, y mettre fin. La seule possibilité de tout arrêter ne peut venir que de l'espace. Une météorite géante qui pulvériserait définitivement notre Belle Bleue ou un trou noir qui s'approcherait un peu trop près, gobant absolument tout sur son passage.
Donc, il n'est certainement pas question de « sauver la planète » mais, plus égoïstement, l'humain sur la planète.
J'envisage quatre scenari pour l'avenir.
Nous sommes entrés, quoiqu'on en pense, dans la sixième extinction de masse et, cette fois, une espèce est largement responsable de ce constat alarmant : la nôtre.
Plutôt que s'intégrer au vaste monde naturel, l'humain a toujours tenté de le régir. Dominer la nature. Croissez et multipliez vous dit la Bible, justification bien pratique pour devenir le cancer de la planète.
Il est difficile de connaître l'ampleur de cette nouvelle extinction. Elle va dépendre de l'action humaine, passée mais aussi à venir, sur la planète. N'en déplaise aux optimistes qui pensent que tout est encore possible, nous avons mis en route un mécanisme qui bénéficie d'une très importante inertie.
Même en stoppant toute action anthropique dès demain, le réchauffement continuera pendant quelques centaines d'années. Inéluctable. Une locomotive lancée à pleine vitesse dans une pente s'accentuant de mètres en mètres.
Du reste, ce début de disparition des espèces (alors que nous n'en avons inventorié qu'un dixième!) n'est absolument pas lié au réchauffement : à peine un degré supplémentaire depuis un siècle. Ce n'est que demain que ses effets vont se faire sentir : augmentation du niveau des océans, changement de la salinité de ceux-ci, progression inexorable des terres incultivables (déserts), dérèglement météorologique, incendies, crues, vents violents... Pour l'instant, seules la pollution, les déboisements, l'intensité de l'action sur les sols, le développement des métropoles sont à mettre au passif.
Dans le premier scenario, l'humain disparaît très vite (à peine quelques milliers d'années , peut-être moins). Assez cependant pour dévaster un peu plus ce qu'il reste, mais attention : comme nous l'avons vu pendant le confinement dû à la propagation du Covid, tout peut aller très vite. La nature peut rebondir d'une manière incroyable.
Quelques dizaines de milliers d'années pour repartir sur des bases pas si éloignées que celles que l'on connaît aujourd'hui. Il n'est même pas sûr, dans ce cas de figure, que tous les mammifères soient exterminés. Un coup de gomme, simplement. Un taux de disparition inférieur peut-être à 50 ou 60%. La vie continuerait, sans l'homme, sans les primates, mais en offrant de nouvelles niches écologiques où pourraient se développer d'autres espèces dominantes. Et pourquoi pas une créature pas si différente des primates.
Second scenario. L'humain prend conscience, face à quelques dégâts gigantesques, monumentaux, qu'il faut réagir d'une façon toute militaire.
L'homéopathie c'est très bien en prévention. Si vous avez le ventre ouvert d'un coup de couteau ou une jambe cassée, gober quelques pilules d'arnica ne vous rendra pas vraiment service. La situation globale est devenue telle que, pour réagir, il faudra employer l'artillerie lourde. Des mesures de restriction qui feront passer nos tentatives de confinement pour des amuse-gueules. La population démocratique sera-t-elle d'accord pour s'asseoir sur des libertés acquises de longue date et allant de soi ? Décider, du jour au lendemain, de stopper toute activité énergivore, couper le chauffage, arrêter les déplacements coûteux en énergie, se priver des ordinateurs, chacun devant cultiver son propre lopin de terre – ce qui pose le problème des mégapoles. C'est une solution peu probable, sauf faisant suite à un possible conflit mondial (manque d'eau, raréfaction de la nourriture, déplacements migratoires de masse, etc).
Le troisième scenario serait celui du tout technologique. En l'état actuel des volontés clairement affichées (mais cependant peu suivies de faits réels), on ne s'y engage pas. Mais les catastrophes à venir risquent peut-être de changer la donne.
Penser que l'humain n'a plus sa place au cœur du monde vivant, mais au-dessus. Tout miser sur le sur-réel en nous réfugiant dans des bunkers, sous des dômes au fond des océans, coupés du monde réel par le tout technologique. Comme dans les pires romans d'anticipation. La technologie poussée au maximum. Plus rien de naturel. La nourriture remplacée par des perfusions, la réalité virtuelle afin de combler l'envie et le besoin de nature (continuer à faire du sport devant un écran réactif, se balader dans une forêt virtuelle, escalader les montagnes pour de faux). Et pourquoi pas, à terme, télécharger notre cerveau dans une machine, un super ordinateur qui n'aurait besoin que d'énergie (puisée au solaire, aux vents démoniaques qui souffleraient maintenant à plus de 500 km/h).
Cette vision, somme toute héritée des années 50 lorsqu'on pensait que la technologie allait nous offrir un avenir radieux et meilleur, ne peut, bien entendu, que s'appliquer à une élite. Qui choisirait qui?
Dernier scenario : le vaisseau spatial.
Pas nécessairement un vrai vaisseau spatial pour quitter un monde devenu irrespirable. L'idée n'est pas tant d'aller voir « ailleurs », mais plutôt dans le futur... lorsque la planète aura retrouvé des conditions semblables à celles de l'ère pré-industrielle. Ici, on rejoint le scenario numéro un, misant sur la disparition précipité de l'humain, grand responsable de tout ce charivari.
Grâce aux techniques d'hibernation appliquées à la fois aux humains et aux animaux, la conservation de graines de plantes, établir une gigantesque arche de Noé, un musée du vivant endormi pour tout réveiller le moment voulu. Les précédentes extinctions n'ont pas réellement modifié en profondeur les données climatiques et il est tout à fait envisageable de repartir du bon pied, avec quasiment les mêmes acteurs, dans quelques milliers d'années, une fois l'orage calmé.
Ne restera plus qu'à ne pas recommencer les mêmes erreurs. Finalement, la véritable utopie n'est pas autre chose. Pas ailleurs, mais plus tard.
4 Février - Désindividuation
La désindividuation de groupe est un concept selon lequel l'homme devient barbare dès qu'il se regroupe.
La foule fait peur. On a tous en mémoire ces harangues de dictateurs portées par une assemblée galvanisée par quelques mots bien choisis ou encore ces lynchages où le plus grand nombre dicte sa loi, jamais bien réfléchie.
Si l'humain est capable de raisonnement, il ne peut le faire qu'en solitaire, éventuellement grâce au challenge d'une émulation constructive. Dès qu'il se pose en meute, l'humain redevient une bête qui abdique son libre arbitre, son propre jugement, annihilant sa raison et sa capacité à comprendre par son comportement grégaire. Il devient un simple troupeau, encore plus facile à diriger. Cela, le pouvoir, quel qu'il soit (politique, religieux, économique) l'a vite compris. S'adresser à la masse plutôt qu'à l'individu. Simplifier à l'extrême. Jouer sur les cordes sensibles et les plus bas instincts.
Si la machine de guerre nazie a connu un tel succès, c'est uniquement en appliquant ces ficelles immondes. Si le communisme et toutes ses dérives ont pu s'imposer si facilement, c'est encore par une simplification totale. Si les religions ont ravagé le monde c'est toujours au nom de ce principe élémentaire : ne considérer l'humain qu'en groupe, l'uniformiser à outrance et le réduire à une meute, une populace immature et ignorante.
Dès qu'il est en groupe, l'humain cesse de réfléchir par lui-même et s'en remet plus facilement à un leader désigné, son propre reflet, son porte parole.
Cette force de groupe est certainement à l'origine du succès de prédateur sans précédent qu'est Homo Sapiens, au point même d'être son propre nuisible – aucune autre espèce ne s'autodétruit de cette manière.
Et pourtant...
Si l'humain est capable du pire lorsqu'il est réuni en une foule sans âme et sans cœur, il peut montrer sa plus belle face dans la coopération, le mutualisme, l'échange. Cette propension à déléguer, à se spécialiser, se spécifier a permis l'élaboration de grandes civilisations, à porter la science à son point le plus haut, à construire quelque chose de grand. C'est aussi la raison pour laquelle le volume de notre cerveau est plus petit que celui de Néandertal, même qu'il semble régresser au sein de notre propre espèce. A quoi sert-il de posséder un organe aussi gros consommateur d'énergie quand on sait que le maillage de toutes ces intelligences est de beaucoup supérieur à un méga cerveau ? Inutile de tout vouloir régir par soi-même, les autres sont là pour palier aux manques.
L'humain est un animal social. Il ne peut se passer de compagnie. Il en a besoin. C'est vital.
Il existe des zones bleues dans le monde. Ce sont des endroits où l'espérance de vie y est plus forte qu'ailleurs. Qu'est-ce qui fait la différence ? Une plus saine alimentation bien sûr, moins de stress évidemment mais surtout des liens sociaux plus forts.
Cet équilibre de haute volée est la condition sine qua non d'une société prospère et intelligente. Ce numéro d'équilibriste est si difficile à garder qu'on se rend compte, au fil de l'Histoire, que nous ne faisons qu'osciller entre l'un et l'autre. Que nous plongeons dans la fange du populisme à la moindre menace. L'effet de groupe joue à fond, autant dans un sens que dans l'autre. Les images d'horreur de catastrophes nous incitent à davantage de solidarité mais, d'un autre côté, une menace qui nous touche directement nous rend plus égoïstes, voire xénophobe devant un partage obligé. Nous sommes d'accord pour aider les victimes au loin, mais lorsque nous sommes menacés, c'est chacun pour soi.
Nous ne possédons pas encore cette force morale qui doit absolument accompagner le rôle de super prédateur que nous sommes un peu trop vite devenus. Notre volume crânien est l'un des plus importants mais nos connexions se font peut-être mal. Nous devons parvenir à nous entraider sans nous déchirer, à oeuvrer en commun tout en gardant notre identité, à porter le groupe, la communauté tout en nous réalisant.
Un sacré challenge, fait d'ornières dans lesquelles il est si facile de glisser, de chausse-trappes apparaissant soudain sous nos pieds, de menaçantes épées de Damoclès au-dessus de nos têtes. Mais le jeu en vaut la chandelle.
28 Janvier - Besoin de sexe
L'homme aime le sexe. C'est une évidence. La femme aussi, du reste. Parmi tous les mammifères et plus généralement tous les animaux, nous sommes les seuls à ne pas avoir de période de rut (peut-être le lubrique Bonobo aussi). Pour nous, c'est tous les jours le 14 Juillet de la braguette.
Mais pourquoi cette frénésie ?
D'abord, il y a un paradoxe : pour se reproduire, la manière sexuée n'est apparemment pas la plus efficace. Il faut d'abord trouver le partenaire. Un sacré parcours du combattant ; tous les célibataires en mal d'âme sœur me comprendront à demi mot. Les parades de séduction demandent beaucoup de temps, d'énergie et d'invention. A tel point que c'en est devenu même un risque pour sa santé et un péril pour sa vie.
Regardez le cerf. A quoi lui sert ses immenses bois, sinon à la parade amoureuse. Ca doit être bien encombrant de transporter quelques kilos sur sa tête en permanence. Il partage ce désavantage avec feu la Reine d'Angleterre et sa couronne de plusieurs livres (pas Sterling celles-là).
Prenez le paon. D'accord, ces plumes en éventail, c'est joli, mais pas très pratique dans la vie de tous les jours. Imaginez devoir vous promener en permanence avec une traîne de robe mariée de quelques mètres en guise de balais brosse.
Sans parler des combats pour attirer l'attention de la belle tant convoitée.
Bref, parvenir à s'accoupler demande beaucoup de sacrifices.
Mais ce n'est pas tout.
Dans une reproduction sexuée, nous ne donnons que la moitié de notre patrimoine génétique à notre descendance. Tandis que la simple et basique division cellulaire offre la fabuleuse possibilité d'un don total de tous nos gênes à nos rejetons.
Et pourtant, dans la nature, la meilleure façon de se reproduire est encore ce mélange de l'ADN. Y compris pour toutes les espèces, en particulier les plantes, qui utilisent la parthénogenèse : pas de sexe au sens primaire, puisque les les gamètes sont apportées par un tiers (insectes, vent). Tous ceux-là sont privés d'un attouchement direct mais participent à ce grand mélange.
En y réfléchissant un peu, cela semble plus logique.
Pour évoluer, il faut du changement. Si l'on conserve les mêmes traits, les même comportements, on finit par s'ennuyer. Ainsi lorsque l'ADN se duplique, il commet parfois des erreurs, comme les moines copistes du moyen-âge en traduisant les textes grecs et latins. Doubler une consonne, changer un M en N, un V en U. Ces erreurs lors de la duplication de l'ADN sont provoquées par le bombardement incessant des neutrinos que rien n'arrête ou bien alors une sacrée porte en plomb : des scientifiques ont réussi à en piéger quelques-uns. Ils sont transportés par les vents solaires lors des éruptions de notre astre et viennent causer des dommages collatéraux dans nos propres chromosomes. Et c'est une chance.
Parce que, l'Evolution n'est rien d'autre que ces petits changements qui permettent de mieux s'adapter à notre environnement changeant en permanence. Par exemple, lors d'un refroidissement du climat, celles et ceux dotés d'une couche de graisse plus épaisse sont avantagés. L'humain, en revanche, n'a eu cesse d'adapter son environnement à sa personne... en créant le chauffage central dans ce cas précis.
Il n'en reste pas moins que pour l'ensemble du vivant, mieux vaut ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Mélanger les gènes permet d'inventer un nouvel être, moitié & moitié, offrant une nouvelle combinaison.
Le jeu en vaut la chandelle. Le vivant va toujours vers plus de complexité, plus de diversité. Il n'a qu'à voir la palette immense des formes et comportements des êtres vivants de toutes sortes. Cette bio diversité est essentielle non seulement à la beauté de la nature mais aussi et surtout à sa préservation. Voilà pourquoi il est crucial de la préserver. Et même aller au-delà, en la stimulant, en l'encourageant dans nos styles de vie, dans nos vêtements, nos repas, nos métiers et, surtout, dans nos pensées.
Ne jamais ressembler à son voisin. L'unité dans le général (quelques notions essentielles et universelles : tu ne tueras point, tu ne feras pas l'amour avec des enfants, tu respecteras ton environnement), la diversité dans le particulier.
Mélangez-vous et, surtout, diversifiez-vous !
21 Janvier 2024 - Super héros
L'évolution de l'humain a connu quelques paliers significatifs.
40 à 20 000 ans : Cro Magnon invente l'Art en badigeonnant les parois des cavernes où il vit. En représentant son environnement, il pose les bases d'une réflexion qui n'aura de cesse de s'affiner.
2300 ans : Aristote élève la conscience de lui-même à la conscience d'être et commence à se poser des questions existentielles majeures. L'humain prend alors du recul par rapport à lui-même, comme par le rire et le second degré qui lui permettent de supporter les difficultés de l'existence et le soulage de sa condition de simple humain.
500 ans : Copernic et Gallilé s'intéressent à notre univers et découvrent, ébahis, que nous n'en sommes pas le centre et que tout reste à découvrir. A partir de là, les croyances diverses (y compris les religions) vont être mises à mal par le rationalisme et le pragmatisme de la science. Tels des Descartes en puissance, les plus fins utiliseront leur raison pour comprendre le monde et tenter d'apporter des réponses aux multiples questions qui commencent à se substituer à une croyance aveugle. De démonstrations en expériences, l'humain accède à un nouveau niveau de conscience. Il se substitue aux Dieux qu'il avait lui-même inventés.
Nous sommes aujourd'hui, début 21ème, à l'aube d'une nouvelle étape dans cette complexité. Grâce à la technologie, issue elle-même de la toute puissante science, il nous est possible de créer de l'intelligence artificielle. L'enjeu est primordial. Car, en se substituant à notre cerveau, les machines, toujours plus complexes et évoluées, risquent de prendre le dessus et, plus grave, nous risquons de ne plus savoir nous servir de nos capacités cognitives car ne plus en avoir réellement besoin. Se laisser dépasser par des calculateurs, rien que des calculateurs jonglant avec une suite de 1 et de 0 et rien d'autre. Ne plus savoir utiliser cette formidable machine que plusieurs millions d'années d'évolution ont façonné pour nous permettre de développer cette conscience et cet Art.
Cependant, il y a une autre voie que celle, désastreuse, d'un monde régit par des machines où nous serions des pachas, servis et adulés, mais devenus incapables de la moindre pensée. Comme ces chats auparavant sauvages, agiles et prédateurs, qui finissent allongés sur des canapés en attendant une pitance qui tombe dans leur écuelle avec la régularité d'un métronome. Pitoyable. Des animaux en cage. Sauf que les cages, nous les produisons nous mêmes et ne voulons même plus en sortir.
Notre cerveau, merveille des merveilles.
Capable de prendre 35 000 décisions par jour d'après une très sérieuse étude (bon, je suppose que parmi ces 35 000 choix, il y a le fait d'avancer une jambe devant l'autre pour marcher, de jeter un coup d'oeil ici ou là selon notre bon vouloir et bien d'autres choses auxquelles on ne pense même pas). Capable de former des pensés plus ou moins sophistiquées, d'inventer des concepts, de manier des idées. Mais aussi de réguler tout notre organisme sans que l'on en ait conscience.
Notre respiration, par exemple. Bien sûr, on peut l'accélérer ou la ralentir à volonté et cela est clairement une décision (parmi les 35 000 journalières) de notre cerveau. Mais le simple fait de respirer est encore l'oeuvre de notre super ordinateur crânien. Simplement, nous n'en avons pas conscience. Cela est automatique.
Pareil pour notre cœur. Sauf que là, il est déjà plus difficile de l'accélérer (mettons en pensant à un être cher ou en faisant du sport – mais cela n'est qu'une réponse à un stimuli, le besoin de davantage d'oxygène dans nos cellules) mais quasiment impossible à ralentir, voire à arrêter, comme nous pouvons le faire de notre respiration lors des concours d'apnée. Il paraît que certains moines bouddhistes en sont capable. Admettons.
Nous avons un formidable plan de construction de cette fabuleuse machine qu'est notre corps : l'Adn.
Chaque brin d'Adn est capable de coder une protéine pour régler un problème, construire quelque chose : la couleur des yeux, cette façon de se tenir debout et tant d'autres choses. Tout. Tout est régit par ces brins d'Adn.
Tout cela se fait instinctivement, sans y penser. A tel point qu'on peut se demander si le cerveau, si omnipotent soit-il, est impliqué ou simple étranger à cette régulation directe. Une sorte de pilote automatique.
Les cellules de notre langue sont remplacées en moins d'une semaine. Lorsque vous vous en brûlez le bout en buvant un café trop chaud, vous aurez cette sensation de picotement pendant 4 ou 5 jours. Après, les cellules sont neuves et cela, grâce à l'Adn qui décide de remplacer les anciennes. Qui décide ? Pas si sûr. C'est finalement le cerveau qui a le dernier mot, mais on ne s'en rend pas compte, comme pour les battements de notre cœur.
On peut alors imaginer que la vraie intelligence, le fait d'utiliser à cent pour cent notre cerveau serait qu'il soit capable d'agir sur l'Adn. De décider de coder telle ou telle protéine.
Contrairement aux délires cinématographiques où, lorsqu'on parle de super intelligence, on évoque d'emblée des capacités d'Asperger ou encore la télékinésie tout en développant des aptitudes physiques hors normes (voir le film de Besson, Lucy), la suprême intelligence serait de pouvoir commander à notre Adn.
Certains lézards ont la capacité de faire repousser leur queue. Sans chercher très loin, quasiment toutes nos cellules sont changées en quelques mois. Nos blessures cicatrisent, nos os se ressoudent.
En utilisant notre cerveau à pleine capacité, nous serions donc capable de réparer le moindre problème, stopper la division sans limite des cellules cancéreuses, nettoyer nos artères encombrées de cholestérol... Un monde sans médecin ni hôpitaux. Le vrai progrès.
Il n'est pas question ici de parler de super héros capables de super pouvoirs. Nous pourrions juste permettre à nos muscles d'atteindre leur plein potentiel, comme un sportif dûment entraîné. Ce qui n'est déjà pas si mal.
La vraie évolution serait donc de mieux utiliser notre cerveau. Reste quand même de nouveaux capteurs à tisser. Notre système nerveux nous alerte quand quelque chose fonctionne mal : nous avons mal. La douleur est salutaire. Imaginez-vous sans ressentir la moindre souffrance? Cela ne voudrait pas dire que vous n'êtes pas malade. L'ennemi avancerait masqué.
Si l'on veut que notre cerveau déclenche l'action sur l'Adn, il faut qu'il soit informé du problème au niveau cellulaire et ça, notre système nerveux en est parfaitement incapable. Détecter la cellule cancéreuse dès son origine demande un nouveau réseau nerveux dont l'évolution serait seule capable de mettre en place. Le besoin crée la fonction. Pour cela, d'abord être capable de mieux sentir et ressentir notre environnement et, là dessus, nous ne prenons pas la bonne direction en nous entourant de trop de machines.
Soit. Mais il reste quand même une question fondamentale dans ce monde où le cerveau dirigerait absolument tout : étant capable de réparer, de guérir, il serait aussi capable d'empêcher cette horloge biologique inscrite profondément dans nos gênes et qui nous fait vieillir.
L'immortalité tant désirée. Mais est-elle le vrai graal ? Ne jamais mourir implique une inertie sans fond. Et un monde qui n'évolue plus est un monde ennuyeux. Même les montagnes finissent par devenir sable et les étoiles meurent.
14 janvier - l'effet miroir
On ne peut se voir qu'en étant filmé.
On n'écoute sa propre voix qu'en l'enregistrant.
On ne peut voir la montagne sur laquelle on se trouve.
Le plus beau miroir, c'est l'autre.
Ce recul nécessaire pour mieux se connaître est obligatoire. Nous avons donc besoin des autres, au-delà même de nos besoins vitaux, ne serait-ce que pour savoir si on a une tache sur le front ou un morceau de salade collé aux dents. Cette proximité, ce reflet, nous permet d'en savoir plus sur nous-mêmes. Cela contient les dérives. Sans vouloir généraliser, les déviants et autres délinquants sont, la plupart du temps, des personnes à la sociabilité douteuse. Rejetés par la société ou d'eux-mêmes.
L'écueil est là : en voulant trop se conformer aux standards en cours, on peut y perdre sa personnalité, s'enfermer dans une conformité, une similitude qui a tôt fait d'exclure celui ou celle qui ose s'en affranchir. On rejette ce qui ne nous ressemble pas, on ne comprend pas ce qui pense différemment, qui agit d'une autre façon. Et de l'ignorance naît la peur.
Mais nous sommes des animaux sociaux et nous devons nous conformer à certaines règles de vie. Libre à nous d'étendre le plus possible cette normalité. Cela se nomme la tolérance.
Et justement, cette tolérance ne peut s'acquérir qu'en étant capable de se mettre à la place de l'autre. Encore une fois, changer de point de vue.
Cet effet miroir du regard de l'autre agit également sur nous-mêmes : nous ne sommes plus tout à fait pareils dès lors que l'on nous regarde. Cela s'exprime particulièrement dans les relations amoureuses. Pour changer, pour évoluer, nous avons besoin d'un regard étranger. Et plus celui-ci est éloigné, plus sommes sommes amenés à changer.
La prise de conscience écologique s'accéléra avec les premières photos de notre planète prises de l'espace. Pour la toute première fois, on pouvait voir la montagne sur laquelle on se trouvait. Et cette sphère bleue, perdue au milieu d'un océan noir, tel un radeau à la dérive, nous fit prendre conscience de sa beauté et de sa fragilité. Or, on chérit d'autant ce qui est délicat.
Prendre du recul, d'abord face à soi-même puis aux schémas qui nous font voir ce qu'il est autorisé de voir – mais pas toujours bien ou juste.
Voir le monde sous un angle différent, être capable de se mettre à la place de l'autre est un bon début. Il existe un moyen simple pour y parvenir : le rire.
L'humour permet ce recul, ce pas de côté. En ajoutant un second degré, on prend du champ face aux choses.
Dans le Cercle des Poètes Disparus, Keating grimpe sur une table pour avoir une autre vision des choses. Nous aurions intérêt à changer de point de vue, à grimper, nous aussi, sur des tables.
La dérision de l'humour, davantage qu'une ironie somme toute assez stérile, offre non seulement du baume au cœur, un pansement à l'âme, mais aussi la possibilité de voir le monde différemment et peut-être de mieux le comprendre, afin d'éventuellement changer ce qui ne va pas.
Etre capable de rire de soi est une belle alternative au regard de l'autre. Cela demande une schizophrénie basique : être capable de se regarder du dehors. Posséder ce talent du détachement, cette faculté de tout relativiser, à commencer par sa propre importance.
Ce n'est pas de la fausse modestie, c'est une tentative de lucidité. Plus généralement, ne pas accorder trop d'importance aux choses, même les plus sérieuses. Déboulonner les statues, peut-être pour mieux les admirer. Remettre en question les théories les plus admises afin de mieux les comprendre. Désacraliser l'Art et l'Amour pour mieux en jouir.
La philosophie n'est rien autre chose.
Mais le rire et l'humour sont à la portée de chacune, de chacun. Si l'on ne rit pas tous des mêmes choses, tout le monde rit. Car tout le monde peut observer ce décalage des choses. L'ombre des choses.
7 Janvier - le besoin et le nécessaire
C'est en lisant le Nom de la Rose d'Umberto Eco dont un chapitre entier repose sur le débat du degré de pauvreté du Christ que je me suis posé la question : que doit-on, que devrait-on pouvoir posséder ?
Cela renvoie aussitôt à notre empreinte carbone. Quel est notre impact sur notre environnement ? Cela peut se résumer à lister nos possessions. Tous ces objets qui nous entourent, il a fallut les penser, les concevoir, les fabriquer. Ensuite les réparer (parfois), les entretenir (souvent) et, enfin, les détruire ou les recycler. Tout cela demande de la matière première et surtout de l'énergie, qu'il faut bien prélever quelque part.
Pour en revenir au Christ, bien que les écrits à son sujet ne se penchent pas particulièrement sur le problème, il semble évident qu'il n'était pas un grand seigneur aux multiples dépendances. Certains iront jusqu'à ergoter qu'il possédait au minimum les vêtements qu'il portait. De là, cette idée d'usage.
Donc, nous pourrions nous contenter de ne posséder que ce dont nous avons l'usage. Comme n'importe quel animal possède son terrier, son nid. Et encore, ne le possèdent-ils pas, stricto sensu. Il existe une différence entre la propriété, dont nous avons l'usage pour nous abriter, et la propriété privée qui demeure interdite à toute personne étrangère. Le territoire d'un prédateur n'est pas autre chose. Prière de ne pas pénétrer dans mon garde-manger. Passez votre chemin, en restant à bonne distance et tout se passera bien.
Le problème de l'humain vient de sa position bipédique. En libérant nos mains, nous avons permis leur usage à façonner des objets, ces objets qui nous sont comme une seconde peau et qui ont tendance par finir à nous submerger.
Certaines tribus amérindiennes soutenaient que l'on ne devait posséder plus que ce que l'on pouvait porter. Faites le test. Prenez un sac à dos conséquent, quarante litres, et remplissez-le de l'essentiel. Pas facile, hein ?
Certains ont relevé le défi : ça s'appelle le challenge des cent objets (100 thing challenge). Ni plus, ni moins. On peut biaiser en incluant TOUTE sa bibliothèque ou sa discothèque dans un petit disque dur. Mais les livres, les films ou les disques ne tiennent pas chaud l'hiver.
L'autre difficulté réside dans cette attribution de parcelles de terre, à tel point qu'on en a fait un mètre étalon : chaque être humain aurait besoin de deux hectares de terre. Deux hectares, ça semble immense, surtout quand il faut s'en occuper. Mais deux hectares pour se nourrir, extraire son énergie, fabriquer toutes ces choses que l'on croit indispensables, c'est peu.
D'autant que nous ne sommes pas égaux devant un tel partage, ça crève les yeux. Pourtant nos besoins basiques sont quasiment les mêmes.
De l'usage, nous passons à la possession, puis à l'excès (générant en même temps des déchets et, bien souvent, du gaspillage) et enfin à la futilité.
Si tous les habitants du monde avaient le même train de vie qu'un américain (j'entends un habitant des Etats-Unis), nous aurions besoin de sept planètes. Et notre Terre est unique. Ses ressources sont forcément limitées. Un bambin de cinq ans en présence d'un gâteau au chocolat le comprend parfaitement, alors pourquoi les décideurs politiques ou économiques s'entêtent-ils à ne pas le voir ?
Vincent Munier est un photographe animalier. Pour capturer l'image fugitive d'un animal rare, il doit se tenir à l'affût pendant de longues heures, des jours entiers parfois. Planqué derrière un rocher au bout du monde, il attend, tous ses sens en éveil.
Et il est heureux. Cela se voit dans son œil pétillant ou ému quand l'objet de son attente daigne simplement se montrer.
Il n'a besoin que de vêtements chauds (les conditions sont parfois à limite de ce que peut endurer un humain normalement constitué) et d'un peu de nourriture. Le strict usage. Bon, d'accord, aussi d'un matériel conséquent. Mais d'un point de vue purement égoïste, il pourrait s'en passer. Les caméras et longues focales, téléobjectifs et trépieds ne servent qu'au partage de cette émotion pure.
Le bonheur ne dépend donc pas des objets et de l'espace que l'on possède. Le bonheur est intérieur. La vie personnelle de Vincent Munier est sûrement bien plus riche que celle de n'importe quel grand patron de multinationale ou d'actionnaires milliardaires.
Etre riche de ce que l'on est, non pas de ce que l'on a.