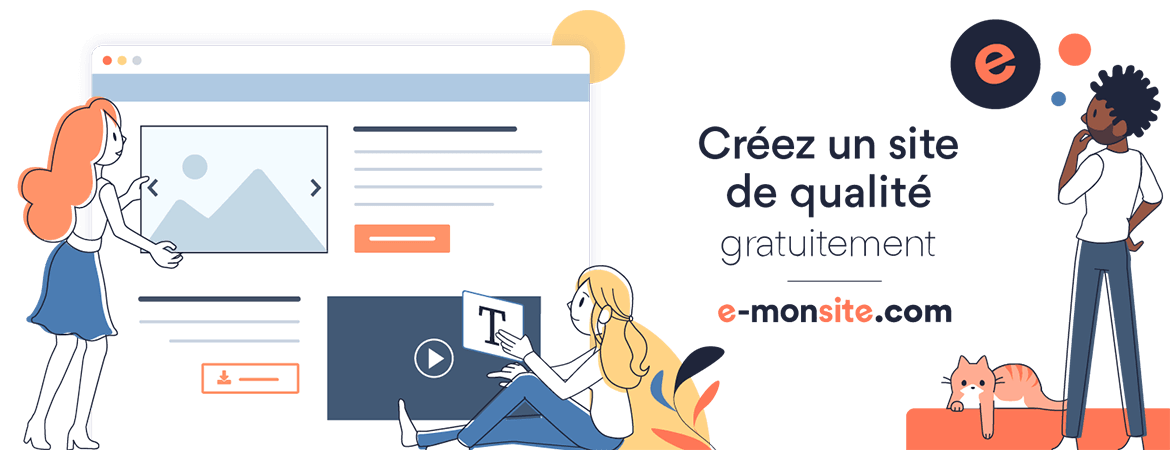Celui qui voulait parler aux animaux
Celui qui voulait parler aux animaux. C’était une nuit étoilée de début d’été. L’odeur de l’herbe fraichement coupée se mêlait aux effluves plus subtiles du foin séché. Pas de lune dans le ciel. Juste quelques milliards de points lumineux scintillant dans la fraicheur nocturne. Les sapins tendaient leurs multiples bras des deux côtés de la saignée formée par la route menant au col. Une chouette, éblouie par le faisceau des phares de l’automobile, poussa un ululement que l’homme n’entendit pas. Pas plus qu’il ne voyait les arbres autour de lui. Pas davantage qu’il n’admirait le ciel de la voie lactée. Il ne voyait que des chiffres. Celui du compteur de son coupé sport. Celui de son compte en banque. Et puis ceux du cours des actions dont il s’occupait. Ceux qu’affichait sa montre, car l’homme était toujours pressé comme s’il était éternellement en correspondance entre deux trains. Il courait, courait après le temps, après l’argent. Et bien évidemment, ne les rattrapait jamais. Pas de place pour la contemplation dans sa vie. Sa vie. Il ne la vivait pas, il la traversait. Pas de place pour la compassion. Personne ne se souciait de lui, il n’allait pas s’intéresser aux autres. Il alignait des chiffres à longueur de journée. Achetait, vendait. Il connaissait les marchés par cœur. Il avait New York et Tokyo tous les jours au téléphone. Il ne prenait pas de vacances. L’économie mondiale partait-elle en vacances? Tout au plus, il se rendait dans les montagnes proches pour courir. L’homme ne savait pas marcher. Pour parcourir un kilomètre, il utilisait son bolide, et lorsqu’il chaussait sa paire de baskets c’était encore pour courir, fendre l’air, remplir ses poumons trop comprimés par l’atmosphère viciée de la ville, faire jouer ses muscles atrophiés de rester assis toute la journée devant plusieurs écrans, téléphones, fax. Il courait dans la forêt mais ça aurait pu être n’importe où puisqu’il ne voyait rien, ne regardant que sa montre qui, en mode chronomètre, lui permettait de battre ses propres records. L’engin ronronnait sur la route ensommeillée, déchirant la nuit noir du pinceau de ses phares. L’homme portait une paire de gants en cuir brun et tapotait de ses doigts sur le volant tout en sifflotant l’air que diffusait son installation stéréophonique. Il fendait ainsi l’immense étendue d’arbres sans communiquer avec elle, comme un Boeing traverse des pays entiers sans y prêter la moindre attention. Il y eut un choc. L’homme stoppa immédiatement son véhicule dans un crissement de bête qu’on égorge. Le silence enveloppa aussitôt l’atmosphère, seuls quelques craquements dû aux pièces de métal du moteur qui déjà se refroidissait. L’homme resta assis quelques secondes, contrarié. Il descendit en s’inquiétant du dommage causé à la carrosserie de son automobile sans chercher à savoir dans un premier temps ce qui avait provoqué le choc. Il fit le tour de ce qu’il considérait comme le prolongement logique de son être, de ses jambes: quatre roues motrices, deux cents chevaux de puissance contenue dans les cylindres impeccables du moteur, un habitacle confortable qui, sans y penser réellement le protégerait en cas d’accident. De quoi filer sur les routes du monde si l’on exceptait les arrêts obligés dans les stations service. Il examinait minutieusement la calandre. Les phares bleutés lui renvoyaient une lumière spectrale qu’aucun clair de lune ne pourrait atteindre. Une plainte le sortit de son inspection. Il s’avança. Là, à quelques pas devant lui gisait une forme incertaine, baignée de la lumière bleutée. L’animal avait été projeté sous l’impact et se tordait sur le bitume. L’homme s’accroupit devant une fourrure tirant sur le roux avec des reflets argentés, mais c’était peut-être la lumière irréelle qui lui donnait cet aspect. L’animal tourna la tête vers l’unique responsable de toute la scène. Une forêt majestueuse. Une route de montagne serpentant parmi les cimes vertes donnant une impression de bleu lorsqu’on les observait de loin. Une voiture du prochain millésime éclairant les lieux comme un vaisseau spatial garé au bord de la route. Un homme baissé sur la chaussée. Et un renard qui déjà voyait défiler les quelques mois de sa vie. Il n’aurait pas connu l’hiver qu’on dit long et rude. L’animal regardait fixement l’homme. Celui-ci était hypnotisé par les yeux du renard. Il semblait lui parler, lui dire sans mots ses dernières pensées. Il n’y avait plus de peur dans les yeux du mammifère. Il savait qu’il allait mourir. Ce n’était qu’une question de minutes, peut-être vivait il ses dernières secondes. A ce stade, nul humain ne pourrait plus lui faire de mal. Il ne craignait rien. Apaisé. Il n’y avait également aucune amertume dans ses pupilles. Comme si tout cela devait se terminer ainsi. C’était écrit dans le grand livre de mère nature. Résigné. Il n’y avait aussi nul soupçon de rancune, pas une once de ressentiment envers son meurtrier par accident comme si l’animal avait comprit qu’il n’y avait pas de responsable. Ou plutôt, si, un seul fautif qu’on appelle le hasard et qu’on ne peut saisir ni trainer en justice. Le hasard est libre comme l’air, il frappe là où ça lui chante, aléatoirement, dans le bon comme dans le mauvais, pour la vie et pour la mort. Nulle amertume dans le regard du renard. Il regardait l’homme droit dans les yeux comme jamais un animal de sa condition ne pourrait le faire. L’instinct de fuite devant le plus grand prédateur au monde avait disparu. La frayeur de l’odeur humaine l’avait quitté au seuil du trépas. Il semblait apaisé, comme s’il dégustait une récompense grandement mérité. L’homme ne pouvait détacher son regard de celui de la bête alors qu’il lui était impossible de soutenir le regard implorant du sdf croisé dans la rue, affalé sur le trottoir parmi ses cartons et sa crasse. Qu’il était mal à l’aise devant un lit d’hôpital où quelqu’un luttait contre la maladie. Il était gêné devant l’innocence et la naïveté d’un enfant lui posant une question à laquelle il n’avait pas de réponse alors qu’il n’avait pas son pareil pour analyser le marché, y déceler les moindres indications, lire entre les cours de la bourse comme une cartomancienne voit dans sa boule de cristal. Et dans les yeux de ce renard dont il avait brisé la vie, il y avait tous ces regards. Comme une prière que l’on adresse à son bourreau, pas pour soi même mais bien pour le salut de son âme à lui. Sans en avoir la moindre conscience, ce regard le bouleversa. Les yeux du renard se fermèrent. Sa fourrure se souleva une dernière fois, un ultime soupir s’échappa de sa gueule et ses pattes arrières furent l’objet d’un long tressaillement. Puis ce fut fini. L’homme resta accroupi quelques minutes. Dans son cerveau, c’était le grand ménage. Il faut imaginer un grand déménagement ou plutôt une fuite. Un ministre impliqué dans de sombres affaires, un trafiquant de marchandises douteuses, un gangster de haut vol, sur le point d’être arrêtés par la police. On évacue le plus rapidement possible les papiers compromettant, les sachets de poudre illégaux, le butin fraichement dérobé et tout cela dans une économie de gestes, comme si chaque seconde était comptée. Comme un film en accéléré. On nettoie le préjudiciable, on range, on ordonne. Tout cela s’agençait dans le cerveau de l’homme et lui demandait une telle énergie qu’il était incapable de se relever, le regard toujours fixé sur l’animal mort, une simple dépouille qui ne tarderait pas à avoir la visite des insectes nécrophages. Au petit matin, peut-être avant; non, la nuit était suffisamment fraiche. L’homme émergea enfin de sa léthargie qui ne devait rien à la fraicheur nocturne. Ses genoux émirent un craquement osseux lorsqu’il se déplia. Il était sonné tel un boxeur sortant du ring. Une lueur s’était allumée au fin fond de sa conscience, réchauffant un cœur plus dur que du diamant. Il n’était plus une machine à compter, à accumuler de l’argent, pas encore un homme responsable de ses actes. Un automate qui se dirigea vers le coffre du coupé dont le capot, encore chaud, laissait s’épanouir des volutes de fumée, vapeurs mécaniques s’élevant dans l’air pur de la nuit. Le hayon se releva dans un gémissement presque animal. L’homme inspecta le réceptacle résolument vide, désespérément désert. La chaleur humaine peut se lire aisément dans le désordre d’une pièce à vivre, l’encombrement d’un couloir, d’un vestibule et, plus surement, par l’embarras hétéroclite d’un coffre de voiture. Ici, rien ne traine. Pas même un journal, une revue, un quelconque relief d’une existence vécue. Le coupé sport pourrait très bien sortir du garage, acheté la veille. Ce constat d’une vie policée, raffinée, sophistiquée laisse l’homme dans un état de questionnement sans comparaison. Qu’a-t-il fait de sa vie? Qu’a-t-il proposé aux autres. Qu’en attend il? Tout cela a-t-il un sens? D’un geste las, il referme le coffre qui tombe dans un bruit mat, comme une porte de prison qu’on clos, une prison luxueuse, capitonnée, confortable, des murs de coton qui isole du dehors. Il n’a pas trouvé ce qu’il cherchait. Dans sa vie égoïste, nulle place pour les objets qui tendent à rendre service, qui vont vers les autres. Alors il arpente lentement le bas-côté de la route désolée à la recherche d’un outil primaire et dans sa tête germe l’idée que des milliers d’années auparavant, un homme peut-être plus semblable à lui-même qu’il ne veut se l’avouer, un homme était à la recherche du même outil. Quelque chose de tranchant. Pour creuser la terre. Enfouir. Tous ses gestes sont exécutés au ralenti, comme si l’intense activité cérébrale empêchait ses muscles de fonctionner à plein régime. Il creuse au pied d’un arbre dont il ne connait pas le nom un trou et les odeurs d’humus viennent flatter son nez. Jamais encore il n’avait ressenti une telle profusion d’odeurs. Il ne sent pas simplement la terre fraichement retournée, mais l’humus en décomposition et, au-delà, toutes les matières organiques qui le compose, les feuilles mortes, les pousses avortées, quelque chose d’animal aussi, le cadavre d’un oiseau mort, une senteur de champignon. Toutes ces fragrances se mêlent en gardant leur identité propre comme une foule compacte dont on ne discerne les individualités qu’en s’approchant au plus près. Une douleur irradie son dos. Des muscles trop longtemps restés en jachère, des tendons jamais sollicités, se réveillent dans une souffrance de purgatoire. Il sait à cet instant que sa vie n’est pas la vie, qu’il s’est engagé sur le mauvais chemin. Il retourne chercher la dépouille encore chaude de l’animal qu’il empoigne à pleines mains. Impensable. Lui qui ne mange les fruits qu’avec un couteau et une fourchette. Il sent les muscles de la bête rouler sous ses doigts, peut palper ses entrailles. Puis il dépose délicatement le corps de l’animal dans le trou sombre. Il reste un instant qui s’éternise. Un recueillement. Même pas une prière. Une communion. Il a comprit. Rebouche le trou, ensevelissant la fourrure rousse. Il doit abandonner sa vie tout comme l’animal a quitté cette existence pour un autre monde. Il ne remonte pas dans sa voiture. Tous ses objets lui sont devenus étrangers. Il marche droit dans la forêt, son nouveau domicile. Les premiers jours furent éprouvants. Il maigrit. Ses traits se creusèrent. S’il n’avait plus sa place dans le monde d’où il venait, il n’avait pas encore gagné la sienne dans cette nouvelle vie. La forêt lui faisait passer un examen d’entrée. On ne s’improvise pas homme des bois en claquant des doigts ou par un simple click de souris. Il y eut des moments de découragement. Beaucoup. Lorsqu’il allait renoncer, le regard du renard venait le soutenir, lui souffler des paroles d’encouragement. En quelques semaines, il s’était fondu dans les entrelacs de la forêt, son nouveau monde. Bientôt, la légende se répandit partout dans la vallée: un homme vivait seul dans les bois, comme un animal. Personne ne l’avait vu, à peine entraperçu par des cueilleurs de champignons, juste deviné par quelques randonneurs perdus. Un mouvement dans les branches, un fourré qui tressaille, des bruits incongrus, mais pas de présence visible. Redevenu animal, l’homme s’était débarrassé de son enveloppe. Il s’était mis à nu, au propre comme au figuré. Puis, il s’était vêtu de feuilles reliées entre elles avant de se confectionner un habit en peau de lièvre. Son odeur humain l’avait quitté. Il puait. Mais ce qui repousse les autres humains, le faisait accepter par la faune de la forêt. Bientôt, les habitants animaliers renoncèrent à leur crainte ancestrale de l’homme, car ce n’était plus un homme. On parla de lui comme du Tarzan de la forêt. Toutes ces digressions sur son compte l’auraient laissé indifférent s’il en avait eu connaissance. Il ne s’occupait plus du monde humain mais constatait, comme un animal pris au piège, que la société de ses semblables ne laissaient jamais tranquille cet océan de verdure, pourtant l’une des zones les plus sauvage du pays. Il fallait se méfier des chasseurs l’automne venu, des braconniers toute l’année, des forestiers qui irritaient maintenant ses oreilles par leurs bruits de moteurs. Il avait acquit l’instinct animal qui les pousse à fuir devant l’homme. Seul vestige de son passé d’humain, il domestiquait toujours le feu. Il n’était pas encore revenu au temps préhistorique de la viande crue. D’ailleurs, il ne se nourrissait rarement de viande, excepté quelques larves, insectes, fourmis rouges, très épicées et donnant une sensation de chatouillis dans la bouche. Son palais avait changé, il ne rechignait plus aux plats forts en goût. Il passait ses nuits roulé en boule au pied d’un gros chêne ou tapis dans un fourré, plus rarement en équilibre au creux de branches entremêlées à la cime d’un pin. Les mois et les années passèrent. Désormais, il approchait jusqu’à une caresse les biches et les cerfs. Parfois, au cœur de l‘hiver rude, il dormait blotti contre la chaleur d’un sanglier. Les écureuils mangeaient dans sa main. L’univers animal n’avait plus à craindre de lui, il était de leur monde dorénavant. S’il n’effrayait plus les animaux à son approche, son but allait au-delà d’une simple acceptation, d’une entente, il désirait une complicité plus profonde. Son regret était de n’avoir pas pu, pas su comprendre ce que le renard avait voulu lui dire au seuil de la mort. Il souhaitait communiquer avec les hôtes de la forêt, se confondre avec eux. Dans la vallée, l’homme des bois, le fou de la forêt était surnommé celui qui parlait aux animaux. Une collaboration s’était installée entre espèces. Il épouillait les fourrures en échange d’un peu de chaleur, d’un repas partagé. Les mammifères chassaient pour lui. Il avait abandonné le feu. Il vivait en animal, enfin accepté comme tel par la faune forestière. Et, en effet, il leur parlait. Pas avec des mots, le langage spécifiquement humain permettant de masquer ses émotions, ses intentions, de les travestir, les pervertir. Il émettait des grognements, des bruits de langue, expirant d’une certaine façon l’air contenu dans ses poumons, son visage reflétait également ses impressions. Le mensonge n’existait plus. Plus aucune ambigüité. Il se prit de passion pour les volatiles. On le voyait perché à la cime des plus grands résineux, contempler le vol limpide des rapaces, tendant les bras où corbeaux et pies venaient se poser. Il parlait le langage de la forêt, sachant imiter chaque cri, chaque plainte, le moindre murmure de toutes les espèces. Il observait l’apprentissage du vol par les oisillons sortant du nid. Cela le fascinait. Après avoir assimilé les coutumes des mammifères, des rongeurs, des cervidés, s’être intégré dans un milieu sauvage et sans concession, il voulait voler. Il passait dorénavant ses journées perché à la cime des plus hauts arbres, épiant le majestueux vol des rapaces, jouant avec le vent et les courants, se laissant porter tout en maitrisant avec grâce le souffle de l’air. Les pirouettes aériennes des hirondelles le ravissaient, le vol maladroit du geai l’émouvait, les prouesses célestes de la buse l’enivraient. Cela devint une obsession. Ses compagnons terrestres le regardaient sans comprendre. Ce personnage était venu du monde bruyant, tumultueux et dangereux des humains. Peu à peu, il avait quitté leur odeur, leurs coutumes meurtrières, leur prétendue supériorité, et s’était comporté comme un des leurs. Ils l’avaient alors accepté tout en gardant un soupçon de méfiance instinctive que lui n’avait pu deviner. A présent, il leur échappait. Les animaux de la forêt à l’esprit de synthèse limité, dont l’intuition remplaçait la cognition et dont les sens se substituaient à l’intelligence, perçurent que l’homme ne trouvait pas sa place. Quittant son monde trépidant, il n’avait pas su trouver la sérénité auprès d’eux, sur la terre ferme. Il lui fallait expérimenter à nouveau. Ne trouvant sa place nulle part, l’esprit de l’homme errait sans trouver la tranquillité d’une vie simple. Peut-être était-ce cela l’âme humaine? Ne jamais se satisfaire de son sort. Vouloir toujours aller au-delà. Les animaux ne comprirent pas davantage sa passion pour les oiseaux qu’ils n’avaient saisi son désir de vivre parmi eux. Un beau matin, l’homme vit les deux corbeaux posés sur son bras droit décoller et s’envoler au dessus du faîte des arbres. L’envie était trop tentante. Il s’élança à leur suite, déployant ses bras dans un vol éternel.