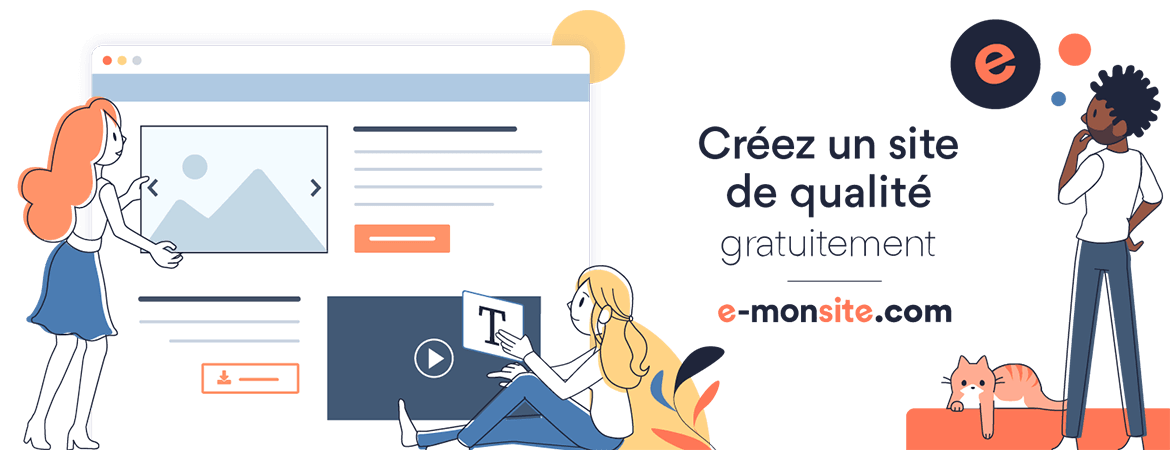Mots d'estomac
« Et pour Monsieur, ce sera? »
Cette phrase, ce questionnement qui appelle une réponse pleine d’espoir, on l’a tous entendu au moins une fois dans notre vie.
Espoir de remplir son estomac tout en titillant agréablement ses papilles.
L’art d’allier plaisir et devoir, satisfaire sa gourmandise et fournir l’alimentation de nos cellules est typiquement une spécificité française et je dois le reconnaitre, je m’y entends assez bien.
Pourtant ce n’a pas toujours été le cas.
Savoir bien manger, ça s’apprend. Je dirais même que c’est l’éducation primordiale de la vie, avant même de savoir vivre en société. Eduquer son palais avant de penser à la politesse. On devrait enseigner cet art à tous les enfants dans chaque école, de faire de la cantine une vraie salle de cours. Théorie et travaux pratiques.
Je n’ai pas apprit à bien me nourrir à l’école.
Ce ne sont pas mes parents qui m’ont inculqué l’art de savoir s’alimenter.
Ce n’est pas par goût, ni par passion. Aucune révélation ne m’a mis sur la bonne voie de la gastronomie.
Pas davantage par amour d’une femme ou par respect d’un maître.
Cependant je fus amené à en faire mon métier.
Je suis un simple agent immobilier, conseiller en transactions patrimoniales, je préfère. Tout est question de vocabulaire. Les mots sont les ingrédients du langage. Bien les choisir, savoir les marier, les cuisiner à la perfection.
J’avoue être assez doué dans mon domaine.
Je sais reconnaitre la valeur souvent cachée des biens qui passent entre mes mains et j’ai le don de savoir les mettre en valeur en quelques phrases. Un bon conseiller ne doit pas trop parler tout comme une assiette ne doit pas déborder de victuailles.
Les parfums, les épices, le goût doit être au centre et jamais simple accessoire.
Au début de ma carrière, on me refilait systématiquement les moutons noirs de notre catalogue. Des demeures bancales, des maisons délabrées, des manoirs qui se prenaient pour des châteaux et des bicoques qui avaient l’orgueil de Versailles.
Mes collègues ne voyaient pas le petit plus que possède systématiquement toute chose. Moi si.
Une bâtisse partait en ruines? Je vantais son cachet, la douceur de son jardin, son exposition exceptionnelle.
Celle-ci souffrait d’une vue atroce, d’un voisinage immonde? Je ne faisais pas sortir mes visiteurs, leur plongeant le nez dans des pièces vastes, magnifiquement aérées, aux plafonds sublimes, aux murs chaleureux, aux parquets impeccables.
Le prix de celle-là était inconsidéré? Je misais sur l’investissement dans la pierre, une assurance sur l’avenir, je leur parlais famille, postérité, un avant goût d’éternité.
Je m’amusais comme un petit fou et les actes de vente se multipliaient à la mesure de ma promotion au sein de l’agence.
La vie d’un conseiller immobilier n’est pas ce que l’on peut considérer comme une petite existence pépère. Je passais toutes mes journées sur la route, à discuter âprement avec des vendeurs trop gourmands et des acheteurs trop frileux.
Mes repas se réduisaient souvent à un morceau de sandwich, parfois un hamburger avalé à la va-vite debout ou sur un coin de table. Les déjeuners professionnels se réduisaient à n’être que le support d’échanges verbaux, de transactions financières où l’amour de la gastronomie n’a que peu de place.
Bref, je m’alimentais n’importe comment, avalant n’importe quoi n’importe quand.
Je ne dégustais jamais, ni même mangeais, je n’étais qu’un vulgaire tube à absorber de la nourriture mal préparée.
Ca a commencé un après midi. Je n’avais pas fait d’excès pourtant, juste la routine alimentaire qui ponctuait mes jours. Je roulais au milieu d’une campagne de carte postale, haies d’arbres délimitant des parcelles fraichement tondues, quelques champs où s’agitaient sous le vent printanier les millions de tiges de cultures dont je ne connais pas le nom, le tout chapeauté par un ciel rendu encore plus beau par la présence de quelques cumulus bien joufflus.
Ma petite berline avalait le bitume dans un ronronnement agréable, Verdi avait traversé les siècles pour venir distiller ses notes dans mon autoradio, la vitre côté passager aux trois quarts levée laissait entrer un air suffisamment frais pour que je ne succombe pas à l’envie d’une petite sieste. Tout allait bien.
Dans ma petite sacoche de cuir élimé, posée sur le siège avant, les contrats de vente en trois exemplaires qui n’attendaient plus que la signature de l’acheteur d’une belle propriété vers laquelle je me rendais le cœur léger et l’esprit libre.
Tout était parfait.
J’allais m’engager dans la longue allée de graviers bordée de peupliers lorsque je ressentis une douleur au niveau du ventre. Il me semblait qu’une main empoignait mon estomac comme une balle de mousse qui aide à la rééducation des accidentés des doigts.
Je déglutis, pensant stopper par cette action un petit désordre stomacal. Ce n’eut pour effet que de provoquer un rot bien sonore suivi d’un haut-le-cœur qui n’augurait rien de bon.
Je n’ai jamais été sujet à des désordres intestinaux.
Mes seuls rapports avec le corps médical se bornaient aux relations occasionnées par les transactions immobilières où j’étais le représentant des chanceux vendeurs et eux les heureux acheteurs. Je n’ai jamais mis les pieds dans un cabinet médical pour une autre raison que d’effectuer les rappels nécessaires aux différents vaccins qui rythment notre vie.
Je ne connaissais ni les migraines qui vrillent de la nuque au front, enserrant effroyablement vos tempes, ni les courbatures qui vous font déplacer comme un vieillard, pas davantage les genoux récalcitrants et les épaules douloureuses.
J’ignorais les délices inavouées des gastroentérites, les états de fatigue générale suite à l’infection de pernicieux virus, les fièvres carabinées qui vous anéantissent mieux qu’un rouleur compresseur.
Aucun souvenir d’avoir contracté une maladie infantile.
Les désordres médicaux m’évitaient.
Je ne suis pourtant pas une force de la nature, je ne fais pas de sport et mon régime alimentaire, je l’ai déjà mentionné, n’est pas une référence de vie saine.
J’étais donc le premier surpris de ce chambardement intérieur. Très vite, il me sembla que le contenu de mon estomac ne prenait pas le chemin régulier, qu’il y avait erreur d’aiguillage. J’avais un problème.
Je m’étais arrêté au bord de l’étroite route sur laquelle je cheminais, deux pneus sur la bande herbeuse qui tient lieu d’à côté et les deux tiers du reste de mon véhicule interdisant à quiconque de pouvoir me croiser.
Quant à moi, j’étais plié en deux, une main crispée sur le capot encore chaud, terrassé par d’étranges convulsions qui secouaient mon ventre dans tous les sens.
Un artisan boulanger aurait pétri mon estomac afin de lui rendre une consistance pâteuse que je n’aurais pas été surpris outre mesure.
Par chance la petite route était déserte et, pour la première fois de ma vie, je régurgitais mon repas par saccades accompagnées d’atroces bruits et une odeur qui ne pouvait provoquer que de nouveaux accès barbares.
Les aliments, je ne les reconnaissais qu’à leur couleur et quelques morceaux mal mâchés. Une bouillie pour bébé s’échappait de mon ventre par un œsophage brûlant d’acide et une gorge meurtrie comme si un ramoneur y avait râpé son hérisson toute la nuit.
Mais au-delà du désagrément causé par cette éjection contre nature, je ressentais comme une honte, l’humiliation de subir le disfonctionnement d’un corps qui m’avait toujours été fidèle.
Je me relevais douloureusement. L’expulsion du contenu de mon estomac m’avait scié les jambes et je dû me retenir à la carrosserie de la voiture. Je chancelais. La tête me tournait. Ma vision devenait trouble par moments. L’horizon dansait devant mes yeux encore pleins de larmes.
Je fis quelques pas comme un nouveau né qui s’essaie à tenir debout. Je m’équilibrais de mes bras, moulinant dans l’air qui me semblait froid tout à coup. Je frissonnais. J’enfilais une veste posée sur la banquette arrière et me remis au volant. Par chance, j’ai toujours une bouteille d’eau minérale dans le coffre. Je me rinçais la bouche abondamment, n’hésitant pas à gargariser au-delà du raisonnable. Toutes sortes de glougloutements s’échappaient de ma mâchoire. Je n’arrivais pas à faire disparaitre la puanteur intérieure. J’eus plusieurs fois des hauts le cœur qui comprimèrent mon estomac vide mais sans plus de résultat que de me tordre le ventre.
Je n’avais plus rien à rejeter. J’étais vidé dans tous les sens du terme. J’attrapai mon téléphone cellulaire et composais le numéro de mon client. Par chance, celui-ci décrocha à la seconde sonnerie. Je prétextais un quelconque empêchement et fixais le rendez-vous pour le lendemain, même heure. Il fut charmant et me rassura que ça ne le dérangeait pas, mais j’avais noté un léger silence et le ton de sa voix était plus sec, sur les deux premiers mots de sa formule de politesse en tout cas.
Je rentrais chez moi.
Je me brossais les dents avec vigueur et j’avalais une tasse de thé à peine infusé, autant dire que je me rinçais l’estomac à l’eau bouillante.
Cela me fit un bien fou. J’avais l’impression de poser des pansements sur mes blessures, une pommade sur mes ecchymoses.
J’avais oublié cet incident quand, deux semaines plus tard, la même scène se reproduit, avec plus d’intensité cette fois et dans des conditions nettement plus embarrassantes.
On donnait un opéra pour l’inauguration du nouveau centre culturel municipal. Tout le gratin de cette moyenne ville d’Ile de France était là, au grand complet. Et je faisais partie du carré v.i.p.
J’avais, en effet, participé à la transaction visant à acquérir ces murs qui allaient abriter un projet qui mettrait en valeur la politique du nouveau maire. Cinq mille mètres carrés consacrés à l’art en général, une galerie de peinture aux expositions permanentes, divers ateliers d‘artistes plus ou moins renommés, une bibliothèque et une médiathèque entièrement informatisées, un espace jeux afin que les futurs électeurs ne soient pas oubliés et surtout, cette salle modeste -deux cents trente places seulement- mais à l’acoustique impeccable qui devait permettre d’accueillir les grands noms du lyrique, de la chanson et des musiques nouvelles.
Il ne m’avait pas été difficile de convaincre le propriétaire des terrains nécessaires à la construction du complexe ultra moderne. Ces friches, il n’en faisait rien. Ancien cultivateur, il noyait dorénavant sa retraite dans ses trois litres de mauvais rouge quotidiens.
Je le connaissais bien le père Mathieu. Petit, il effrayait mes camarades de classe mais moi, j’avais mon secret.
Il parait qu’il avait été marié autrefois, mais nous ne l’avions jamais vu que solitaire, arpentant ses vignes ou au volant de son tracteur. Il ne se déplaçait qu’avec son engin qui pétaradait des champs jusqu’au village où il venait boire un canon au café de la place. Il ne faisait jamais de courses, n’achetait jamais rien. Le monde aurait pu s’écrouler, il aurait continué à vivre sa vie, solitaire et indépendant. Ses uniques achats se limitaient à un bidon d’huile pour son engin qui fournissait une fumée bien noire ou encore du fil de fer barbelé dont il entourait consciencieusement ses terrains.
Le père Mathieu était une force de la nature. Je l’ai vu enfoncer des piquets de clôture en trois coups de masse, un outil que je n’ai jamais pu soulever du haut de mes dix ans. Une simple taloche d’un tel personnage vous envoyait directement à l’hôpital. Il était craint, et pas seulement des enfants du village.
Je me rappelle très bien le jour où je me suis retrouvé nez à nez avec lui à l’orée du bois. Il débitait des piquets dans les troncs fins des bouleaux qui bordaient son terrain. J’étais resté immobile face à ce personnage inquiétant, hypnotisé, voyant ma dernière heure venue. Un coup de hache et, hop! Il m’aurait certainement enterré au milieu de la forêt, ni vu ni connu. Les gens du village auraient pensé à une fugue. On n’aurait jamais retrouvé mon corps. Moi qui haïssait les leçons de catéchisme du vieux curé de la paroisse, je me mis à réciter intérieurement à toute vitesse le notre père et je vous salue Marie. J’attendais le coup de hache.
Au lieu de ça, il me demanda de sa grosse voix ce que je fabriquais par là, encore un mauvais coup pour sûr. Je répondis dans un réflexe, mon cerveau ne commandait plus à ma langue. Du coup, je ne sais plus ce que j’ai bien pu lui dire, mais il est resté trois secondes bouche bée, immobile, le torse moulé dans un marcel qui avait dû être blanc il y a bien longtemps, de la sciure restait collée à son immuable pantalon de toile bleu. Puis il partit d’un rire sonore, bien gras qui se transforma en toux ponctué de quelques jurons faits maison.
Toi qui es si malin, me dit-il, dis voir combien de piquets il me faudra pour entourer le pré des lavoirs.
C’était un petit carré très humide où il parquait ses vaches à l’automne, situé au fond du vallon. Je rétorquais qu’il fallait d’abord mesurer le périmètre, puis diviser par la distance qu’il comptait laisser entre les piquets. On venait juste de terminer ce genre de problème en classe de géométrie et j’avais eu la meilleure note.
Il tiqua sur le mot périmètre qui ne faisait pas partie de son vocabulaire et puis il lâcha en élevant la voix qu’il ne pigeait rien de tout mon charabia.
Viens me montrer, dit-il.
Je n’en menais pas large. Le fond du vallon était encore plus reculé que la lisière du bois, personne ne m’entendrait hurler. Il pouvait se débarrasser de mon corps encore plus facilement. C’en était fait de moi.
Ses bottes, dont on pensait qu’il les gardaient pour dormir, faisaient un bruit de succion, je m’enfonçais les pieds dans l’herbe imprégnée d’eau. Bientôt, lorsque les vaches viendraient piétiner l’endroit, ce ne serait plus qu’une étendue boueuse où leurs pattes s’enliseraient jusqu’au jarrets.
Nous fîmes le tour du pré, le père Mathieu exécutant d’immenses pas sensés mesurer un mètre de long et ça, je n’en étais pas sûr. Je parlais de mesurer plus scientifiquement quand il me répondit que les scientifiques, il les emm…
Bref, ce ne fut pas mieux lorsqu’en guise de réponse à ma seconde question, l’espace laissé entre deux piquets, il écarta ses longs bras. Avec toutes ces approximations, je sentais la catastrophe arriver. Rien ne serait juste et il y aurait deux ou trois piquets en trop ou, pire, il en manquerait et là, c’en était fini de mon éphémère état de grâce.
Finalement, par un je ne sais quel coup de chance, le pré fut entouré à distance régulière (le père Mathieu avait un truc plus précis que l’écartement de ses bras, il allongeait au sol un piquet en guise d’intervalle, peut-être s’était-il rendu compte qu’en tendant les bras il ne pouvait plus rien faire) et il ne manqua aucun piquet et pas un en rabiot.
Quelques semaines plus tard, me voyant passer au loin, car notre entrevue ne m’avait pas encore rassuré sur ses intentions d’ogre, il me héla. Je m’approchais, la peur au ventre et les jambes molles. Il fit glisser son béret et gratta ses quelques cheveux collés au crane tout en me disant comme s’il cherchait ses mots: tu as l’air de t’y connaitre en chiffres, toi.
Et c’est comme ça que depuis mes dix ans, chaque année, je lui remplissais sa propre déclaration de revenus. Je me contentais de reporter les chiffres au début, mais à quinze ans, je m’étais renseigné à la mairie, j’avais écrit à une commission européenne à Bruxelles et j’avais obtenu des allégements fiscaux pour le père Mathieu. Il n’en revenait pas, le vieux bonhomme: pour la première fois de sa vie, il ne payait plus d’impôts. De là naquit une sorte d’amitié bourrue et je découvrais que sous des dehors frustres se cachait un cœur d’or qui s’était desséché à force de vivre seul.
La soirée inaugurale avait été un succès et nous nous apprêtions à gagner nos places respectives, dûment allouées à chaque invité selon un plan qui m’échappait. Ainsi, je me retrouvais coincé entre la femme du notaire et Monsieur le Député à ma droite.
L’opéra, enfin parlons davantage d’une petite pièce lyrique à vocation essentiellement divertissante, à la limite de la plaisanterie, l’opéra, car il eut été inconvenant d’utiliser un autre mot, moins clinquant, lors de cette soirée où les superlatifs étaient légions, l’opéra enfin, commença. Une voix s’éleva sur la scène encore plongée dans le noir. Puis, la poursuite n’éclaira qu’un visage d’une pâleur morbide. Un frisson parcouru les rangées de spectateurs. Pour une pièce légère, cela commençait mal.
Je ne sais pas si c’est le fait d’avoir vu ce visage blafard au teint cireux et ce regard pénétrant, mais mon estomac se serra. Pensant à ma déconvenue sur le bord de la petite route, en pleine campagne, à l’abri des regards indiscrets, quelques gouttes de sueur perlèrent sur mon front. Mes mains étaient devenues moites et mon rythme cardiaque s’était considérablement accéléré. Non, pas maintenant.
Mais les contractions stomacales grandissaient. Je pensais à une femme enceinte perdant les eaux en pleine représentation à l’opéra de Paris. Cela était sans doute déjà arrivé. Allais-je inaugurer à ma manière cette salle flambant neuve, au milieu du gratin mondain de cette petite ville si fière?
Je battais en retraite, m’excusant auprès de Madame la Notaire et Monsieur le Député en invoquant je ne sais plus quelle explication. Je fis se lever une rangée entière car, dans mon trouble, j’étais parti du mauvais côté alors que j’aurais pu ne déranger que trois ou quatre personnes en partant à gauche. Au passage, j’écrasais les pieds de Monsieur le Préfet, écorchait les genoux de l’architecte, bousculait la représentante du gouvernement, venue spécialement épauler cette manifestation « qui allait dans le sens de la modernité sans renier un héritage culturel fondamental ».
Plié en deux et rasant les murs, j’essayais de contenir le flot intérieur comme un barrage de brindilles tente de maintenir les eaux tempétueuses du fleuve en furie. Malgré tous mes efforts, je dû laisse s’échapper quelques fuites dans les couloirs. Dieu merci, personne n’était là pour témoigner que j’étais l’auteur de ces « saletés » comme le précisa Madame le Maire le lendemain. Relayés dans un article circonstancié, ses propos évoquaient quelques jeunes désoeuvrés que le service de sécurité, par ailleurs brillant et professionnel, avait, on ne sait comment, laissé entrer dans ce temple de l’art et de la culture. Des sanctions seraient prises. Je me sentais mal à l’idée qu’un vigile put avoir été sanctionné, mis à pied, voire même été viré à cause de mes écarts. Je me taisais, il était trop tard de toute manière et une honte surhumaine m’écrasait pendant 48 heures.
Désormais, ces épisodes vomitifs se répétèrent sans arrêt.
Je supprimai toute la charcuterie de mon alimentation. Après deux jours d’accalmie, cela reprenait. Je consultai mon médecin. Bien entendu, il me certifia que j’étais dans une forme olympique. Il ne voyait pas la cause de ce désordre. Me prescrit deux comprimés et trois gélules à avaler matin, midi et soir. Je n’eus pas le loisir d’expérimenter bien longtemps le traitement. A peine un quart d’heure après avoir ingurgité les premiers médicaments de ma vie, ceux-ci prirent le chemin du retour, colorant la souillure d’un bleu-vert très artistique. J’envoyais toute la pharmacie à la poubelle. Mon estomac me laissa tranquille jusqu’au lendemain.
J’avais prévu un plan d’action.
Je me levais et, à la place du copieux petit déjeuner largement beurré et confituré, je me contentais d’une tasse de thé et de deux biscottes nature.
J’attendais. J’allais être en retard à l’agence. C’était pourtant le jour où je devais faire visiter un important bien dont la prime à la vente était conséquente, une vaste demeure dans le style manoir du XIX° avec parc, piscine et même un petit parcours de golf. Bref, la grosse artillerie.
Cela ne manqua pas. Une bouillie de biscotte trempée dans du thé resurgit à peine une heure après avoir prit le chemin de mon estomac.
J’arrivais au bureau en fin de matinée. Jean-Louis, davantage mon ami que mon patron, était un peu froissé par ma défection. Malgré tous ses efforts, il n’avait pas convaincu l’acheteur. Une belle affaire lui passait sous le nez. De ma faute. Il me le fit comprendre à demi mot.
Le lendemain, je réitérais l’expérience en supprimant les biscottes. Bingo! C’était comme si mon estomac faisait une grève de la faim. Il n’acceptait plus aucune nourriture. Cela faisait presque une semaine que j’avalais sans pouvoir digérer le moindre aliment. J’étais affaibli. Je n’avais plus la tête à mon travail qui s’en ressentait. Jean-Louis m’avertit gentiment de me reprendre. Je lui confiais mes ennuis gastriques. Il me recommanda de jeûner une journée entière. Le temps de laver l’estomac. Tu verras, le lendemain, ton estomac criera famine et acceptera tout ce que tu voudras lui donner.
Jean-Louis avait partiellement raison. Effectivement, mon estomac ne se contenta pas de crier famine mais tordit mon ventre dans d’atroces douleurs toute l’après midi et il me fut impossible de trouver le sommeil.
Tôt le lendemain matin, je me jetais sur un petit-déjeuner gargantuesque. Fatale erreur. Toute la viennoiserie prit le chemin inverse pas plus tard que le temps d’enfiler un costume et nouer une cravate.
Je faisais à nouveau faux bond à l’agence. Cette fois, Jean-Louis, oubliant notre soit disant amitié de dix ans, me sermonna. Il faut que tu te reprennes.
Facile à dire. J’essayais plusieurs trucs. Ne mangeait un jour que des légumes cuits à la vapeur. Ca allait mieux, mais mon estomac grondait toujours. Je tentais le poisson. A peine mieux.
Fais tes courses sur le marché, me conseilla une amie. Me voilà parti mon cabas au bout du bras à marchander une botte de carottes, négocier un kilo de pommes de terre, tâter des tomates, sentir un melon, vérifier les ouïes des truites et constater le beau rosé de cette entrecôte.
Je passais le reste de la matinée à concocter un délicieux repas que je n’osais partager avec personne, de peur d’effrayer mes plus proches connaissances par la réaction de mon estomac. J’avais tort.
Ce fut la rémission. Mes intestins fonctionnèrent pour la première fois depuis sept jours. Les nutriments passèrent dans mon sang, alimentèrent mes muscles qui retrouvèrent un peu de vigueur.
Je retournais au marché. Me préparais des petits plats toute la semaine. J’avais prit un congé, sur les conseils de Jean-Louis qui avait planifié sa semaine et n’avait conservé que les transactions les plus faciles.
Je passais donc une semaine idéale.
Manger sainement, voilà ce que mon estomac désirait. Soit.
Je repris mon travail en arrêtant de grignoter entre deux rendez-vous. Je ne mangeais plus que des produits bio. Je m’arrangeais pour me libérer une heure deux fois par semaine pour me procurer des produits frais et sains au marché matinal.
Un Dimanche, je m’étais fait un pot-au-feu de derrière les fagots. La cuisine embaumait des parfums de mon enfance. Il me semblait commencer une nouvelle vie. Je me sentais déjà mieux. Pourtant ce jour-là, une lourdeur plomba mon estomac toute l’après midi. Ca recommençait.
Je ne comprenais pas. Tous les ingrédients étaient parfaits. Qu’y avait-il? Le Lundi, trop pressé, je me rendis au Cheval Blanc, le restaurant gastronomique à la sortie de la ville. Là, je savais que je ne craignais rien. La carte était somptueuse tout comme l’était l’endroit. Jérôme, le patron, vint me saluer au dessert en m’offrant café et liqueur. Il y a trois ans, il avait racheté ce vieux moulin une bouchée de pain sur mes conseils. J’étais à l’origine de la transaction. Il me remerciait encore. Son établissement venait d’obtenir sa seconde étoile et, le weekend, on faisait sans peine cent kilomètres pour venir déguster ses escalopes de veau aux myrtilles, sa bouillabaisse des ruisseaux ou encore son coq en gelée.
J’y laissais un quart de mon salaire mais mon estomac me laissa tranquille jusqu’au Mercredi.
Je commençais à comprendre.
Les produits sains ne lui suffisaient plus. Monsieur avait décidé de ne plus accepter que la haute gastronomie. Mes talents culinaires ne suivaient pas.
Je me mis donc à un régime forcé, à base de saumon fumé, de caviar, des plus belles pièces de viande préparées, du moins je l’espérais, avec le plus grand soin et une méticulosité de dentellière.
Je n’y parvenais pas toujours, alors je me réfugiais au Cheval Blanc.
En quelques semaines, j’étais devenu un vrai cordon bleu. Je reprenais une vie sociale en invitant mes amis chez qui j’avais espacé mes visites. Mais, froissés de mes défections ou indignés de ce qu’ils prenaient pour de l’orgueil, une fierté d’aristocrate, ils n’acceptaient pas mes invitations.
A trente cinq ans, je n’étais pas marié. Ne l’avait jamais été. Pourtant mon carnet mondain était plein à craquer. Qui a décrété qu’on invitait que les couples? De toute manière, j’étais souvent accompagné lors de ces soirées intimes ou grandiloquentes. J’aurais pu savourer la table et le salon de mes diverses connaissances chaque soir si je ne me retenais pas.
De par mon métier, j’étais en relation constante avec le gratin des environs et, sans mentir, je peux avouer que ma présence était recherchée. Il est toujours bon pour un avocat, un médecin, un notaire, un député, d’avoir un agent immobilier dans ses relations. Un terrain à acquérir, un bien à vendre, la recherche d’une résidence secondaire, un appartement à céder, un immeuble à louer…
De surcroit, j’avais le contact facile, n’étais pas bêcheur, et sans être un boute-en-train de première, je régalais les convives par mon humour, toujours une histoire à raconter, de plus je valsais correctement.
Un repas auquel je participais était garanti d’un beau succès, la confirmation d’une soirée réussie.
J’arrivais le plus souvent seul et, aussitôt, une nuée d’invités m’entourait. On me souriait, les messieurs me donnaient d’affectueuses tapes dans le dos, les dames, plus réservées, me jaugeaient selon leurs propres échelle de valeur. Mon assurance était telle que je n’étais jamais pris en défaut, même au milieu d’un panier de crabes. Car, dans l’assistance féminine, je repérais bien souvent d’anciennes conquêtes.
Je me rappelais un diner où, les onze femmes qui partageaient une table sublime, étaient passées dans mon lit une nuit ou l’autre. N’importe qui d’autre à ma place aurait été désarçonné, dérouté, déconfit. Un autre homme aurait glissé sous la table ou, sous un prétexte ou un autre aurait quitté la soirée sur le champ. Moi, cela m’amusait. Croyaient-elles chacune être la seule à avoir partagé une nuit (ou deux) avec moi, véritable Casanova d’un soir? J’essayais de repérer dans leurs regards le début d’une réponse. Je n’y vit qu’une inclinaison à recommencer. J’avais laissé de tendres souvenirs dans des cœurs laissés à l’abandon pour la plupart. Tous les messieurs qui partageaient les soirées où j’avais le bonheur d’en être avaient des occupations très prenantes. Résultat : quatre ou cinq ans de mariage réduisaient leurs dames à aller voir ailleurs si l’herbe était plus verte. Fatiguées de n’être plus que « la femme de », elles aspiraient à redevenir une femme, tout simplement, et continuer de se voir belle et désirable dans le regard d’un homme, celui de leurs maris s’étant éteint définitivement sur leurs charmes.
En revanche, j’évitais de me montrer en compagnie féminine dans ces soirées. Je me souviens d’un repas au cours duquel aucune autre femme ne m’adressa la parole ou alors ce fut sur un ton glacial et un air chargé de reproches. Si certaines savaient pertinemment que je butinais ici et là, elles ne me pardonnaient pas de l’afficher en public. Elles se voulaient, en leur cœur, les uniques élues de ma volonté, de mon désir. Après une soirée d’un tel acabit, je ne me présentais plus que solitaire, sauf lorsque j’étais convié à partager un repas sans chichis chez des amis proches.
Ce fut d’abord chez eux que j’évitais de me rendre. Non que leur cuisine ne valut pas celle des belles tables bourgeoises des notables de la ville, mais mon estomac ne daignait plus accepter de simples victuailles. Monsieur ne se nourrissait plus que de caviar, huitres, foies gras arrosés du meilleur champagne. Les plats tout simples, même s’ils étaient préparés à la perfection ne lui convenaient plus. J’avais l’impression d’être devenu l’otage de mon estomac.
Si j’avais le malheur d’ingurgiter un aliment un tant soit peu commun, il était rejeté avec violence. Car mes crises, si elles s’espaçaient grâce au contrôle absolu que j’avais mis en place sur ce qui entrait dans ma bouche, n’en étaient que plus furieuses. Mon corps entier était secoué comme un prunier pendant la cueillette.
Non seulement, ma panse n’acceptait plus certains produits mais fallut-il qu’ils soient préparés de la meilleure manière, que les viandes soient cuites au degré et à la minute près, que les fruits aient atteint leur point de maturité optimal, ni trop vert, ni trop mûrs. Mais, plus que tout, je me méfiais des sauces. Elles devaient être consistantes sans être lourdes, idéalement relevées, ni trop fades ni trop épicées. Un vrai casse-tête.
Mon estomac était en train de m’écarter de toute vie sociale et vider mon compte en banque. Mes séjours dans les meilleurs restaurants de la région n’étaient pas gratuits. Je déclinais les invitations que mes amis commençaient par ailleurs à espacer. Je sacrifiais quelques matinées à la préparation de bons petits plats. Jean-Louis ne tarda pas à prendre un ton nettement moins amical quant à mes absences. L’agence avait perdu coup sur coup trois marchés immobiliers. C’en était trop. Ou je me ressaisissais ou il serait obligé de se passer de mes services. Tu me comprends, avait-il ajouté.
Oui, je comprenais. Je comprenais que je souffrais d’un mal incurable devant lequel la médecine était impuissante. J’avais tout essayé. Anneau gastrique, divers médicaments, massages abdominaux, acuponcture et j’avais même consulté un psy. Rien n’y faisait. J’étais devenu l’esclave de mon estomac. Je ne prenais même plus plaisir à ingurgiter ces mets délicieux, raffinés, subtils et délicats. Cela tournait à l’obsession.
Un Vendredi, je laissais tomber ma lettre de démission sur le bureau de Jean-Louis. Mes nombreuses étapes dans les grands restaurants et mes progrès en matière de cuisine m’avaient permis de trouver un emploi dans les cuisines du Relais de Saint Jacques. Mon estomac jubilait. Je préparais les meilleurs produits dans les règles de l’art. Ce fut un répit de courte durée. En effet, le chef de la brigade ne pouvait pas me voir. Reproches et remontrances s’enchainaient à la queue leu leu. Je n’en pouvais plus.
Je m’exilais. Ce n’était pas le travail qui manquait dans la restauration. Le rythme était digne du plus terrible des bagnes, ce qui interdisait toute vie de famille un tant soit peu équilibrée. Mais la vie de famille, je m’en moquais bien. J’étais seul, sans attaches.
Passèrent de longs mois d’un travail acharné, lever au petit jour, couché bien après minuit. Ma vie affective, très dense jusque là, souffrit au plus haut point. J’étais devenu un moine. Un moine en toque et tablier blanc.
Bientôt les fumets de cuisson, les odeurs de viande saignante et de poisson frais, les remugles de préparations diverses, les émanations de grillades, les arômes trop sucrés des desserts, les relents de sauces mijotant longuement dans des casseroles en cuivre, les miasmes d’alcools, les bouffées des rôtis mitonnant et les effluves de grands crus eurent raison de mon nez.
Dès lors, pendant mes heures de pause, en milieu de journée, je m’échappais sur les bords de la douce rivière dont les eaux stagnaient entre deux rangées de peupliers. Je respirais profondément. J’humais le printemps délicat, j’inspirais l’automne profond, j’inhalais les fortes senteurs de l’été et je reniflais en hiver l’absence d’odeur.
J’avais trouvé un équilibre dans ma nouvelle vie. Je m’y étais habitué et là, ça recommençait. J’étais à nouveau prisonnier de mes sens. Mon appendice nasal allait dicter mon comportement futur.
Et l’enfer recommença.