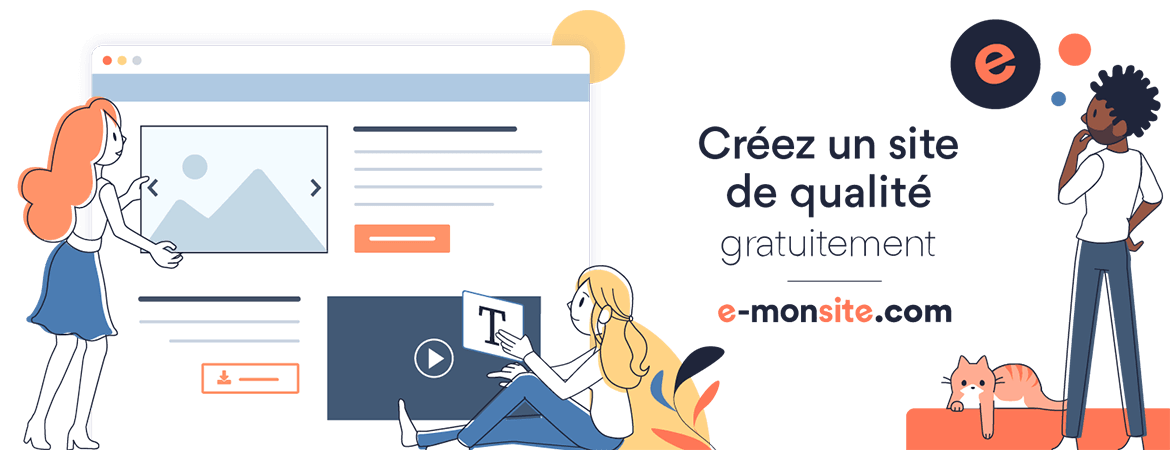le Monde d'après
Le paysage défilait par la large baie vitrée, mélangeant les couleurs dans un flou artistique, comme sur un tableau impressionniste. Au loin, les montagnes qui entouraient la vaste dépression autour de Salt Lake City étaient encore nimbées de neige. Le blanc immaculé tranchait sur le bleu d’un ciel sans nuages, donnant à l’ensemble un air irréel. Comme dans un rêve. Pourtant, pour une fois, Evandre avait devant ses yeux la pure réalité des choses, même si celle-ci était transformée par l’effet de déplacement du véhicule. Il pouvait profiter de toute cette beauté qui s’étalait au travers de la bulle de la petite automobile que chacun utilisait pour se déplacer sans penser à modifier un détail, à remanier un décor, à ajouter ou retirer un élément du cadre.
Entièrement électrique, le moteur ne faisait aucun bruit et depuis que le désormais célèbre ingénieur Delambert avait inventé un nouveau matériau, résolument écologique puisque à base de fibres naturelles et dont on avait recouvert toutes les voies de communication, le frottement des pneumatiques sur ce nouveau genre d’asphalte ne produisait pas le moindre son. Sa texture empruntait les propriétés héritées des mousses de Sibérie, absorbant les sons et rendant les déplacements plus sûrs, même à grande vitesse.
Il possédait en outre la remarquable spécificité de réagir en fonction de la masse qui venait le percuter. Plus celle-ci était importante, plus le revêtement se rigidifiait jusqu’à devenir dur comme de l’acier. Le théorème d’Archimède appliqué au solide.
Ainsi lorsqu’on marchait dessus, cela donnait l’impression d’un amorti, tout en douceur. D’ailleurs, les kinésithérapeutes se félicitaient de cette trouvaille : leurs patients férus de footing ne présentaient plus ces pathologies sournoises résultant de micro chocs sur la plante des pieds qui venaient traumatiser les vertèbres en les tassant, comme si on utilisait un marteau-piqueur.
La gomme, puisque cette pâte apparentée au caoutchouc était préparée à base d’ingrédients naturels, un savant dosage de mousses et plantes cultivées en Indonésie et en Amazonie (elles demandaient en effet une très forte humidité pour proliférer et obtenir les propriétés demandées) avait remplacé depuis une vingtaine d’années le détestable goudron issu des fossiles non renouvelables. Il avait également l’avantage de moins se dégrader et résister aux intempéries qui, heureusement, avaient l’air de se calmer un peu ces dernières années.
La petite électrobile traversa de vastes étendues où se mêlaient des milliers de plantes et d’arbres différents. Cela évoquait un paysage vierge où l’homme n’aurait jamais mis les pieds. Parfois, au détour d’un virage, on pouvait croiser biches, cerfs, une horde de sangliers ou de bisons – ceux-ci préféraient les landes désolées qui s’étendaient sur les hauts plateaux, au-delà de mille mètres d’altitude. Une flore et une faune originelle, préservée comme au premier jour du monde.
Tout cela, Evandre le savait parfaitement, n’était que pure illusion.
Après le sixième plan pour la préservation de la Terre (le fameux P.P.T), on avait enfin pu mettre en place cet ambitieux projet de repeupler la surface de la Terre d’une biodiversité qui n’avait rien de naturel, du moins au départ.
On avait alors jardiné de vastes régions souillées où quelques plantes invasives régnaient en maitres absolus sur les sols trop pollués pour donner une chance à toutes les espèces.
On avait réimplanté avec succès nombre d’espèces endémiques donnant l’impression d’un retour chez soi. Les ingénieurs agronomes avaient fait des merveilles par le biais de la coopération entre espèces. La permaculture à grande échelle.
En dernier lieu, on avait réintroduit des espèces animales en prenant bien soin de parvenir à reconstituer un équilibre proie-prédateur afin que d’ici une ou deux décennies le cycle parvienne à se suffire à lui-même. Pour l’instant, et même si cela ne se voyait pas, tout était régit par l’homme. Le moindre centimètre carré était surveillé, entretenu, comme un jardinier peaufine avec la plus grande attention ses plantations.
Evandre ne se lassait jamais de ces paysages sauvages qui, toutefois, ne l’étaient pas encore totalement redevenus. Ils en avaient l’air seulement, et tous les spécialistes espéraient qu’ils retourneraient un jour à une autonomie naturelle, le cycle de la vie réinstauré, une biodiversité se régulant d’elle-même. On n’en était toutefois pas encore au début du commencement.
Il y eu un petit soubresaut : la mini électobile s’engagea sur un pont qui traversait une large rivière. Il se souvint des travaux pharaoniques pour réhabiliter le cours d’eau, comme tant d’autres un peu partout sur la planète. Un chantier pharaonique. Celui-ci avait été asséché, comme tous ses affluents par la démesure de la cité du désert, Las Vegas, « the city that never sleep », selon l’expression consacrée. Pour ses nuits blanches, elle assoiffait toute la région en amont et ne laissait qu’une terre aride en aval.
Dorénavant, on dormait toutes les nuits à Las Vegas. Et on pouvait même admirer le ciel étoilé puisque partout dans le pays, et dans le monde, une loi interdisait la moindre pollution lumineuse deux heures après le coucher du soleil et ceci jusqu’à l’aube. N’étaient autorisés que les éclairages domestiques à l’intérieur des habitations.
La petite électrobile se faufilait savamment entre les autres véhicules. Totalement silencieuse, elle était surtout parfaitement autonome.
Ce fut la grande réussite du second plan de préservation (toujours le fameux PPT) : remplacer tout le circuit de transports par des véhicules propres, silencieux et renouvelables à cent pour cent.
Cela avait demandé pas moins d’une génération. Vingt cinq ans et l’équivalent du tiers du PIB mondial. Mais le résultat dépassait l’entendement. Un milliard de voitures au rebut : on avait recyclé le plus que l’on pouvait. Tout le parc automobile remplacé avantageusement et écologiquement par ces petites unités individuelles qu’on surnommait des Bulles car elles en avaient l’apparence.
Munies de batteries à condensation transversale d’énergie, moins lourdes et moins polluantes que les trop volumineuses barres de stockage, elles avaient une autonomie de cinq à six heures. Ce qui était largement suffisant ces premières années, étant donné les sévères restrictions liées à la pandémie. De toute façon, on n’utilisait les Bulles que pour effectuer de petits trajets.
Dorénavant, on pouvait quasiment traverser tout le pays d’une traite, en empruntant les highways qui sillonnaient le continent, tout comme en Europe. Là, les Bulles étaient remplacées par des Tillys, sorte de tramways d’un nouveau genre. Leur pile électrique était couplée avec des panneaux solaires et utilisaient le désormais fameux procédé Tilly, du nom de son inventeur, il y a quelque cinquante ans. Un système d’aimant permettant de conserver une grande vitesse une fois celle-ci atteinte. Cela n’était donc valable que pour les longs trajets, de plusieurs centaines de kilomètres.
Les Tillys fonctionnaient sur le modèle des antiques remontées mécaniques des stations de sports d’hiver. Des rampes d’accès permettaient aux Bulles d’atteindre la vitesse de pointe du système et s’y insérer en toute sécurité. A l’inverse, à chaque étape, chaque gare en quelque sorte, on pouvait décrocher et reprendre une vitesse adaptée.
Les highways, à la différence des shortways, ces petites routes qui épousaient la topographie, ressemblaient à des lignes de chemin de fer, rectilignes et bardées de capteurs, tout comme les shortways, mais à cette différence près que là, d’autres capteurs faisaient circuler un champ magnétique qui permettait d’éviter le frottement au sol. En un mot, on glissait comme dans un antique aérotrain, à la vitesse d’un avion, en totale sécurité.
Les Bulles venaient s’insérer dans le vaste maillage de shortways que tout pays avancé avait mis en place, remplaçant les anciennes voies de communications, jusqu’aux chemins forestiers. Un système de répulsion interdisait la moindre collision et un ordinateur de bord communiquait sans cesse avec tous ceux qui l’entouraient. Un peu comme une foule qui déambule dans une ville, sur une place, le long des rues. Aucune percussion n’était possible et tout était géré par la machine elle-même. On n’avait plus qu’à s’asseoir et, au choix : dormir, travailler, penser ou simplement admirer le paysage.
Ainsi, le nombre de victimes d’accidents de la circulation avait été réduit à néant. En dix ans, on n’avait eu à ne déplorer qu’une poignée de sinistres dus à des conditions extérieures : arbres soudainement déracinés par une forte bourrasque imprévue, blocs de rochers dévalant les pentes des zones montagneuses. Faits extrêmement rares car d’autres capteurs étaient positionnés un peu partout et alertaient les mouvements de terrain, les points de rupture des arbres. On avait également mis au point un système de veille à ultrasons pour avertir et éloigner les animaux qui pouvaient déambuler dans n’importe quelle zone, hors cité. Des caméras thermiques permettaient également aux Bulles de ralentir et stopper à l’approche de n’importe quelle forme vivante. Les conditions météorologique étaient, quant à elles, disséquées, analysées et les engins de transport, des Tillys ou petites Bulles s’adaptaient à toutes les conditions, ralentissant et allant même jusqu’à stopper en cas de danger imminent.
Voyager était devenu reposant et sans danger.
Depuis l’instauration du plan visant à reverdir les campagnes, on avait constaté une nette augmentation du nombre des espèces animales. C’était un cercle vertueux et il n’était pas rare de pouvoir contempler une faune qui avait retrouvé des espaces libérés de toute présence humaine.
Du reste, il était devenu très rare de se déplacer. Très peu de motifs motivaient un déplacement physique.
La réalité virtuelle régnait en maitresse sur ce monde nouveau.
Le premier signe d’un changement durable eut lieu au début de l’année 2020. Certains s’en souviennent encore, tous savent que cela inaugura une nouvelle donne pour le monde entier.
Le premier virus avait déjà pas mal chamboulé les états et les économies. Mais ce n’était qu’un début, une prémisse. A peine les économies s’étaient relevées de ce premier coup porté qu’un second virus, plus pernicieux, plus dangereux et nettement plus contagieux, avait porté l’estocade.
Ce nouveau variant avait la capacité de se combiner avec les molécules d’oxygène, le rendant extrêmement contagieux. La moindre aspiration vous mettait directement en contact avec la première souche, déjà assez inquiétante.
En quelques semaines à peine, il s’était développé dans les pays riches à une vitesse supersonique. Les pouvoirs publics n’avaient eu que le temps de bloquer totalement leur économie pour éviter la catastrophe annoncée. Hôpitaux saturés, victimes par millions et surtout, la persistance du virus qui avait trouvé la parade aux vaccins : il se dupliquait en se modifiant constamment. En moins d’un an, on avait noté une quarantaine de variantes de la souche mère. C’était imparable. Il fallait tout changer. Et vite.
Ce fut un branle-bas de combat incroyable. Partout dans le monde, spécialement dans les pays développés, l’économie était sclérosée, mise à genoux. On était au bord du gouffre.
Une à une, les banques s’effondrèrent. Cette fois-ci les états étaient impuissants à leur venir en aide, les caisses étant vides, mais surtout la trop faible activité économique ne suffisait plus à engendrer de la richesse nouvelle. Les gouvernements de certains petits pays démissionnèrent, laissant la population livrée à elle-même. On aurait pu s’attendre aux germes d’une guerre civile, et ce fut le cas dans quelques régions, mais la population de la majorité des nations fit face en créant de nouvelles solidarités. Des comités autonomes remplacèrent les états défaillants. Les plus forts venaient en aide aux plus faibles. On s’organisait en changeant radicalement d’activité. Puisque la grande partie de l’économie était au point mort, on revenait à l’essentiel. On se mit à cultiver la terre, à échanger, à soutenir une nouvelle économie, plus simple, plus saine, où l’argent était proscrit, du moins était-il réduit à sa plus simple fonction de monnaie d’échange. Il y eut de belles innovations, de jolis projets menés à terme pendant ces années un peu partout dans le monde.
Mais une catastrophe n’arrive jamais seule.
Tandis que le virus et ses dérivants anéantissaient les efforts démesurés mis en place pour changer globalement une société gangrénée par le profit immédiat, le climat se révolta contre l’emprise humaine sur la planète. En moins de cinq ans, l’hémisphère nord connut pour la première fois de son existence de vrais cataclysmes d’une ampleur démesurée : tempêtes à répétition, incendies gigantesques aux portes des villes, sécheresse anéantissant les bonnes volontés en matière d’agrobiologie, inondations monstrueuses ravageant tout sur leur passage. Les sociétés riches vacillaient sur leurs bases et on ne comptait plus les morts ni les sans abri. Ce fut comme la fin du monde.
Et, d’un sens, c’était bien la fin d’un monde. Celui de l’opulence, du confort, du toujours plus. Pour la première fois dans l’histoire récente de l’humanité, on ne put se reposer sur les avancées de la science. La technologie était incapable de résoudre le problème. L’homme, seul, devait répondre à ce défi.
Alors, comme après toute tragédie, l’humanité se releva. Sur de nouvelles fondations.
Règle numéro un : éviter absolument tout contact humain. Lorsqu’il était indispensable de se rencontrer, on s’équipait comme pour une sortie dans l’espace. Très vite, on apprit à vivre seul et ne communiquer que par écrans interposés. Une chance que la téléphonie mobile soit déjà bien implantée.
Chacun travaillait dans son coin. Dans les ensembles imposants, on continuait à produire, rigoureusement séparés les uns des autres ou, lorsque c’était obligatoire, en ressemblant à des cosmonautes débarquant sur Mars.
L’économie s’adapta. La formidable pandémie, alliée au dérèglement climatique, imposa les petites structures, notamment dans l’agriculture. Finies les fermes démesurées, d’autant que l’on s’était aperçu que les concentrations d’élevage propulsaient le virus mieux qu’une fronde. Les habitudes alimentaires changèrent : il n’était plus question de produire de la viande à une telle échelle. Les transports posant d’insondables problèmes, les circuits courts furent à nouveau la norme.
En moins de quinze ans, on atteignit les objectifs idéalistes des plus fervents partisans d’une écologie dure.
La population mondiale avait chuté de moitié, du moins d’après les suppositions : il était impossible d’effectuer le moindre comptage – le seul possible était celui des téléphones mobiles, or tout le monde ne possédait pas le fabuleux sésame, surtout dans les pays pauvres.
L’économie se recentra sur le local, y compris les médias : journaux, radios, télévisions ne parlaient que du proche – ils furent, dans un premier temps, les seuls vecteurs des précieux conseils prodigués par les spécialistes scientifiques et politiques. Des réglementations qui évoluaient quasiment chaque semaine. Ils étaient redevenus ce pour quoi ils avaient été créés : informer la population. Plus besoin de sensationnalisme : l’incroyable se produisait chaque jour devant les yeux éberlués des citoyens. On évoluait sur un fil de funambule et il s’agissait de garder l’équilibre.
Ce furent des années dures, pénibles, éprouvantes à plus d’un titre. Mais ce fut salvateur, d’une certaine manière. Ne prétend-t-on pas que ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort ?
Une nouvelle organisation vit le jour, qui persiste encore aujourd’hui du reste, cinquante ans après ces années d’horreur. On a finalement retrouvé un nouvel équilibre, sans pour autant parvenir à éradiquer le virus qui s’est même renforcé dans sa vigueur et sa contagion. La société s’est accoutumée à ses restrictions.
Plus écologique, par la force des choses, mais pas davantage individualiste, comme les plus pessimistes intellectuels l’envisageaient un temps. On a appris à vivre ensemble d’une façon différente.
Le virtuel, déjà bien implanté dans la société mourante, a prit une ampleur considérable. Les déplacements sont devenus obsolètes depuis que les images ont remplacé le tourisme. On voyage par écrans interposés. Le marché des drones a connu une explosion immédiate. C’était la seule solution pour ravitailler, communiquer, constater, examiner, échanger.
Chaque entité citoyenne, qui remplace désormais le concept de ville, de village ou de quartier, doit être autonome à cent pour cent en énergie (solaire, éolienne, hydraulique pour la plupart) et doit quasiment s’auto-suffire en nourriture et besoins essentiels.
Et l’amour, dans tout ça ?
Il a et aura toujours le dernier mot.
Vivre séparément a paradoxalement intensifié les relations virtuelles. On se parle, on se confie davantage par écrans interposés. Les non-dits et les silences lourds de reproches qui sont la gangrène du couple ont disparu, laissant place à plus d’honnêteté, de franchise, de sincérité. En étant séparé physiquement, les couples se rapprochent spirituellement.
Le développement des hologrammes domestiques a même permis de se caresser, de faire l’amour virtuellement. Evidemment, aucune loi n’interdisait les rapports intimes mais on avait constaté une baisse drastique des relations extraconjugales. Les ligues de vertu refleurissaient, alliant leur profession de foi et la nouvelle donne imposée par le virus. Du pain béni pour les puritains.
Les femmes continuent d’enfanter. Insémination artificielle et accouchement en chambre stérile par un personnel réduit, vêtu comme s’il évoluait dans l’espace ou sur une planète sans oxygène.
Toutefois, ces nouvelles règles, si contraignantes dans le privé, l’intime, avaient mis un frein aux naissances. Cet imposant parcours du combattant dissuadait les moins motivés à devenir parents. Cela accrut la baisse de la natalité partout dans le monde, spécialement dans les pays riches en technologies.
Envie de découvrir la suite, contactez-moi...