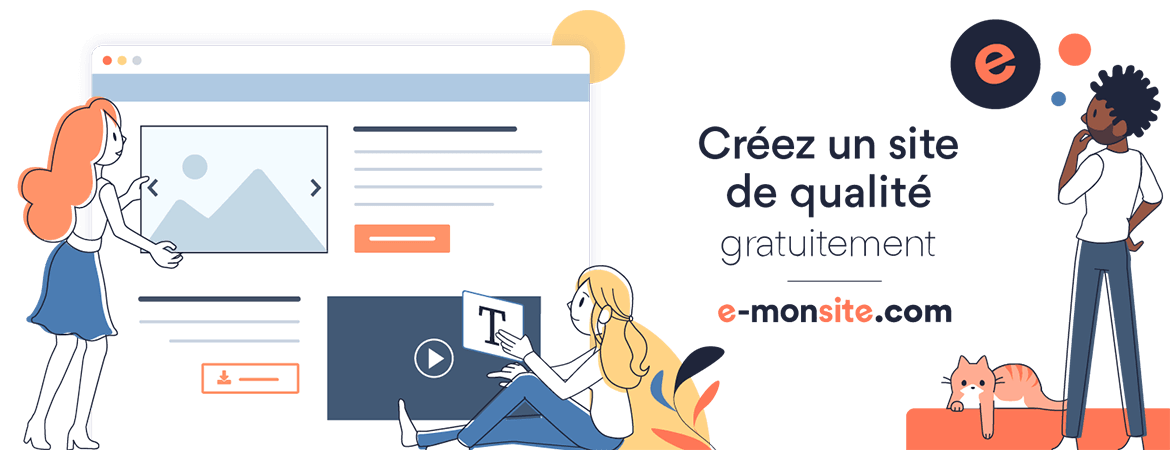Quand la basse cour s'évade
Quand la basse-cour s’évade
***
1. Albertine.
C’est Gertrude qui a eu l’idée en premier.
Il faut lui reconnaitre cette qualité. Sans elle, nous serions comme bon nombre de nos collègues. Une demi douzaine de poules flanquées d’un coq dans une quelconque basse cour attendant patiemment que le soleil se couche pour s’endormir.
Nous vivons en bonne communauté dans trente mètres carrés parfaitement agencés. Il y a ici tout pour rendre le plus exigeant des gallinacés heureux. Le sol de terre battue est agréable à nos petites pattes, quelques parterres d’herbe mêlés de tendres buissons où prolifèrent les meilleurs vers de terre du monde pour égayer nos repas. Nos mangeoires sont situées contre un mur de briques qui garde bien la chaleur du soleil. Nous avons même un perchoir que nous n’utilisons que rarement. D’une part il requiert quelques talents d’équilibriste que, ma foi, je le reconnais volontiers, aucune de nous ne possède pleinement. D’autre part, cet artifice est régulièrement occupé par Barnabé.
Dans l’ensemble on s’entend bien entre filles. Seulement, il y a Barnabé.
Prenez la meilleure société du monde, à savoir une bande de quelques poules bien en chair et douées d’un esprit progressiste et jouissant de tout le confort moderne. Ajoutez-y un coq prétentieux (quel pléonasme!) et, en moins de cinq minutes, vous créez la plus formidable des discordes.
Cet individu n’a davantage de vanité et d’orgueil que sa propre bêtise. Barnabé se croit être le chef de notre communauté. Quelle prétention! Quelle arrogance! Quelle ignorance!
S’il existe un patron ici bas, c’est sans nulle doute monsieur Ripouldingue. Ernest Ripouldingue. L’homme remplit nos mangeoires chaque soir vers dix-huit heures. Ernest Ripouldingue n’est pas, à vraiment parler, un paysan ni même un de ces agriculteurs modernes, amplement mécaniquement assistés, qui inondent le sol d’herbicides et pulvérisent l’air de pesticides dans le but bien précis d’obtenir des fruits et légumes parfaits et sans sacrifier à un dur labeur. Ce point demande d’être éclairci quelque peu.
Primo, il n’est pas certain que toutes les heures passées à travailler pour se payer de tels engins censés rendre le labeur plus aisé soient moins éprouvantes que d’utiliser des moyens plus simples mais tout aussi efficaces. Bref, ceux-ci, en croyant travailler plus facilement, travaillent davantage.
Secundo, c’est mal connaitre le principe élémentaire des chaines alimentaires. En éradiquant tous les insectes nuisibles, on pratique un génocide unilatéral. Je ne reviendrai pas sur le cas moral d’une telle entreprise, puisque cet holocauste programmé n’a pas l’air de les empêcher de dormir, mais j’aimerais attirer l’attention sur le fait que, dans le lot des insectes amateurs de beaux et bons produits, il se trouve bon nombre d’espèces parfaitement inoffensives. On appelle ça les dommages collatéraux. Tu parles, Charles! Sans compter que, ces insectes montrés du doigt servent de menu à bon nombre de gastronomes dont nous faisons partie entre autres.
Tercio, je ne suis pas sûre que des fruits traités chimiquement aient conservé leur meilleur goût. Souvent, je passe de longues heures à les observer se balancer aux extrémités des branches des immenses plantations qui tapissent les pentes des collines toutes proches. Oui, je sais, j‘ai une vue excellente, merci. Ils me font penser à ces défilés de modes où des créatures filiformes et sans âme arpentent mécaniquement des podiums sans émettre le moindre sourire. On ferait la gueule à moins. Devoir se pavaner dans des tenues que même Maryline n’oserait pas porter, n’ayant que la peau sur les os et tout le poids de la terre sur les épaules. Ca, elles sont belles, les tops modèles. Belles mais sans consistance aucune. Exactement comme tous ces fruits rebondis, sans aucun point noir, calibrés à la perfection. Interchangeables. Sans personnalité. Et surement sans le moindre goût. Après tout, si ça leur convient aux bipèdes de se nourrir de cochonneries, pour s’empiffrer de résidus de produits chimiques qui déclenchent, avec le temps, des pathologies dont ils sont les premiers surpris.
Nous, on préfère largement les laiderons qui viennent à maturité sur les branches du petit verger qui jouxte notre enclos. Parfois, une pêche juteuse ou une poire parfumée tombe de notre côté. Quel délice!
Bref, tout ça pour dire qu’Ernest Ripouldingue est bien le patron puisqu’il vient remplir nos mangeoires et qu’il détient la clé du portail qui ferme notre périmètre. Le patron? Finalement, pas si sûr. Il n’y a qu’à entendre les récriminations de sa femme lorsqu’il rentre tard, c’est-à-dire un petit quart d’heure après l’heure prévue ou qu’il a oublié un quelconque paquet de lessive sur la liste des courses qu’il devait effectuer en rentrant du boulot (ces jours-là, il lui est accordé un délais d’une demie heure supplémentaire).
Rolande Ripouldingue est sans conteste la patronne du patron. Mais est-elle à son tour toute puissante? Pas sûr. Il faudrait enquêter plus profondément avant de se prononcer. Il me semble qu’elle aussi, la patronne du patron, parait obéir à une instance supérieure. Je la remarque parfois, hypnotisée devant une lucarne un peu particulière qu’elle a installé dans son living. C’est une fenêtre étrange. Elle ne donne sur aucun paysage pourtant on peut y voir défiler le monde entier. Elle n’est pas plus grande qu’un clapier à lapins mais une foule s’y tient dedans, gesticulant sans arrêt, ânonnant des phrases sans queue ni tête, riant aux éclats pour n’importe quelle bêtise que même Barnabé n’oserait pas proférer. Et qui sait si cette boite aux images n’est-elle soumise son tour à de plus hautes instances encore, elles-mêmes commandées par un personnage tout puissant. Le Président du Monde? Dieu? Et qui oserait prétendre que celui-ci, tout omnipotent qu’il soit, ne se plie pas à un maitre supérieur?
Bref, il ne faut jamais se fier aux apparences. C’est bien ce que je me tue à répéter à longueur de journée à Maryline qui ne jure que sur l’aspect des choses. A commencer par le sien en premier. Parfois je suis subjuguée par la quantité d’énergie qu’elle met pour se donner belle allure. Il faut reconnaitre que le jeu en vaut la chandelle. Elle est rayonnante, notre Maryline. Mais que de temps gâché, de dynamisme dissipé, de vigueur dilapidée! Il faut la voir passer des heures à se lisser les plumes, à se manucurer les ergots, à bichonner ses pattes. De surcroit, elle est la seule à faire attention à sa ligne, Maryline. Elle ne picore pas n’importe quoi, n’importe quand. Pas comme Alfonsine qui engloutirait un sac entier de graines survitaminées au petit déjeuner. Alfonsine ne contredit jamais personne. C’est une bonne pâte, la petite. Seulement il y a des moments où on ne peut raisonnablement pas se comporter comme un mouton. Je les vois passer parfois, le troupeau de laineux, dans le pré qui leur est dévolu. Force est de reconnaitre qu’eux aussi aiment l’ordre : leur pelouse est parfaitement tondue de frais, tout comme notre enclos est bien net, ressemblant à de la terre battue. Mais un peu de personnalité, que diable! Pour être dociles, ils le sont, les pauvres bougres! Il suffit qu’une de ces têtes vides décide quelque chose pour que toute la tribu suive tête baissé sans réfléchir aux conséquences. Cela a le don de m’horripiler. Et de mettre Gertrude dans tous ses états. Il faut dire que Gertrude est un peu notre guide. C’est toujours elle qui prend les décisions. Qui nous fait aller de l’avant, progresser en quelque sorte. Cela a pour conséquence de nous faire prendre quelques risques parfois au grand dam de Léontine, la pusillanimité même. Jamais vu une couarde pareille. Les moutons ne sont pas bien hardis, mais n’hésitent pas à suivre le mouvement une fois en action. Léontine trouvera toujours une bonne excuse pour éviter tout danger. Un nouvel aliment découvert par Alfonsine n’aura jamais ses faveurs, même si celui-ci est délectable. Je pense notamment à ces petites fourmis rouges qui, on ne saura jamais ni pourquoi ni comment, avaient envahi le potager d’à côté et qu’une colonie avait exploré notre enclos. Funeste curiosité, spécialement lorsque ces croisés du nouveau monde eurent le malheur (pour elles) de passer entre les deux pattes d’Alfonsine qui trouvait le repas de midi un peu maigre et peu relevé. Ni une ni deux, elle picora à petits coups de becs précis ces étranges insectes au goût acidulé avec une pointe de miel au niveau de l’abdomen. On se régala pendant trois jours. Albertine n’y toucha même pas, prétendant que nous allions toutes attraper des maladies fatales. Nous allions devenir folles, nous mettre à chanter à la place de Barnabé, perdre toutes nos plumes, devenir aveugles et elle alla jusqu’à affirmer que les dents allaient nous pousser, ridiculisant la gente gallinacée pour des générations et des générations à venir. Rien de tout cela ne se produit vous le pensez bien.
Je parle, je parle et je me rends compte que je ne vous ai pas encore présenté Amandine. Il faut reconnaitre qu’elle est discrète Amandine. Elle passe ses journées à observer le monde qui l’entoure. Un peu comme moi. Sauf qu’elle ne le voit pas, mais alors absolument pas du tout comme moi. A croire que nos nerfs optiques ne sont pas fait de la même matière. Ou bien cela à voir avec notre lobe occipital. Allez savoir! Amandine passe ses journées à peindre ce qu’elle voit. Et je vous certifie que ça vaut le détour. Je ne comprends pas toujours tout. Alfonsine, sa plus grande fan, affirme que je suis trop rationnelle pour comprendre son côté artistique largement développé. Ca, je reconnais qu’il est bien largement développé son fameux penchant artistique. Pas plus tard qu’avant-hier, elle nous a pondu (excusez l’expression) une œuvre magistrale. Sur un bout de tuile ébréché, elle a réussi à peindre ce qu’elle nomme elle-même « le carrefour des innocents ». En guise de carrefour, deux chemins tortueux à souhait qui s’entrecroisent au milieu d’un tronc d’arbre dont le feuillage est composé de crevettes roses et de crabes mauves. Les innocents en question, si j’ai bien compris les explications nébuleuses d’Alfonsine, étaient une horde de bonhommes en papier qui avaient l’air perdu sous un ciel vert bien entendu. Amandine ne perçoit pas les couleurs de la même façon qu’un esprit bien trempé, tel que le mien par exemple. Pour elle, les cieux peuvent se colorer de toutes les couleurs de l’arc-en-ciel mais certainement pas de tons bleutés. Trop simple. L’herbe ne sera jamais verte dans les compositions de notre artiste. Quant aux portraits, n’en parlons pas. Pablo Picasso est terriblement plus expressif qu’elle.
Mais le talent d’Amandine ne s’arrête pas à barbouiller son monde. Elle le déclame aussi dans d’improbables vers. J’avoue qu’en matière de vers, je préfère et de loin, ceux qui pointent le bout de leur museau de la terre bien grasse au fond du poulailler.
Donc, je disais que c’est bien Gertrude, notre meneuse, qui avait eu l’idée en premier.
Ca s’est passé avant-hier.
Juste après le déjeuner alors que le soleil venait de percer un amoncellement de nuages où Amandine distinguait parfaitement un éléphant chargeant un rhinocéros alors qu’il s’agissait tout simplement des volutes gonflées d’un cumulus tirant sur un cumulus congestus qui n’évoque pour ma part pas autre chose qu’un chou fleur et qu’Alfonsine terminait la portion de maïs laissée dédaigneusement par Maryline, prétextant qu’elle doit garder la ligne, qu’elle a déjà pris trop de poids sur les hanches et que ça commence à se voir. Pour ma part, je la trouve bien fluette sous ses plumes maintes et maintes fois peignées. Bref. Barnabé, après avoir tenté de coincer Maryline dans quelque recoin et n’ayant, une fois de plus, pas pu parvenir à ses fins, ronchonnait dans son coin. Nous vaquions à nos occupations habituelles lorsque Léontine émit son caquètement caractéristique, annonçant un danger imminent. Depuis le temps, plus personne n’y prête attention mais cette fois-ci, elle avait gardé le bec en l’air et frissonnait de toutes parts. Alors nous les vîmes.
Un immense vol traçait un V parfait dans le ciel soudain débarrassé d’éléphants, rhinocéros et cumulonimbus. Des grues cendrées. Un bel animal qui a toute mon admiration de par sa prestance tout d’abord, un port de tête digne d’un lord anglais puis par ses prouesses migratoires. Imaginez que ces oiseaux sont capables de traverser des pays entiers, survoler tout un continent, franchir des mers et des océans. Ca force le respect. Maryline vantait leur ligne élancée, Léontine les craignait à son habitude d’effroi devant tout ce qui sort de l’ordinaire, Gertrude célébrait leur soif de liberté, Alfonsine était d’accord avec tout le monde pour ne pas changer et Amandine fredonnait déjà les premières mesures du « chasseur » d’un chanteur aujourd’hui disparu.
Elles criaient régulièrement afin de conserver cette belle harmonie dans le vol, jouant avec les courants et les turbulences. J’avais déjà noté que les suivantes bénéficiaient du sillage du volatile précédent et, de ce fait, battaient des ailes une fois sur deux afin de s’économiser. A intervalles constants, l’oiseau de tête se laissait glisser vers la fin du cortège et un autre, reposé, reprenait la direction d’un battement plus vigoureux. C’était mécanique. C’était admirable. C’était beau.
Alors, Gertrude se retourna vers nous toutes qui continuions à regarder ce triangle ouvert qui fendait le ciel dans une harmonie et une synchronie exemplaire et proclama d’un ton péremptoire :
- Les filles, je crois que ces grues viennent de nous donner une leçon. Nous en avons toutes assez des avances de Barnabé, de la nourriture uniforme qu’on nous sert à longueur d’année, de rester cantonnées dans dix mètres carrés tristes et mornes.
Elle stoppa sa diatribe pour juger de l’effet sur son public. Nous avons toutes l’habitude des prises de position pour le moins radicales de Gertrude. Parfois, elle va trop loin mais elle sait trouver les mots justes qui déclenchent en nous ce frisson si particulier : la fibre révolutionnaire. C’est une meneuse de poules, il n’y a pas à dire.
Maryline hochait sensiblement la tête. Alfonsine se rangeait déjà aux côtés de notre guide à toutes. Amandine inspectait le jabot gonflé de Gertrude. Nul doute que dans sa tête elle crayonnait déjà un portrait à sa gloire. Léontine tremblait comme à son habitude. Barnabé arpentait l’enclos, cherchant quelque perchoir pour relever le bec et se gonfler d’orgueil. Pour ma part, je pesais le pour et le contre des assertions de notre leader.
Certes, Barnabé était un peu porté sur la chose et n’avait rien à envier aux exigences d’un parlementaire grand ponte de l’économie mondiale. Notre pitance quotidienne variait peu et si nous n’avions pas nos friandises invertébrées à dénicher dans le terreau nous nous ennuierions ferme. Enfin il fallait reconnaitre que l’attrait des grands espaces ne pouvait que séduire un esprit scientifique comme le mien. Je me sentais déjà dans la peau d’une aventurière, découvrant le monde, ses beautés et ses richesses.
Rassurée par notre contemplation muette (qui ne dit mot consent), Gertrude claironna fièrement :
- Je vous propose de nous évader.
Chacune réagit d’une façon différente, à sa manière. Maryline lissait déjà ses ailes, pensant naïvement qu’elle n’aurait qu’un battement à effectuer pour rejoindre dans un vol majestueux le groupe d’oies qui sillonnaient le ciel, déjà parvenues presque à l’horizon. Amandine formula intérieurement quelques vers sur les joies d’une évasion réussie, la griserie des grands espaces, la liberté retrouvée. Alfonsine était d’accord pour tout, si au bout de l’aventure se trouvait un vrai festin. Léontine imaginait déjà périls et dangers en pagaille, notre fin si proche dans d’atroces tourments. Pour ma part, je commençais à réfléchir à des solutions pratiques de fugue. Comment s’échapper de cet enclos imaginé pour nous tenir prisonnières. Barnabé s’approcha. Il n’aimait pas trop lorsque nous nous réunissions toutes ensemble. Cela lui semblait présager un mauvais coup qui se préparait et dont il serait la cible. Il devait asseoir son autorité de mâle dominant et surtout ne pas laisser se développer une sédition dont il serait la première victime.
Si Gertrude avait émit cette hypothèse un peu folle en sa qualité de déclencheur d’événements à venir, toutes se tournaient dorénavant vers moi. Il est bien connu que ceux qui prennent les décisions mettant en jeu l’avenir et l’unité d’un groupe sont parfaitement incapables d’assumer pratiquement leurs vues. Mais c’est Barnabé qui prit la parole.
- Alors, mes chéries, on complote?
Portée par une énergie nouvelle, comme soutenue par son propre discours, Gertrude se rebiffa.
- Ca se pourrait bien, gros bêta. Le patron laissait entendre pas plus tard que ce matin qu’il comptait bien se débarrasser d’un coq inutile.
Barnabé fut outré.
- Hein, quoi? Ce n’est pas… pas possible! Je suis son collaborateur. C’est moi qui fait régner l’ordre ici bas.
- Je ne dis pas le contraire, assura Gertrude en nous faisant un discret clin d’œil. Mais je l’ai parfaitement entendu dire qu’un coq qui passe son temps à courir les poules ne lui sert d’aucune utilité. Il a besoin d’un agent de sécurité, pas d’un coureur.
Offusqué, Barnabé balbutia
- Mais, que… Enfin, ce n’est pas… Je ne vous…
Barnabé n’avait pas la réputation de savoir organiser sa pensée et encore moins de pouvoir la traduire par des mots simples formant des phrases compréhensibles. Barnabé était un benêt. Gonflé d’orgueil, se croyant être le maitre de la ferme, il n’était qu’un simple coq de basse cour secondaire. S’il faisait illusion, du moins à ses propres yeux, c’est parce qu’il jouissait d’un monopole plutôt enviable. Face à un mâle dans toute sa splendeur, il n’aurait pas tenu un round.
Il s’en alla, relevant la crête, pestant, et se mit en quête d’une ostensible ronde de sécurité. Nous étions momentanément libres de discuter de la situation. De fomenter des projets vitaux.
2. Gertrude.
Organiser une évasion ne s’improvise pas. Quelle méthode allait-on employer? Quand opérer? Devait-on mettre Barnabé au courant? De quel matériel avions nous besoin? Quel serait le rôle de chacune?
Albertine avait bien observé les grues cendrées traverser le ciel au dessus de nos crêtes. Trois nouveaux vols étaient apparus dans les jours qui suivirent. Il faut reconnaitre que les migrateurs ne manquaient pas d’allure. Formant un V parfait, les grues se protégeaient ainsi du vent en prenant le sillage de leur prédécesseur, ne battant des ailes qu’un coup sur deux. J’étais particulièrement troublée par le prestige de l’oiseau de tête. Il menait toute la troupe majestueusement, criant régulièrement ses directives à toute la meute. Ca avait de la gueule, je dois l’admettre et je m’imaginais déjà commandant un escadron de bernaches disciplinées par des années d’aller retour d’un hémisphère à l’autre.
Albertine s’employait à battre des plumes à la façon des grands seigneurs migrateurs. Mais le résultat n’était pas au rendez-vous. Un matin, elle s’était hissée péniblement sur le perchoir où Barnabé aime à se gonfler d’orgueil. Le regard lointain, conquérant, elle avait pris une grande inspiration et s’était lancée dans le vide.
Il y eut quelques battements désordonnés. Chacune d’entre nous retenait son souffle. Il ne manquait que le roulement de tambour qui accompagne les exploits grandiloquents d’artistes de cirque pour compléter la scène. Pendant quelques infimes secondes il y eut une sorte de grâce. Oui, une certaine élégance dans le mouvement quelque peu désordonné d’un gallinacé qui s’élance d’un haut perchoir pour éprouver la portance de ses plumes sur l’air qui, d’après les calculs d’Albertine, avait quelque consistance facilement mesurable qui permettait à certains corps suffisamment légers de planer. Mais Albertine avait surement omis différentes données dans ses équations ou bien elle ne maitrisait pas encore une technique inédite. On vit son regard étonné lorsque elle plongea verticalement la tête la première dans le sol, heureusement rendu moelleux par nos picotements préventifs. Une brique n’aurait pas fait mieux. Bien entendu, Barnabé avait lorgné toute l’opération d’un air goguenard.
- Alors, les chéries, on se croit à la piscine? C’est le grand concours de plongeon olympique?
Il se pavanait comme à son habitude, le jabot fier et la plume élégante pour ne pas dire précieuse.
Albertine se releva, une grosse motte de terre bien noire dans le bec.
- Cfa nfe marffche pfas.
En effet, il fallait améliorer le principe.
Notre scientifique refit ses calculs, aidée par Amandine qui commençait déjà à dessiner de formidables ailes qu’il aurait été vain de vouloir construire. La poésie et la technologie n’ont jamais rendus quelque chose de concret ensemble et ça ne risque pas de commencer avec les délires de notre Picasso en herbe. Léontine passait son temps à commenter les avancées techniques de lamentations prophétiques.
- Nous allons toutes périr dans d’atroces souffrances.
Je tentais de conserver une unité qui tendait à conforter et soutenir la motivation de notre scientifique autour de ce projet audacieux. Qu’avions-nous de moins que ces remarquables oiseaux migrateurs dont le vol semble être une seconde nature?
Laissant Amandine à ses délires d’ailes en balsa, en pâte d’amande, en soie tendue, en cristal voire même un magnifique prototype en sucre glace qui faisait déjà saliver Alfonsine, je proposais de tailler quelques larges feuilles dans le bananier qui ornait l’entrée du potager. Nous l’appelions le bananier parce qu’il en avait l’air mais aucune de nous ne virent jamais le moindre fruit accroché à ses branches qui ne ployaient que sous le seul poids de leurs larges feuilles. Comme on rencontre de ces femmes superbes qui ne peuvent enfanter, il existe des arbres magnifiques qui ne donnent jamais un seul fruit. Impuissance? Egoïsme? Quoi qu’il en soit, je me proposais pour tester un harnachement digne des premières tentatives humaines de vol plané. J’allais avoir le suprême privilège de devenir la première poule volante. Albertine avait tout calculé. La pénétration dans l’air, la portance, le taux de stabilité des fibres des feuilles de bananier, introduit le facteur vent par un coefficient réducteur ou compensateur. Tout était prêt. Avisée de l’échec cuisant de notre première tentative d’apprivoisement de l’élément aérien par Albertine, j’étais décidée à m’élancer depuis le sol de terre battue, ne prenant aucun risque inconsidéré. Si le dispositif était optimal, il devait me permettre de gagner de l’altitude sans apport initial, autrement dit je devais pouvoir m’élever à la seule force des ailes, augmentées du dispositif ingénieux dont j’étais à l’origine mais qu’Albertine avait optimisé et qu’Amandine avait insisté pour y dessiner de longues trainées rougeâtres, améliorant selon elle seule le taux de pénétration dans l’air. Soit. Alfonsine nous avait encouragé à chaque étape en battant des ailes et caquetant comme une mégère, soutenant Albertine dans la composition du harnais, secondant Amandine dans la préparation des coloris, me maintenant lors de la pose de la structure finale. Seules Léontine et Marylin restaient en retrait, l’une marmonnant des prières apocalyptiques et l’autre continuant à se mirer dans notre abreuvoir, à lisser ses plumes et se maquiller le contour des yeux.
J’étais fin prête. Les larges feuilles parfaitement fixées à mes ailes me donnaient l’aspect d’un albatros esseulé et la démarche qu’ont ces palmipèdes une fois sortis de leur élément primordial, l’eau. Peu m’importait mon allure au grand dam de Marylin qui nous avait bien fait comprendre que jamais, au grand jamais, elle ne s’abaisserait à une telle vulgarité dans son aspect extérieur. Tout ce que je désirais c’est que cela fonctionne.
L’heure du grand jour avait sonné. Albertine avait, une fois de plus, rajusté ses calculs, amélioré certains détails, finalisé l’équipement. Il ne restait plus qu’à m’élancer. Je jetais un ultime regard, que j’estimais conquérant, envers mes collègues qui s’étaient alignées pour assister à cette première : une poule allait décoller du sol et, qui sait, sillonner les cieux vers des landes inconnues, atteindre de nouveaux horizons jamais explorés, coloniser une terre vierge. Bref, j’y croyais.
Et, il faut reconnaitre que le scepticisme de Marylin, l’air affolé de Léontine, les encouragements ostensibles d’Alfonsine ne m’encourageait nullement. Seules Amandine et Albertine semblaient m’épauler de concert, la première en rimant quelques vers à la gloire des oiseaux migrateurs dont, elle en était grandement persuadée, j’allais les rejoindre dans un bel élan, la seconde en plissant les yeux, prête à corriger un ultime défaut du système maintes et maintes fois évalué, testé, examiné, inspecté, contrôlé, vérifié.
J’avançais une patte sans me presser, puis l’autre. Tout en marchant, je commençais à balancer mes ailes qui me paraissaient peser des tonnes. Le mouvement fit un appel d’air autour de mes plumes, semblant me soulever comme dans un tourbillon. Je ne me laissais pas distraire par ces sensations nouvelles, inédites, étranges. J’entendais Albertine me donner des conseils sur le meilleur mouvement à appliquer à mes prothèses à la façon que les barreurs donnent les indications nécessaires aux rameurs pour remporter le titre olympique. Amandine ne déclamait plus ses vers, elle chantait un véritable hymne à l’oiseau volant que j’étais en train de devenir. Je ne les voyais plus mais j’imaginais sans peine Léontine, la tête plongée dans un bac à sable, singeant d’autres oiseaux que la nature clouait dédaigneusement au sol, Alfonsine tentait de me suivre à la trace comme ces badauds aux abords du palais des festivals à Cannes tandis que Marylin boudait dans son coin, résolue à ne point participer à ce carnaval. Si on l’avait écoutée, j’aurais dû m’enorgueillir d’une véritable livrée digne des princes des basses cours, comprenez ces majestés les paons, à la place de ce déguisement grotesque. Mais on lui avait expliqué en vain que je n’allais pas participer à un défilé de haute couture mais bien tenter une expérience novatrice dans le monde des gallinacées.
Je prenais de la vitesse sans pour autant accélérer. L’air s’engouffrant sous mes palmes de bananier me supportait toute entière et me donnait l’impulsion suffisante pour ne plus avoir besoin de mes pattes. Je volais. Restait maintenant à gagner de l’altitude car je voyais la clôture se rapprocher dangereusement de mes abattis.
Sur les conseils hurlés depuis le sol par Albertine, j’orientais légèrement mes ailes, donnant davantage de portance aux palmes. Je sentis aussitôt un ralentissement comme lorsqu’une bourrasque nous fait plier le cou tout en faisant s’envoler la poussière en tourbillon. Il me semblait être au point mort. Je n’avançais plus. Je regardai autour de moi. Le sol s’était sensiblement éloigné. J’avais grimpée de quelques mètres à la faveur d’un courant ascensionnel. Surprise de cette nouvelle position, je ne relâchais pourtant pas mon effort et je battais plus puissamment encore de mes ailes. Soudain une clameur résonna à mes oreilles. Mes compagnes me regardait, la tête en l’air, les yeux exorbités et le sourire aux lèvres, excepté Léontine qui se cachait le regard sous son aile droite, visiblement terrifiée. J’avais dépassé l’enclos. J’appuyais plus fortement sur mon aile gauche et je me mis à effectuer un splendide virage. J’étais grisée. Le dispositif était parfait. Il fonctionnait à merveille si l’on ne faisait pas d’erreurs.
Je fis deux ou trois fois le tour de notre enclos que je découvrais pour la première fois sous cet angle. Je comprends maintenant ce qu’ont dû ressentir ces bipèdes lorsqu’ils se sont arrachés à l’atmosphère terrestre, en route vers les étoiles. C’était tout bonnement superbe, aérien. Je prenais encore de la hauteur. Bientôt je dépassais le toit de la maison de notre maitre. J’étais devenu Dieu. Je régnais sur un monde totalement nouveau. J’étais libre. Je souriais de cet affranchissement, de cette libération, de ce pouvoir. J’évoluais pour la première fois dans la troisième dimension. J’entrevoyais des possibilités infinies. Qu’allait-on pouvoir faire de cette autonomie originale? Chacune de nous toutes était, à sa naissance, sortie de son œuf, maintenant nous allions pouvoir nous échapper de notre coquille.
Etourdie par mes nouvelles sensations, saoulée de cette liberté inédite goûtée pour la première fois, enivrée de perspectives fabuleuses et illimitées, je ne vis pas le fil électrique qui reliait le toit au poteau situé à une quinzaine de mètres en bord de chemin.
La première conséquence de cette faute d’attention fut de me déséquilibrer totalement. Soudain, je ne maitrisais plus rien. Le deuxième effet peut se résumer à une chute par paliers, les prothèses en feuille de bananier me faisaient virevolter au gré des courants ascendants, un flocon brinquebalé dans la tourmente hivernale, avant de m’envoyer paître dans un fossé où se déversait toute la boue nauséabonde récoltée des flancs d’un pré régulièrement humide, ajoutée aux déjections que la plupart des chiens du quartier qui, entre parenthèses, ne sont pas nos amis, aiment à déposer dans une posture qui ne leur renvoie pas la meilleure image qui soit. Ce n’est pas pour nous faire valoir mais, même dans une situation aussi inconfortable, nous autres gallinacés restons dignes.
Le troisième aboutissement fut plus humiliant encore. Le maitre vint me récupérer l’air ahuri, ne comprenant pas comment j’avais pu atterrir, engluée dans cette bourbe à vingt bons mètres de notre enclos parfaitement protégé : si aucun renard réputé rusé ou fouine suffisamment maline ne pouvait y pénétrer, comment une poule qui n’avait pas inventé l’eau chaude, dixit le propriétaire, avait pu parvenir à un tel résultat. L’homme se gratta la tête comme il s’y résigne lorsque une affaire dépasse son entendement. Ainsi, année après année, il perd le peu de cheveux qu’il lui reste. Les sujets d’incompréhension sont légion pour un homme comme Ernest Ripouldingue. Pourquoi, il y a de cela deux saisons, ses salades étaient apparemment mortes de soif bien qu’il prenne le soin de les arroser avec soin chaque soir? Pourquoi avait-on déprogrammé son jeu télé favori et le diffuser dorénavant à l’heure où il devait traire les quelques brebis qui constituait son cheptel? Comment se faisait-il que des stars du cinéma ou de la chanson sans parler des sportifs de haut niveau ou encore d’hommes politiques bien en vue et de puissants patrons d’entreprises qui gagnaient largement en un mois ce que lui mettrait quelques années à amasser, comment ces personnes visiblement à l’abri du moindre souci, du moins au niveau pécuniaire, pouvaient-ils se résoudre à prendre le risque de détourner de fortes sommes d’argent, de trafiquer pour un zéro supplémentaire à leur compte en banque, d’escroquer les finances publiques par le biais de fausses déclarations sur leurs revenus? Enfin, et cela restait et resterait sa plus grande interrogation, son ultime incompréhension du monde qui l’entourait, pourquoi sa femme désirait-elle toujours acquérir une nouvelle robe alors que son armoire en était remplie et pourquoi elle mettait tant d’ardeur à lui interdire l’entrée de la maison ses bottes aux pieds?
J’en fus pour une sérieuse réprimande mais non accompagnée d’un singulier coup de pied au derrière comme il était coutumier du fait sur son fidèle épagneul lorsque celui-ci n’accordait pas ses tendances avec la bonne marche de la maisonnée. Tout en se grattant une nouvelle fois le crane entre ses deux oreilles, le maitre cherchait le responsable de cette évasion spectaculaire mais plus encore comment et pourquoi je m’étais retrouvée avec deux larges feuilles de bananier scotchées aux ailes.