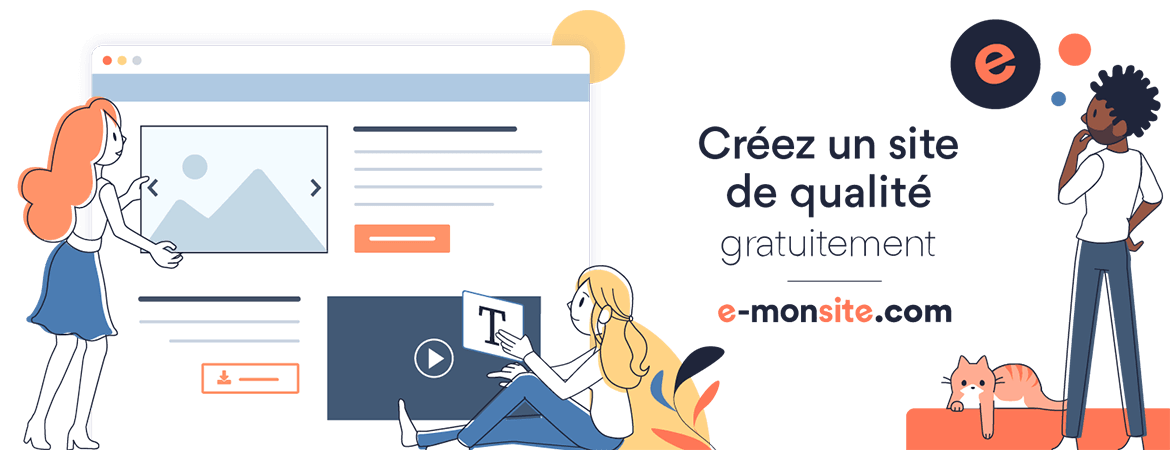Rencontre(s)
***
Rencontre(s)
***
- Un -
« Mesdames Messieurs, le vol 4712 d’American Airlines à destination de Londres est attendu piste 13. Les passagers sont invités à se rendre porte 24, pour l’embarquement. Merci de vous munir de votre titre de transport et d’une pièce d’identité valide. Ladies and gentlemen, flight 4712 to London is expecting… »
Enfin! Ces attentes de salles portant le même nom, de halls d’aérogare impersonnels, de quais de gare glacials, me dépriment grandement. J’ai l’impression de gâcher de précieuses minutes même si je n’ai rien d’autre à faire, rien de prévu.
Je me demande bien pourquoi j’ai choisi ce haut bleu turquoise qui ne me va pas du tout. Quelle conne par moments! Ecervelée comme un moineau. Tiens, pourquoi traite-t-on toujours les oiseaux de simples d’esprit. Si ça se trouve, c’est très intelligent un volatile. J’irai me renseigner dès mon retour.
Le haut parleur qui a pris la voix impersonnelle d’une bande enregistrée réitère son annonce en anglais. Je n’ai pas bougé d’un pouce, plongée dans mes pensées ailées et je me rends compte que je suis plus à l’aise dans la langue de Shakespeare que dans ma langue maternelle. C’est vraiment un comble!
Je m’appelle Sylvie Carcassonne. Pourtant je n’ai jamais eu le loisir de visiter cette ancienne ville fortifiée, mais elle noircit mes dix ans car j’avais eu le tort de repousser les avances d’un petit garçon, macho dans l’âme, qui était la coqueluche de la classe et de l’école tout entière. Même les professeurs l’appréciaient, attendu que, sans effort aucun, il collectionnait les meilleurs notes et n’était turbulent qu’en dehors de l’enceinte scolaire, spécialement sur le terrain de rugby.
Il avait été vexé dans son orgueil de jeune coq et avait ligué d’abord toute la classe contre moi, puis toute l’école. C’est ainsi qu’il s’était attaqué à mon patronyme, élaborant quelques beaux mots autour de la citadelle imprenable de Carcassonne, de ses remparts infranchissables, puis avait fait circuler des rumeurs sur ma vie privée tellement incroyables que tous les gobaient, puisque amenées avec tant d’intelligence et de perfidie. Dans un premier temps, il sous-entendit que j’avais été adoptée, mes parents génétiques ne voulant plus de moi. Puis il insinua que je ne me lavais pas, que je dormais avec une truie dans mon lit et, au plus fort de cette campagne de dénigrement, que je mangeais mes excréments.
Cette conspiration était faite dans mon dos, jamais il ne m’a poussée, bousculée, ni même touchée. Il ne m’adressait jamais directement les insolences qu’il préparait minutieusement. Les offenses qu’il répandait étaient colportées par d’autres, les outrages n’étaient jamais de son fait, il n’en était que le machiavélique instigateur, le diabolique guide, le démoniaque auteur.
Aller en classe était devenu un enfer. J’étais stressée chaque matin et, bien des fois, je me réveillai avec une boule d’angoisse au fond de la gorge au milieu de la nuit avant de comprendre, dans l‘obscurité des deux heures quinze qu‘il me restait encore quelques heures de répit. Je n’avalais plus rien au petit déjeuner. Maman s’était rendue compte de ce changement. Sa petite fille enjouée était devenue taciturne, mais je n’osais pas me confier, même à mes parents. Je gardais tout pour moi. Le corps enseignant ne voyait rien, rien d’autre qu’autant de cerveaux à garnir, comme une nourrice considère le bébé comme une bouche à remplir. Maman mit ce replis sur moi-même comme étant les prémices d’une adolescence proche et surement difficile.
Je ne fus sauvée de ces turbulences que par un déménagement parental aussi inattendu que salutaire. Je dis adieu avec délectation à cette école où j’étais devenue un paria, où les rires et quolibets se déclenchaient à mon passage, où l’on me montrait du doigt avec un air entendu et tirai un trait définitif sur cette période noire de mon existence.
J’en conservais cependant une rancune tenace envers tous les beaux parleurs, les personnes sûres d’elles et une méfiance totale contre les supposés manipulateurs que je repérais immédiatement. Je m’enfermais dans ma coquille où personne ne pourrait venir me faire du mal, je ne parlais guère, ne donnait aucun indice sur ma vie pour éviter de proposer un flanc trop faible, trop facile aux esprits malveillants. Bref, je devenais sans m’en apercevoir la prisonnière de mon propre monde, je m’excluais en toute inconscience sans en supposer les futures conséquences.
J’étais particulièrement méfiante envers les garçons et plus ils étaient beaux, plus ils me plaisaient, plus je restais glacée. Ils le sentaient et n’osaient même pas m’aborder. Je glissais dans l’adolescence avec un sérieux handicap. Je m’en fichais.
Je me plongeais alors comme une forcenée dans les études et commençais évidemment un journal intime que, au contraire de mes camarades de classe, je ne lâchais pas à mes quinze ans. Ce fut ma période poétesse incomprise. Puis vint ma passion des musées. Mes parents avaient encore déménagé. Nous étions à Londres et je trainais des jours entiers dans les hautes salles des musées de la ville. Bientôt je fus connue de tous les gardiens, de chaque guide. Eux ne me voyaient pas comme une proie, les relations étaient franches sans aucun sous entendu sexuel, il aurait été difficile d’en être autrement au regard de leur moyenne d’âge, quoique la libido ne fane jamais chez ces messieurs. Même lorsque la mécanique ne fonctionne plus, leur esprit dépravé continue de fantasmer comme à leurs quinze ans, je l’appris par la suite.
Nous parlions peinture, sculpture, art. Je rêvais d’être à leur place, de baigner dans ce milieu si pur, débarrassé de toute la lie humaine. Parcourant ses salles immenses, on s’élevait même si la plupart étaient situées en sous-sol. On avait entreposé bien à l’abri de ces vieilles pierres des trésors de plusieurs siècles, le meilleur de l’homme, pour l’éternité. Au dehors, tout n’était que poussière, objets éphémères et disgracieux, vulgarité des pensées et des actes.
Les rues de Londres me semblaient sales, les boutiques, les magasins où toutes mes camarades se pressaient me dégoûtaient par leur ostensible mercantilisme. Ici, rien n’était à vendre. Tout avait une valeur qu’aucun prix ne pouvait réduire à de simples objets. Il m’arrivait ainsi de leur parler. Je racontais mes déceptions et mes espoirs à des bustes millénaires, m’épanchais devant des tableaux plusieurs fois centenaires, me confiais en toute sincérité en face de pièces d‘âge canonique.
Mes échanges culturels avec la fine fleur des gardiens et des guides, incontestables historiens de l’art, avaient pour double conséquence de me perfectionner dans l’histoire de l’art et d’améliorer un anglais aussi pur que de l’eau de roche.
J’étais en quête de pureté, d’absolu. Les consonances des langues latines m’évoquaient le langage de la rue, la langue victorienne devenait aérienne, subtile, délicate, raffinée, délicieuse. Je ne m’exprimais plus que dans ce dialecte uniquement employé dans les allées d’Oxford ou de Cambridge. J’étais anachronique par excellence. Je recherchais cette perfection jusque dans mon allure vestimentaire, la façon de me tenir droite, de marcher avec élégance. A cultiver cette recherche de rigueur, on me donnait cinq ans de plus que mon âge. En six mois, j’étais passée du statut d’adolescente benêt à ce celui d’une jeune femme cultivée.
J’ai gardé de cette période la passion du beau, de l’intemporel et le mépris de tout ce qui est éphémère. Je ne déteste pas davantage que devoir m’abrutir devant un écran de télévision, je fuis les portables et j’ai vraiment du mal avec l’informatique. Pourtant je suis bien obligée de composer avec les trois écrans qui rythment notre vie quotidienne depuis bientôt une génération.
Je suis attachée à la production d’une série télévisée produite par la BBC (je n’ai pas réussi à couper tous les ponts avec cette perfide Albion). En tant que spécialiste de l’art ancien, je suis chargée de rechercher les plus belles, les plus originales pièces disséminées dans les musées réputés du monde autant que dans les plus obscurs. Ensuite commence un long travail de vulgarisation, une véritable traduction pour moi, passer du langage noble, raffiné et soutenu à une bouillie prédigérée pour nourrisson affamé, le téléspectateur lambda.
Mais je m’acquitte de mon devoir avec le plus grand sérieux et une motivation sans faille puisque je sais que c’est la seule façon pour que la majorité puisse avoir accès à ses trésors. L’art parle à tous, y compris aux simples d’esprit, aux analphabètes et aux incultes. Il faut juste trouver les mots et la manière, l’angle parfait où une œuvre puisse s’exprimer dans un langage universel et élémentaire. Trop longtemps l’art fut le domaine exclusif et protégé d’une élite cultivée, arrogante dans son attitude à vouloir laisser le peuple (prononcé avec une moue dédaigneuse) dans l’ignorance de cul-terreux.
Parfois je me sens comme ces prêtres d’il y a cent ans qui ont œuvré pour que la messe ne soit plus célébrée exclusivement en latin.
- Deux -
Mesdames Messieurs, le vol 4712 d’American Airlines à destination de Londres est attendu piste 13. Les passagers sont invités à se rendre porte 24, pour l’embarquement. Merci de vous munir de votre titre de transport et d’une pièce d’identité valide. Ladies and gentlemen, flight 4712 to London is expecting…
C’est pas trop tôt! Je commençais à m’assoupir sur ces bancs pourtant inconfortables. Je déplie mes jambes engourdies, vérifie ma carte d’embarquement dans la poche intérieure d’une veste bleue qui a traversé les années vaille que vaille mais que je traine toujours lorsque je prends l’avion. Certainement un vieux reste de superstition.
Moi, le cartésien type, rationnel jusqu’au bout des ongles, les pieds bien sur terre quoi assez souvent dans les airs d’une capitale à l’autre, ne croyant que ce que je vois et encore! Rien n’est plus facile à trafiquer qu’une image, à travestir la réalité sur un écran sans compter qu’on ne voit que ce que notre cerveau veut bien nous montrer, influencé, conditionné comme nous le sommes de plus en plus. Ainsi, croit-on voir une scène dans son ensemble alors que nous n’en voyons qu’une partie, ou bien notre angle de vision nous interdit de comprendre l’ensemble, obnubilé par le souci de chaque détail. Qui irait imaginer qu’un relent de fétichisme me colle à la peau, plus exactement aux épaules en l’objet déjà mentionné, cette veste porte bonheur.
Je me présente. Eustache Baudimont. Je sais c’est peu commun comme prénom. Mes parents ne m’ont jamais vraiment donné d’explication quant à se choix.
La piste d’un vieil oncle paternel se prénommant ainsi ne me convainc guère. A l’école j’ai eu droit aux jeux de mots peu inventifs avec moustache, euh la tache… Bon, je ne m’en suis pas mal sorti et depuis quelques années, cette incongruité m’attire l’attention des demoiselles. Il n’y a rien qui me ravit autant. J’aime plaire. Un psy vous dira que je me cherche au travers de mes conquêtes, que je suis sentimentalement instable, que je n’ai pas résolu mon Œdipe, enfin plein de billevesées qu’il vous facturerait au prix fort et bien souvent au noir.
Je fus un enfant tout ce qu’il y a de normal, bien que ce concept de normalité soit sujet à controverse. Il en est de même pour la beauté. Tant de subjectivité dans une idée bien oiseuse. Le poète dit que la beauté se lit dans les yeux de celui qui aime. Cependant, l’homme étant un animal grégaire, mieux vaut ne pas trop s’éloigner des clous, au risque d’être montré du doigt ou, pire, être rejeté par la communauté. Spécialement lorsqu’on est, enfant, pas encore suffisamment armé pour affronter la cohorte des autres qui fait bloc dans un même langage, une même tenue, des pensées similaires et une façon de vivre identique. Donc, à six, sept ans, j’étais dans le moule, ne faisant pas de vagues. Juste un peu enrobé à une époque où l’obésité n’était pas un problème de santé publique. Là encore, j’ai eu de la chance puisque aucun trublion de la classe ne m’a jamais traité de gras-double ou de bibendum. D’ailleurs tout est rentré dans l’ordre avant même l’adolescence, puisque j’ai réussi l’exploit de grandir de dix-sept centimètres entre le premier octobre et le trente septembre suivant. Je ressemblais alors à ces ballons de baudruche qu’on étire à les rendre longs et fin sans changer leur volume. J’ai passé donc mon enfance et mon adolescence à faire le dos rond. Je m’adaptais partout, en n’importe quelle compagnie sans avoir besoin de me faire remarquer. J’étais celui qu’on n’interrogeait jamais en classe, celui qu’on hésitait à incorporer dans les équipes de foot ou de rugby, non pas par dégoût de devoir choisir un tocard mais parce que mes camarades ne me voyaient pas. J’étais invisible. Je pouvais donc me faufiler partout. J’avais le profil idéal de l’agent secret. Ma voie était donc toute tracée. Espion ou, au pire, journaliste. C’était compter sans une passion qui m’était tombée dessus tout petit déjà.
J’avais connu quelques difficultés à apprendre à lire malgré le bon usage et le bon dosage de la méthode dite globale (reconnaitre le mot dans son ensemble et, du coup, être la proie à une dyslexie latente) face à un système syllabique (le fameux b.a. ba de nos grands-parents qui demandait, au mieux, plusieurs longs mois d’apprentissage). En effet, je me méfiais des mots. Il y en avait toute une bande pour exprimer, grosso modo, la même chose et certains d’entre eux, pour ne pas dire tous, possédaient deux sens bien distincts, parfois opposés quand ils ne manifestaient pas des subtilités qui m’échappaient. Les mots étaient menteurs, les phrases à double sens et, du coup, le plus petit texte inoffensif devenait obscur et secret.
En revanche, les chiffres me ravissaient. D’abord, ils n’étaient pas vingt six et ne se plaisaient pas à se travestir comme le A et le U qui sonnaient comme le O (première mystification d’une longue, très longue série). Ces dix chiffres étaient les briques Lego qui allaient révolutionner ma vie, tout comme le jeu suédois est à la base de nombreuses vocations d’architectes. Je m’étais rapidement aperçu que certaines règles commandaient tout ce petit monde des chiffres. Qu’en les additionnant, les multipliant, les élever au carré puis au cube, ils conservaient un rythme dans leurs suites. J’avais une passion pour les nombres premiers bien entendu, mais les différentes manipulations m’excitaient grandement. Les suites logiques, les lois de probabilité, les différentes équations. Je me réfugiais dans mon monde, fait de chiffres et de nombres. Mais, ce qui aurait put, aurait dû me couper du monde, façon autiste des maths, n’était qu’une passion comme une autre. J’avais une vie sociale. Enfin, je pouvais, je savais me glisser partout et parmi n’importe qui. J’étais aussi à l’aise dans les relations humaines qu’en compagnie de mes nouveaux amis, les nombres. Et comme, selon la pensée bien répandue que les chiens ne font pas des chats, les petits garçons férus de chiffres ne deviennent pas des écrivains ou des historiens, mon avenir devenait limpide.
Je suis mathématicien. Si, ça existe encore. Pas un vulgaire professeur aux épaisses lunettes et complet trois pièces portant un attaché case comme on promène un chien ni cet affreux jojo arborant un col roulé à grosses mailles hiver comme été, les cheveux en désordre et la mine défaite, trainant une sacoche en vieux cuir qui a fait la guerre.
En fait, ma vie se résume à jongler avec des théorèmes, à démontrer de nouvelles théories, à manier les équations comme un banquier compte ses bénéfices, mais surtout à me déplacer énormément aux quatre coins de l’Europe, parfois en Russie, au Japon, aux Etats Unis, pour des conférences où des énergumènes dans mon genre se rencontrent et ne parlent que mathématiques, ne vivent que par les mathématiques, ne respirent que nombres et probabilités.
C’est un peu ennuyeux, je l’avoue, et je ne me retrouve pas dans ces confrères passionnés. Non que j’exerce mon métier par-dessus la jambe. J’adore ce que je fais, ne pourrais m’en passer, mais j’aime avant tout la vie. Y mordre à pleine dents. Vivre chaque jour comme si c’était le dernier. Mathématicien hédoniste, logicien épicurien.
Tout ça n’est pas en contradiction. Si j’aime partager un repas agréablement arrosé, délicieusement préparé, car on ne mange qu’en bonne compagnie (lorsqu’on est seul on se nourrit), j’aime aussi la griserie que provoque la vitesse qu’elle soit obtenue dans une carrosserie enfermant deux cent chevaux sous seize soupapes, ou sur les pistes noires, et encore derrière un bateau en ski nautique ou mieux, en chute libre, largué d’un bimoteur en plein ciel. Et mathématiquer me rend heureux. Jongler avec les théorèmes, maîtriser les équations, résoudre les problèmes et s’en poser de nouveaux. Je jubile. Je prends tout autant de plaisir dans ces jeux de nombres qu’en participant aux vingt quatre heures du Mans. Et je plains les pisse-froid, les coincés de toutes sortes, les empêchés de jouir, les pincés en uniforme, les gelés de la vie et tous ces gens qui enveloppent leur canapé pour qu’il ne s’abîme pas, tous ceux qui ne veulent pas user leur existence, traversant la vie avec une camisole qui les empêche de profiter de chaque instant.
Car c’est bien cela. Savourer le moindre moment vécu quoique l’on fasse. J’ai connu des femmes de ménage plus épanouies que certains top-models.
La vie est trop courte. Carpe diem. Ne jamais
remettre le plaisir au lendemain.